Prochainement sur une station de radio locale près de chez vous. Crédit : Apple.
Lorsque même la chaîne de poulet frit Chick-Fil-A a lancé un service de streaming, et que vous pouvez passer d’une vidéo virale « Hawk Tuah » à un podcast ou à une entreprise crypto éphémère en quelques mois, il semble qu’aujourd’hui, tout le monde soit un créateur de contenu. Mais la dernière célébrité devenue podcasteur est d’un tout autre niveau d’improbabilité : Sa Majesté le Roi Charles III.
Enfin, en quelque sorte. Lundi, Sa Majesté a publié La Salle de Musique du Roi, un programme d’une heure célébrant la musique de tout le Commonwealth, choisie (nous dit-on) par le Roi lui-même. Les transitions entre les morceaux étaient lues, ou du moins semblaient l’être, par le Roi. L’émission a été diffusée pour coïncider avec la Journée du Commonwealth, qui est (encore une fois, nous dit-on) célébrée dans les 56 pays du Commonwealth à travers le monde. Elle a été marquée au Royaume-Uni par une cérémonie à l’abbaye de Westminster, et est, selon son site web, « une occasion de célébrer la forte unité, la diversité et les valeurs partagées » des pays du Commonwealth.
Mais que signifie tout cela en pratique ? C’est plus difficile à établir, surtout lorsque mon sondage informel d’amis à travers le Commonwealth a indiqué qu’ils n’étaient pas plus conscients que je ne l’avais été que « la Journée du Commonwealth » était même une chose. En revanche, en écoutant le podcast de Charles et en le considérant comme un événement, il semble qu’il s’agisse d’un commentaire royal plus subtil sur cette question qu’il n’y paraît au premier abord.
La Salle de Musique du Roi était un écoute agréablement éclectique : un tour à travers les souvenirs musicaux d’un britannique de la classe supérieure particulièrement cultivé et bien voyagé. Bien qu’ils vieillissent un peu maintenant, il y a encore beaucoup de ce type au Royaume-Uni, vestiges d’une caste qui, à des époques antérieures, aurait fait sa vie quelque part à l’étranger en tant qu’administrateurs coloniaux, commerçants ou bienfaiteurs. La plupart se sont adaptés avec élégance au monde changé dans lequel ils mènent leur vie, et conservent les intérêts esthétiques éclectiques et internationaux de leurs ancêtres impériaux comme une sorte de mémoire musculaire culturelle.
Leurs étagères pourraient contenir les collections de contes africains de Geraldine Elliot, aux côtés de Kipling et Macaulay. Ils auraient joué le choix de Charles, la chanteuse sud-africaine des années 50 Miriam Makeba, sur une cassette dans la voiture (probablement une Rover) des années avant le lancement de Late Junction de Radio 3 en 1999. Et pour beaucoup d’entre eux, le Commonwealth était manifestement une bonne chose, ne serait-ce que pour propager ce vague sentiment de fraternité internationale et multiculturelle qu’ils appréciaient, d’où toute cette belle musique et cette nourriture et culture intéressantes semblaient découler — juste sans les aspects les plus laids de l’empire.
En tant que corps politique substantiel, cependant, qu’a réellement accompli le Commonwealth ? Peut-être que la chose que nous pouvons dire avec le plus de confiance est qu’il a donné à la monarchie britannique quelque chose à faire, ayant perdu leur rôle de chefs d’État d’un empire s’étendant sur le globe. La mère de Charles, la défunte Reine, a géré cette transition avec grâce, passant d’Impératrice à coupeuse de rubans mondiale avec un stoïcisme tranquille. Et Charles le podcasteur semble faire de son mieux pour continuer dans la même veine, promulguant l’aspiration du Commonwealth à « une forte unité, diversité et valeurs partagées » à travers le moyen d’une playlist de musique du monde.
Mais en des termes plus concrets, il y a toujours eu des sceptiques — notamment, dans les débuts relativement précoces du Commonwealth, le Cassandre en chef de la politique d’après-guerre : Enoch Powell. Powell est, bien sûr, connu aujourd’hui principalement pour le discours notoire de 1968 « Rivers of Blood » qui a terni son héritage à jamais avec le péché impardonnable du racisme. Sur cette base, nous pourrions simplement rejeter son scepticisme à l’égard du Commonwealth comme un signe précoce d’animosité générale contre les étrangers. Mais comme l’a noté Aris Roussinos, les opinions de Powell sur la politique intérieure ont longtemps éclipsé ses réflexions sur les affaires internationales. En particulier, il était un réaliste en matière de politique étrangère : c’est-à-dire qu’il considérait la géographie, les ressources, le pouvoir relatif et l’intérêt national comme des guides plus pertinents sur ce que les États peuvent et doivent faire, que les questions de valeurs. Et c’est cette vision, qui est tombée en désuétude après la guerre au profit d’une approche plus utopique et internationaliste, qui forme la base de son scepticisme à l’égard du Commonwealth.
Dans un discours de 1964, Powell a rejeté l’idée que les électeurs britanniques accordaient beaucoup de crédit à l’idée d’« appartenir à un Commonwealth » formé de chaque pays autrefois colonisé ou protégé par, ou autrement lié à la Grande-Bretagne. Pour Powell, cette idée avait toujours trop de contradictions internes pour aboutir à quoi que ce soit. Il a noté que parmi ses États constitutifs, « un certain nombre de ces pays sont antipathiques les uns aux autres », tandis que beaucoup affichent une « antipathie visible et publique envers la Grande-Bretagne ». Les Britanniques, dans l’ensemble, ne prennent pas cette antipathie personnellement, pensait Powell. Mais « il est difficile après tout cela de se faire dire que tous ces pays forment avec nous un grand Commonwealth qui est le meilleur espoir du monde pour la coopération internationale et interraciale ».
Powell n’y croyait pas, et ne pensait pas que l’électorat britannique le fasse non plus. Ni, semble-t-il plus récemment, de nombreux pays du Commonwealth. L’Union Jack a disparu progressivement des drapeaux nationaux depuis la fin de l’empire. D’autres, en revanche, semblent sentir une opportunité de soutirer de l’argent à la Grande-Bretagne relativement riche, via la culpabilité historique : Keir Starmer a subi une pression soutenue de la part des dirigeants de plusieurs membres du Commonwealth pour payer des réparations aux anciennes colonies pour l’esclavage. Ailleurs, il est peu clair quelle contribution, le cas échéant, l’adhésion au Commonwealth a apporté pour apaiser la relation délicate entre (par exemple) l’Inde et le Pakistan, ou les négociations en cours et épineuses sur qui devrait contrôler les îles Chagos, la Grande-Bretagne ou Maurice.
Mais comme Powell l’a également noté, ce Commonwealth n’était pas et n’a jamais eu pour but d’être une sorte d’alliance de défense ou même commerciale. Il a prospéré principalement dans le contexte de Pax Americana, comme une sorte de rémanence sentimentale de l’empire que Pax a remplacé et aidé à démanteler. Et maintenant, tout en exprimant les aspirations ouvertes du Commonwealth à une vague unité et diversité culturelle, le podcast du roi Charles peut être lu comme une réponse diplomatiquement complexe à la décision de l’Amérique elle-même, sous Trump, d’abandonner définitivement le parrainage de Pax Americana.
Sa Majesté se trouve dans une position délicate ici. Il subit des pressions de la part des voix pro-Ukraine en Grande-Bretagne pour snober le Président suite au refroidissement du soutien américain à la guerre de Zelensky contre Poutine. Les Canadiens, quant à eux, sont outrés par les répétées expressions d’intérêt des États-Unis pour annexer le Canada — un pays du Commonwealth dont, du moins nominalement, Charles III reste le chef d’État. Mais il est également obligé de rester en dehors de la politique. Ainsi, malgré certains Canadiens appelant le Roi à « s’opposer » à Trump, il a refusé de commenter ces menaces d’annexion.
Et en effet, Charles pourrait rétorquer aux contestataires : que réaliserait « s’opposer » ? Des sondages récents suggèrent que plus de la moitié des Canadiens estiment déjà que leur pays devrait couper les liens avec la monarchie ; peut-être se sont-ils simplement sentis validés. Le silence obstiné de Charles face à un possible expansionnisme trumpien ne peut pas lui avoir valu la sympathie des loyalistes restants. Et pourtant, comme l’ont noté les commentateurs avec des degrés variés d’approbation et d’alarme, l’administration Trump a clairement fait savoir sa décision de passer de l’internationalisme à un réalisme de politique étrangère d’un type qui aurait été immédiatement intelligible pour Enoch Powell. Et d’un point de vue réaliste, ce qui compte, c’est le pouvoir dur et les sphères d’influence. On ne « s’oppose » à personne à moins d’être prêt à aller jusqu’au bout. Et ici, Charles n’a rien. Trump le sait : le fait que sa proposition d’annexer le Canada ait simplement ignoré le Commonwealth, et les liens du Canada avec la Grande-Bretagne, suggère qu’il a évalué ces deux éléments et a conclu avec précision qu’ils sont essentiellement sans importance pour faire ce qu’il veut.
Ainsi, avec le parrainage américain d’un « ordre international basé sur des règles » désormais remplacé par un parrainage américain apparent d’une anarchie internationale musclée, nous devons nous demander : en l’absence de pax Americana, le Commonwealth peut-il même survivre ? Et si oui, dans quel but ? Si cette entité a un avenir, il pourrait se trouver dans le caucus récemment approuvé par certains Canadiens pour un soutien mutuel, en réponse à la politique trumpienne : une contraction nette du Commonwealth actuel de 56 nations en « CANZUK », une alliance du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Royaume-Uni.
Une telle alliance pourrait, d’une certaine manière, trouver un équilibre entre le réalisme sombre de Powell, invité par le tableau géopolitique contemporain en cours, et la tendance britannique résiduelle à garder un œil toujours sur l’horizon. Powell lui-même a reconnu des « liens de sang et de sentiment » convaincants avec ces États éparpillés ; des liens qui ne s’appliquent sûrement pas dans la même mesure avec (disons) le Kenya, sauf peut-être dans les souvenirs flous de ces quelques boomers coloniaux survivants nés là-bas avant l’Urgence. Ainsi per Powell, des facteurs ethniques et historiques plaident en faveur de liens plus étroits ; pendant ce temps, les territoires eux-mêmes sont suffisamment éloignés pour peut-être satisfaire cette envie anglo.
Mais bien que de tels liens (et, souvent, des connexions familiales élargies littérales) puissent se combiner avec l’histoire du Commonwealth pour plaider en faveur d’une alliance plus étroite, la caste dirigeante héritée de la Grande-Bretagne accepterait-elle cela ? Il est assez sûr que beaucoup de ces boomers coloniaux, et certains de leurs enfants aussi, reculeraient devant l’ethnocentrisme de la formulation de Powell. Nous pourrions déduire de la playlist du Roi Charles qu’il serait parmi les réticents : son choix de morceaux ne favorise pas particulièrement, après tout, les composants CANZ d’un éventuel CANZUK.
Mais si le contenu plaide ouvertement en faveur d’un « soft power » pluraliste et d’une plus grande diversité culturelle au sein du Commonwealth, le choix du format reconnaît discrètement que le véritable contexte de soft power qui permet toutes ces déclarations échappe à son contrôle. L’enregistrement n’a pas été diffusé sur la BBC — encore moins sur le vieux diffuseur impérial en déclin, le BBC World Service, qui a récemment annoncé qu’il allait supprimer 130 emplois dans le cadre d’un exercice d’économie. Non : la playlist royale a été publiée sur Apple Music, un titan corporatif américain qui, contrairement à la BBC, a une portée véritablement mondiale. Et le choix de plateforme du Roi reconnaît tacitement ce contexte clé de nombreux bouleversements contemporains, y compris, pourrait-on dire, la révolution trumpienne : le fait que les médias numériques sont désormais un — peut-être le — vecteur clé du « soft power ». Que l’Amérique souhaite ou non maintenir un Pax Americana de hard power, sa domination numérique en matière de soft power est presque totale : la part du lion des médias numériques est actuellement américaine.
Le choix de plateforme du Roi, et même de l’entrée finale de la playlist, reconnaît discrètement cette réalité. Beyoncé n’est pas une artiste du Commonwealth — elle est américaine. Et lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous pouvons lire The King’s Music Room comme une déclaration avec des côtés ouverts et cachés, abordant plusieurs aspects de son dilemme diplomatique.
D’un côté, son obligation de s’adresser, de célébrer et de reconnaître un Commonwealth plus vaste, impossiblement large et intérieurement fracturé, dont la raison d’être s’est depuis longtemps estompée et dont l’existence a toujours reposé tacitement sur l’Amérique pour maintenir la paix. De l’autre, l’obligation politiquement bien plus sensible du Roi de maintenir de bonnes relations avec une Amérique qui a perdu tout intérêt à garder cette paix — et pour cette raison, elle nécessite un traitement plus apaisant que jamais, sans pour autant offenser un Commonwealth dont certains membres considèrent désormais l’Amérique comme hostile. Ce n’est pas une tâche facile.
En tant qu’artefact, The King’s Music Room réussit à concilier cela avec une grâce qui n’aurait pas déshonoré la défunte Reine. Mais en tant qu’équilibre, nous devons nous demander combien de temps cela peut être soutenu. Si le Roi Charles trébuche, nous ne pouvons qu’espérer qu’il y ait un CANZUK là pour nous rattraper.








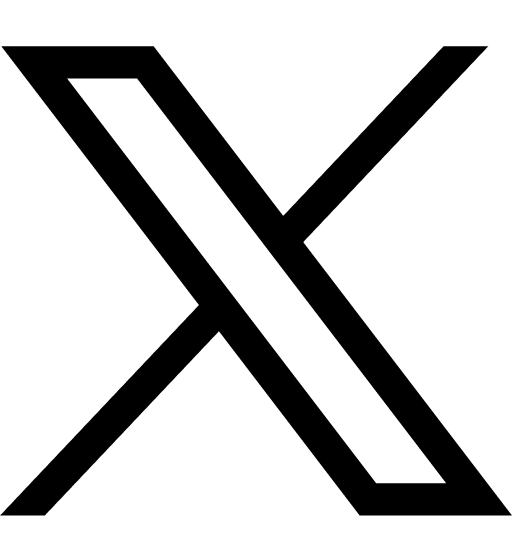
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe