Oscar Bear Runner, un membre du Mouvement indien américain (AIM), se tient avec un fusil à Wounded Knee, SD, sur la réserve indienne de Pine Ridge. Les Indiens négocient avec des responsables gouvernementaux dans le but de résoudre le problème dans la ville.
Si voter est sacré, personne n’a dit cela à Ross John. « Je ne suis pas électeur aux élections d’État et fédérales », me dit cet homme d’affaires de 68 ans et citoyen de la nation Seneca, « parce que je ne suis pas citoyen des États-Unis. » Techniquement, John est un Américain. Mais sa réaction à la campagne « Voter est sacré » est révélatrice. Car si la politique américaine est devenue totalement nationale — 70 % affirment avoir beaucoup réfléchi à Kamala Harris ou Donald Trump, même si un tiers ne peut pas identifier leur propre gouverneur d’État — les problèmes, surtout pour les Amérindiens comme John, restent définitivement locaux.
La course présidentielle de 2024 est celle qui sera décidée à la marge. Les démocrates espèrent que le mantra Voter est sacré produira une reprise du vote amérindien de 2020. Il y a quatre ans, une hausse de la participation des Navajos et des Hopis a fait la différence dans la victoire de Biden par 10 000 voix en Arizona. Dans le Midwest, les électeurs Menominee et Ojibwe se sont révélés décisifs dans le Wisconsin, un concours finalement décidé par seulement 20 000 bulletins.
Pourtant, si Voter est sacré est un effort national visant le large public indigène, ils représentent en fait un kaléidoscope de modes de vie. Au total, il y a environ 9,7 millions d’Amérindiens et d’Alaskans, dispersés à travers environ 573 groupes reconnus par le gouvernement fédéral. Comme John, certains ont construit leur maison dans le pays. Pourtant, d’Anchorage à Phoenix, 70 % vivent dans des villes. Comme John, environ un quart vivent dans des réserves ou des terres de confiance tribales, tandis que le reste se débrouille de manière indépendante.
Étant donné cette répartition, en tout cas, les priorités des natifs sont aussi variées que partout ailleurs en Amérique, allant des casinos à New York aux droits des bisons dans le Montana. Au-delà de cela, les Amérindiens diffèrent dans un autre aspect vital : leur pouvoir. Un siècle après la loi qui leur a enfin accordé la citoyenneté, ils sont maintenant bien sûr égaux devant la loi. Mais si les Navajos peuvent tirer parti de leur emplacement dans un État clé, et que les tribus ailleurs ont appris à encourager le vote stratégique pour atteindre leurs objectifs, des hommes comme Ross John semblent condamnés par la géographie.
Les Amérindiens, après tout, ne sont pas juste un autre groupe d’intérêt. Expulsés de la plupart de leurs terres ancestrales, les groupes tribaux possèdent la souveraineté et des droits garantis par des traités fédéraux. Pourtant, en tant que peuple dispersé, ils manquent de pouvoir électoral concentré. Et si Voter est sacré est une stratégie pour donner du poids au vote indigène, du moins en politique présidentielle, des siècles de promesses non tenues signifient que beaucoup ne sont pas sûrs que la politique puisse aider.
Ross John a vécu toute sa vie dans le sud-ouest éloigné de New York. Au milieu des érables à sucre majestueux des Alleghenies, et des granges en ruine avec leurs éclats de peinture rouge, il est l’un des 8 000 Seneca ici, dispersés à travers une paire de communautés non contiguës. Dans la réserve de Cattaraugus de John, le taux de pauvreté est de 65 %. Dans la réserve voisine d’Allegany, il est de 33 %, mais cela reste nettement plus élevé que dans de nombreuses villes voisines.
Dans la proche Salamanca, une ville délabrée de New York de 6 000 habitants, juste à côté de l’autoroute Southern Tier, un casino en hauteur domine le paysage. Salamanca offre du cannabis légal, des stations-service en mauvais état pour de l’essence et des cigarettes exonérées de taxes — et des jeux d’argent. Un piège à touristes sordide avec des panneaux aléatoires en langue sénèque, c’est devenu un symbole des luttes des autochtones.
Pas étonnant que John se soit engagé en politique, servant 14 ans au conseil tribal. Pourtant, malgré sa vision de la souveraineté tribale comme l’alpha et l’oméga de la politique locale — par traité, les Sénèques sont une nation indépendante distincte des États-Unis — John a finalement été déçu par son temps en fonction. Le problème de base, explique-t-il, était le mépris des étrangers. “Je n’ai pas été très réussi à changer la politique tribale,” dit-il. “Il y a juste trop de directives fédérales.”
John Kane, un Mohawk vivant sur le territoire sénèque, a des plaintes similaires. “Les Sénèques paient 50 % de leurs revenus de jeux [à New York] pour acheter une exclusivité dont ils n’ont pas besoin,” se lamente l’animateur de l’émission Resistance Radio. Les problèmes ont commencé en 2002, lorsque les Sénèques ont ouvert le premier de trois casinos de l’État de New York, tous détenus par des Amérindiens. Pour ce faire, Albany a imposé un accord qui oblige les Sénèques à verser à l’État un quart de tous les revenus des machines à sous. Les Sénèques, pour leur part, paient toutes les dépenses d’exploitation à partir de leur part, ce qui se traduit par un partage des bénéfices de 50/50 avec l’État.
Au total, les Sénèques ont payé 1,4 milliard de dollars à l’État de New York entre 2002 et 2017. Mais Kane se demande ce que la tribu a obtenu en retour. En 2002, la même année où la tribu a ouvert son casino, la constitution de l’État a interdit tous les jeux d’argent. En 2013, les électeurs l’ont amendée pour autoriser les jeux de style Las Vegas. Ainsi, 1,4 milliard de dollars ont payé pour une “exclusivité” qui était déjà interdite par la loi mais qui est maintenant autorisée. En expliquant tout cela, Kane soupire : “On ne peut pas inventer ça.” En 2017, les Sénèques ont cessé leurs paiements. À ce jour, la tribu et l’État restent enfermés dans une bataille juridique. Contrairement à John, Kane ne renonce pas à sa citoyenneté, mais il est néanmoins cynique à propos du mouvement Voting is Sacred. “L’idée que nous sommes un bloc électoral déterminant est exagérée,” dit-il. “Nous voulons juste qu’on nous laisse tranquilles.”
Tout le monde n’est pas aussi désabusé. Contrairement à Kane, Tracie Garfield embrasse Voting is Sacred. Membre de la tribu Fort Peck, elle vit dans le Montana, où 6 % des citoyens en âge de voter sont des Amérindiens. En 2006 et 2012, le vote des autochtones a aidé le sénateur démocrate, Jon Tester, à remporter des victoires serrées. Pour 2024, la directrice de la communication de la campagne Western Native Voice de son État a organisé des campagnes d’inscription des électeurs à travers le Montana.
Cette fois-ci, cependant, Garfield constate beaucoup de fatigue électorale. “Je ne vois pas beaucoup d’excitation.” Ce qu’elle perçoit dans le Montana est un problème national. Seulement 66 % des Amérindiens en âge de voter sont même inscrits, un problème aux racines profondes. Les Amérindiens ont été privés du droit de voter jusqu’en 1924, lorsque le Congrès a enfin adopté la loi sur la citoyenneté indienne. Même alors, plusieurs États de l’Ouest ont résisté jusqu’aux années cinquante.
Comme le dit Garfield : “Nous devons repartir de zéro, puisque la plupart des autochtones ne sont qu’à la deuxième génération de vote.” Cela s’inscrit dans d’autres défis. Dans le Big Sky Country, un voyage au bureau de vote peut représenter un aller-retour de 100 miles. Et même une fois arrivés au siège du comté, Garfield avertit que les électeurs potentiels se sentent parfois intimidés d’être le seul autochtone en ville.
Bien que la situation ne soit pas désespérée. Une solution, suggère Garfield, est de transformer le vote en une tradition, comme le bingo communautaire ou un dîner en famille, quelque chose qui, selon elle, aidera les Amérindiens à s’enthousiasmer pour la politique. « En tant que peuple tribal, » dit-elle, « nous respectons nos aînés. Si nous parvenons à faire voter les familles ensemble, alors c’est notre objectif. »
Pourtant, plus que l’enchevêtrement de l’histoire, ou l’attrait de la coutume, on a le sentiment que l’enthousiasme électoral des natifs peut finalement être compris comme une fonction de poids politique. Si, après tout, John et les Sénécas sont compréhensiblement pessimistes à New York, un bastion démocrate qui a de toute façon purgé la plupart de sa population indigène au début du 19ème siècle, les tribus plus à l’ouest ont beaucoup plus d’influence.
Le Montana, avec son bloc tribal de 6 %, est une chose. Mais cela ne vaut rien comparé à l’Oklahoma, où les Amérindiens représentent 13,4 % de la population, et où une faible participation renforce généralement encore leur influence collective. « Je suis optimiste, » dit Ben Barnes, chef des Shawnee dans l’État de Sooner. « Les Amérindiens peuvent vraiment faire une différence. Si nous votons, nous pouvons faire la différence. »
Plus précisément, la force numérique semble se traduire par un véritable enthousiasme dans le monde réel. En collaboration avec le groupe United Indian Nations of Oklahoma, Barnes a promu une nouvelle initiative de participation. Connue sous le nom de Warrior Up to Vote, elle a déjà enregistré des centaines de nouveaux électeurs natifs à travers l’État.
Et si cela témoigne, encore une fois, des opportunités extrêmement diverses pour les Amérindiens à travers le pays, on pourrait dire quelque chose de similaire sur ce que les électeurs indigènes veulent réellement. Les libéraux imaginent souvent que le vote amérindien est fermement démocrate. Mais un rapport de 2021 montre que les électeurs indigènes penchent à gauche de seulement 11 %. Cela est également reflété par des schismes ailleurs. Comme le souligne Garfield, le Montana a à lui seul 12 tribus reconnues, chacune avec des priorités distinctes. Les Crow, par exemple, exploitent leurs réserves de charbon et de pétrole, tandis que les Blackfeet voisins poussent pour des protections environnementales pour leurs « frères bisons ».
Les disparités démographiques affectent également la manière dont les Amérindiens font entendre leur voix. Dans des États clés comme le Wisconsin, les Ojibwe peuvent faire appel aux politiciens nationaux lorsque les autorités étatiques et locales les ignorent. En 2020, les Ojibwe, qui ont été durement touchés par le Covid, ont voté pour Biden afin de maintenir les restrictions sanitaires sur les réserves. Les candidats à la présidence viennent parfois même à leur rencontre : en septembre, Donald Trump a promis de reconnaître formellement les Lumbee, une tribu dans le champ de bataille crucial de la Caroline du Nord.
L’intérêt des grands noms est plus difficile à susciter en Oklahoma, un État à parti unique où Trump n’a guère à gagner en jouant le jeu. Pourtant, le pouvoir démographique des natifs dans l’État de Sooner compte toujours — c’est juste que des leaders comme Barnes doivent être plus subtils dans l’exploitation de leur influence.
Une tactique consiste à éduquer les législateurs sur les préoccupations des natifs, en particulier cette question cruciale de la souveraineté tribale. « Je constate qu’en Oklahoma, tous les législateurs ou sénateurs ne comprennent pas, » explique Barnes. « Nous devons voter pour un républicain ou un démocrate qui comprend que les Indiens sont souverains. » Une autre option est simplement de soutenir des candidats natifs : Markwayne Mullin, sénateur junior de l’Oklahoma, est à la fois un fervent supporter de Trump et un Cherokee.
« Ne votez pas R, ne votez pas D, votez I pour Indien, » est la manière dont Barnes décrit de manière évocatrice cette approche — et c’est certainement une approche qui porte ses fruits. Au Capitole à Washington, le président du Comité des appropriations de la Chambre est Tom Cole, un congressiste conservateur de l’Oklahoma. Plus important encore, il est également un membre inscrit de la nation Chickasaw, ayant une connaissance intime des affaires amérindiennes. « Quelle chance avons-nous, » dit Barnes, « de ne pas avoir à expliquer pourquoi le financement est nécessaire ? »
Ce plan complet a porté ses fruits : Cole parraine désormais un projet de loi historique pour enquêter sur les horreurs des écoles indiennes. Ce n’est pas que Barnes et d’autres Amérindiens mettent exclusivement leurs espoirs d’un côté de la Chambre. Cole collabore également étroitement sur les préoccupations tribales avec Sharice Davids, une députée libérale Ho-Chunk du Kansas. Barnes, pour sa part, ne tarit pas d’éloges sur ce couple politique atypique. « Quelle bouffée d’air frais ! »
Malgré ces succès régionaux, et en dépit de la multitude de traités fédéraux affectant les groupes autochtones, Barnes soutient toujours que les élections dans « les courses tribales » sont les plus importantes pour des électeurs comme lui. C’est un point qui est également souligné ailleurs. Pour Cynthia LaMere, l’ancienne vice-présidente du Parti démocrate du Nebraska et membre des Yankton-Sioux, les élections au niveau communautaire, dans la réserve ou la fiducie tribale, sont tout simplement plus « tangibles ». Compte tenu de la gamme déroutante de préoccupations autochtones, cela n’est sûrement pas surprenant, surtout lorsque le niveau le plus bas de la politique électorale est l’arène où les écoles sont gérées et les casinos administrés.
Mais où cela laisse-t-il des personnes comme Ross John, se débattant entre un gouvernement d’État agressif et sceptique d’une part — et des législateurs congressionnels indifférents de l’autre ? Pour Stephen Knott, cela touche au cœur du problème. Comme le dit le professeur émérite du US Naval War College, Newt Gingrich a « nationalisé » chaque course congressionnelle dans le pays en 1994. Mais si les médias s’obsèdent maintenant sans fin sur les frasques du Capitole, 536 titulaires de fonctions fédérales pâlissent encore en comparaison des 500 000 élus à l’échelle nationale. « C’est un arrangement schizophrénique, » admet John à propos de son peuple Seneca. « Et nous devons vivre avec ça. »





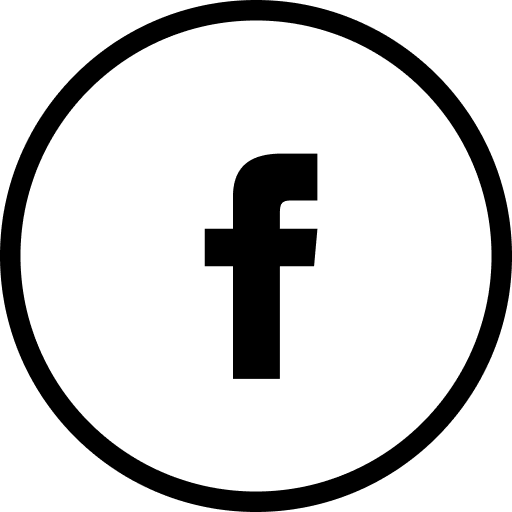
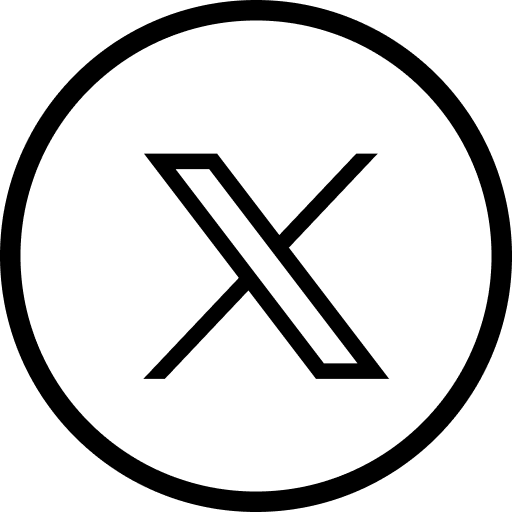
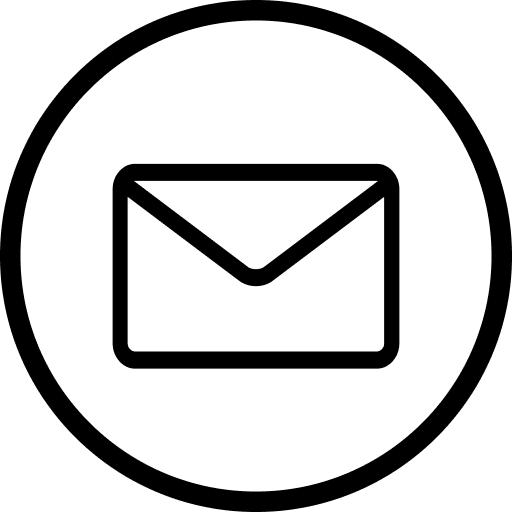
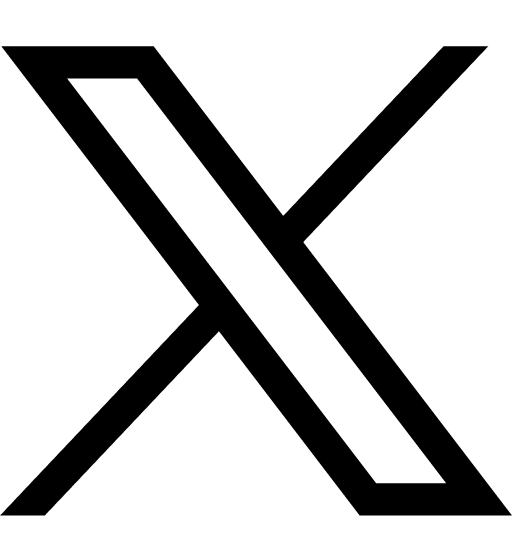
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
SubscribeReform and some of the Cons (the ones not in charge for most of my lifetime) are the only political movements that don’t actively mistrust and work to destroy rootedness, security and identity.
“the reason potholes are never fixed is a lack of funding and council incompetence”
It’s because road maintenance is a licensed activity. and it’s illegal for anyone unlicensed to do the work. The certification is convoluted including things like a quality management system and audits in addition to the things you’d expect like material specifications. You can’t, as a competent adult, just fill in a hole.
The need for certification obviously limits the number of potential suppliers, which then, naturally, both pushes the price up and limits supply, creating backlogs due to the lack of sufficient certified suppliers. And since certification is an upfront expense, it acts as a barrier to entry for new suppliers, particularly for small businesses that do not have administrative ‘slack’ to afford to do the paperwork. Certification will always benefit larger suppliers as a result.
Now filling in a hole will need to comply with some basic standards, so it’s not a job for cowboys. But I would have thought a much simpler and cheaper process would be possible. Material could be bought ‘off-the-shelf’ to standards. Initial specific training just for pothole repair and how to do a good job could be provided for free by the council to interested parties (would it need more than a day?). And a council overseer could be employed to view the works as they take place to ensure they are competently done and then council certified for liability issues. A simpler process would allow smaller, local firms to offer services (perhaps at a fixed price), increasing supply, reducing prices and speeding up the number of repairs.
The ‘industry’, however would lobby against any such rationality – not only the existing contractors who have spent money on admin and training, but also the body of auditors, and all the specification and standards writers, the trainers, and the consultants and advisors who handhold the business through the certification processes. It’s in the interest of these groups to extend the requirements, possibly including hiring practices or sustainability. Certification becomes expensive, time-consuming and full of fees for ‘professionals’ and a long way away from the basic need to just fill in a hole.
Insightful comment.
We should definitely do as you say.
There is also, though, a question priorities. Until all the potholes are fixed, all MultiKulti outreach efforts and other non-essential council expenditure ought to be terminated.
Have you considered the issue of potholes identifying as Bumps?
I live in a village. We want our parish lengthsman back.
Oddly, all this bureaucracy over filling in holes brings forth exactly the very cowboys to do the job that no householder would ever employ. The road near me has had its potholes filled three times in eight years, and now awaits another load of tarmac sloshed roughly in the same holes
There was a scandal recently over the insulation of homes by registered suppliers, much of whose work was not only shoddy, but significantly below standard. And most of the work had been authorized and passed by council inspectors. Many of these homes are now unsellable. So even government registered suppliers are untrustworthy – as were the building inspectors at Grenfell.
How do we go forward when we cannot even trust our own government?
Aye, but who pays for it? 14 billion just to clear the backlog.
Rather enjoyed reading this.
But really, Poppy : “sandstone Cotswold villages” ! A subtle April Fool’s wind-up ?
Correct. Oolitic limestone in fact.
Really good piece.
Thank you, Poppy, for an acute piece of observation and analysis.
Lovely Poppy thank you. It does seem that English villages offer the only escape from grim national decline. However our Hampshire village is showing signs of creeping and unsettling change… the two over-sized care workers who cram into a little car and drive to administer ‘care’ to the unlucky elderly – in and out in minutes… the reckless drivers from Amazon and Evri…village feuds about the imposition of affordable housing… a new monstrous modern house to spoil the view…houses sitting empty as ordinary families appear unable now to afford four bedroomed homes with large gardens…. But the daffodils are heavenly.
As a native and resident of the north of England, i’ve recently had the opportunity to spend some time in a Hampshire village (not far from Winchester) and the difference in the quality of life was a real eye-opener, gorgeous and welcoming village pub included.
I hope your village survives the travails of what some call “progress”.
Poppy Sowerby is also proving to be an eye-opener. Having mainly written about the latest fads and trends amongst the younger generations (some of which, at least, was interesting) she’s beginning to expand her horizons; ironically enough, by reference to her roots. This article hits quite a few nails on heads.
It really seems like the price of housing is the cause, directly or indirectly, of half of our problems in the West.
Also, what’s with all the empty houses and apartments? NYC, where I live, is full of them.
“the reason potholes are never fixed is a lack of funding and council incompetence, neither of which would be helped by a Reform victory”
More likely, as in America, the reason infrastructure is always starved for attention and funding is that tax money is siphoned off into social engineering instead of civil engineering. In that sense, a Reform victory might well begin to turn the tide.
Fewer than 17% of the UK population live in what can accurately be described as ” rural areas” or villages. Which ever way the inhabitants vote or whatever their opinions are, they will never have as much sway with our politicians as urbanites.
In my rural idyll elections have been cancelled by the Labour national government at the request of the local Conservatives.
The thought of Mosques being built anywhere in England gives me the creeps, but the thought of them being built in the countryside makes me feel angry and very sad.
Yes indeed. Not far from my home is a very pretty, quintessentially English village, or rather it was quintessentially English. A few years ago some farm buildings on the edge of the village became a mosque, so it’s perhaps not surprising that the last census revealed the population of the village to be 25% Asian. Meanwhile, not far away, an old pub deep in the woods has become a Hindu “studies centre”.
But I do live in Slough – 25% white British at the last census – and not far from the London Borough of Hillingdon – 48% white – so perhaps this encroachment, dismaying though it is, is unsurprising.
Read the article: not in the countryside but in a town, like where churches are repaired, sometimes.