(083108 Boston, MA) Andrew Szczurowski, 25 ans, se détend sur son canapé devant son immeuble en attendant son camion de déménagement, dimanche 31 août 2008. Szczurowski a déclaré que son bail se terminait à midi dimanche, même s'il ne pouvait pas emménager dans son nouveau logement avant lundi. Photo du personnel par Angela Rowlings. (Photo par Angela Rowlings/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
Pour les Américains nés dans les années 1980 et au début des années 1990, déménager faisait partie intégrante de l’enfance, un phénomène normal, attendu, et alternativement excitant ou dévastateur. Si votre famille ne déménageait pas, vos amis le faisaient, ou vous vous faisiez des amis avec les nouveaux enfants qui s’inscrivaient dans votre école chaque automne. Pourquoi ? Parce que vos parents étaient des baby-boomers, et les baby-boomers aimaient échanger des maisons et des emplois ; c’était une sorte de manie chez eux.
C’était devenu une seconde nature. Les baby-boomers qui achetaient des maisons dans les années 1980 pouvaient en acheter de plus grandes dans les années 1990, et ceux qui en achetaient dans les années 1990 s’attendaient à acquérir des maisons encore plus grandes dans les années 2000 — ce qu’ils firent, jusqu’en 2006, lorsque les prix de l’immobilier atteignirent leur sommet.
Déménager était ainsi une manière de jouer sur le marché immobilier, mais c’était aussi un moyen de se positionner sur le marché du travail, car l’économie américaine de l’époque était nettement plus hétérogène : différentes régions produisaient des biens différents pour des raisons diverses. La mobilité était un symptôme de la confiance, des valeurs et du savoir-faire de la génération de mes parents.
À Bethlehem, en Pennsylvanie, où j’ai grandi, ainsi que dans la grande vallée de Lehigh, ce phénomène s’est intensifié dans les années 1990. Des dizaines de milliers de nouvelles familles affluaient, non seulement de la région de New York, mais aussi de tout le pays, attirées par une confluence de facteurs : la transition réussie de la région après le déclin de l’industrie lourde ; l’abondance de terres agricoles convertibles en terrains résidentiels ; la présence de nombreux collèges et universités ; et la proximité des grandes villes. Les familles pouvaient déménager en toute confiance, assurées qu’un bon emploi, de solides écoles et des quartiers sûrs les attendaient.
À l’exception des récessions du début des années 1990 et de l’éclatement de la bulle Internet, l’économie semblait superficiellement forte à cette époque. Il semblait qu’il y aurait chaque année un nouvel enfant dans l’équipe de Little League, dont les parents avaient trouvé un emploi chez Air Products — un fournisseur de gaz industriels, qui avait remplacé Bethlehem Steel en tant que plus grand employeur local — ou dans un hôpital régional, un cabinet d’avocats ou une université. Contrairement à aujourd’hui, un marché immobilier robuste et un marché boursier fort étaient directement corrélés à la capacité de construire une vie stable.
La plupart de mes amis vivaient dans de nouveaux quartiers autour de Bethlehem, qui étaient bien plus grands que la maison dans laquelle j’ai grandi. Ma famille, avec le salaire de professeur de mon père, qui nous liait essentiellement à l’État où il recevrait sa pension, n’était pas tout à fait en mesure de participer au luxe de l’amélioration des maisons ou de déménager à travers le pays. Je me souviens avoir implicitement ressenti cette distinction sociale.
L’âge adulte, selon les modèles que mes amis et moi avions autour de nous (nos parents), signifiait quelque chose comme : choisir l’endroit où vous vouliez vivre, puis choisir une maison en fonction de vos moyens. Presque toutes les familles que je connaissais en grandissant, qu’elles vivaient dans des bungalows de deux chambres ou des McMansions de cinq chambres, possédaient leur maison. Et c’était la propriété qui semblait attirer les familles dans la région. Une stase agréable, pas une contingence, était considérée comme normale — une normalité que ma génération supposait légitimement qu’elle allait hériter. C’était un mythe, mais un mythe puissant et universel. Pourquoi d’autre allions-nous à l’école, étudiions-nous, postulions-nous pour des emplois d’été et des stages ? Pourquoi d’autre tournions-nous sur la roue ?
Avant de terminer mes études secondaires, j’ai commencé à observer les premiers signes de mobilité descendante dans les banlieues des années 2000 — ce qui est maintenant connu sous le nom de « choc chinois » a entraîné des pertes d’emplois. J’ai vu les parents de mes amis perdre des emplois de cols blancs et lutter pour les récupérer ; j’ai vu les premiers signes de dépendance aux opioïdes. Mais cela n’a jamais vraiment été discuté ouvertement : les sombres augures de la descente de classe. Que nous le sachions ou non, les enfants des acheteurs grandissaient pour devenir des locataires.
L’ascension sociale, alimentée par l’augmentation des valeurs immobilières, restait cependant l’attente générale. L’idée que tout le monde devrait posséder une maison faisait partie intégrante de la politique électorale américaine, et la propriété immobilière était presque parvenue au statut de droit universel américain. « Nous voulons que tout le monde en Amérique possède sa propre maison », a déclaré George W. Bush en 2004. « C’est ce que nous voulons. C’est une société de propriété. »
La promesse — la rhétorique de cette promesse — d’une société de propriété était l’une des principales raisons, je le soupçonne, pour lesquelles Bush a été réélu deux fois. Ironiquement, ce rêve prendrait fin abruptement en 2007 et 2008, à la fin de son misérable deuxième mandat. Les baby-boomers, ou du moins une grande partie d’entre eux, ont voté pour une politique soutenant leurs priorités économiques — actions, maisons — sans prendre en compte qu’ils épuiseraient le puits dont leurs enfants devraient un jour boire.
J’étais en deuxième année d’université lorsque le marché immobilier s’est effondré, et acheter une maison est devenu catégoriquement plus difficile de manière diffuse, d’une façon que je ne peux qu’évoquer ici (offre réduite, salaires réels en baisse, prix en hausse, reprise inégale, pratiques de prêt plus strictes). Ma génération est entrée sur le marché du travail sans la confiance de nos parents : ce sentiment que nous pouvions demander à nos employeurs, aux entrepreneurs, acheter des maisons pour les revendre, et négocier des déménagements à travers le pays n’a jamais fait partie de notre réalité.
J’ai déménagé à Brooklyn et je me sentais chanceux de vivre à Brooklyn, partageant une chambre en dehors du territoire de gentrification pour 425 $ par mois. Les emplois pour les jeunes, surtout avec des diplômes en sciences humaines, étaient rares, et je pensais que la fille qui vivait dans l’autre chambre de notre appartement seule, et qui avait un emploi d’assistante éditoriale, était riche, comparativement. Chanceuse.
Pour beaucoup de mes amis qui ont grandi dans les exurbs prospères et protégées, le saut de 75 miles jusqu’à New York était cependant un peu trop loin, un peu trop risqué. J’étais assez illusoire pour penser que je pouvais réussir en tant qu’écrivain, mais c’était de la vanité, pas de la raison, qui me poussait vers New York. Après la Grande Récession, l’aversion au risque avait pris tout son sens ; l’aversion au risque était devenue la norme, à l’inverse de l’expansionisme de nos parents.
Aujourd’hui, presque 15 ans plus tard, la plupart de mes amis du lycée vivent soit dans la vallée de Lehigh, soit dans ses environs. Nous ne nous sommes pas répandus, avec une indifférence de type Boomer, à travers le pays. Nous nous sommes retranchés.
Et nous sommes restés ainsi. Aujourd’hui, les Américains déménagent moins que jamais, avec une migration interétatique ayant diminué de moitié par rapport au début des années 1990 (passant d’environ 16 % à 8 %, selon l’Institut Brookings). Selon le New York Times, plus largement, les Américains dans les années 2020 déménagent au rythme le plus bas depuis que le Bureau du recensement a commencé à suivre la mobilité dans les années 1940. Cette tendance est confirmée par d’autres études récentes et par des ressentis partagés.
La mobilité américaine est alimentée par le dynamisme et l’optimisme, la chaleur dégagée par ses moteurs économiques ; elle les entraîne également. Le boom de la mobilité au cours de la seconde moitié du 20e siècle reflétait l’exubérance civilisationnelle et générationnelle ; à son tour, les opportunités d’arbitrage généralisées sur les marchés de l’emploi et du logement ont donné aux familles la confiance économique nécessaire pour croître. Même si la désindustrialisation, le reaganisme et le libre-échange à l’ère Clinton ont tous provoqué différents types de turbulences et de chocs économiques, la mobilité et l’abondance de logements abordables constituaient le grand coussin et l’avantage de l’Amérique. On pourrait dire que la mobilité intra-régionale a remplacé la frontière du 19e siècle : un lieu à la fois imaginatif et réel où les Américains pouvaient aller pour de plus grandes opportunités.
Le déclin de la mobilité au cours de ce siècle, par conséquent, n’a pas seulement eu d’énormes, bien que subtiles, ramifications politiques et sociales, mais reflète différents modes de démoralisation qui sont devenus endémiques à la vie américaine. Cette relation cyclique est peut-être mieux illustrée par la crise des opioïdes dans les régions rurales et post-industrielles du pays : la baisse des valeurs immobilières, la dépression des salaires et l’addiction contribuent tous à une faible mobilité ; la faible mobilité, à son tour, entraîne un désespoir supplémentaire. Si vous n’êtes pas un travailleur cognitif accrédité et élite, vous n’avez pas vraiment l’opportunité d’arbitrage de carrière, ni la capacité de partir. L’addiction aux opioïdes marque à la fois votre condition et l’accélère.
Pour différentes raisons, les jeunes citadins sont également de plus en plus, bien que moins désespérément, piégés — par les dettes universitaires, le loyer, l’inflation, les salaires stagnants et les habitudes consuméristes de leurs parents plus riches. Ils ne bougent pas — et je parle ici d’expérience personnelle — parce que les plaisirs modérés qu’ils ont gagnés dans la grande ville sont trop fragiles, et la marge d’erreur, le risque, est choquante mince (un à deux mois d’économies).
Vu plus largement, parce qu’acheter une maison ou un appartement est trop risqué, les Américains doivent retarder l’achat de leur première maison. Et parce qu’ils retardent cet achat, ils doivent attendre de plus en plus longtemps pour voir la valeur de leur bien augmenter. Et parce qu’ils doivent attendre plus longtemps, ils ont moins d’opportunités de chercher de nouvelles opportunités. En attendant, les baby-boomers continuent d’acheter davantage de maisons.
Il est difficile de s’installer, donc la perspective de se réinstaller devient déstabilisante. Les personnes de mon âge ou plus jeunes, en conséquence, ne se sentent pas avoir assez de marge de manœuvre pour avoir un enfant, encore moins plusieurs enfants — qui les pousseraient à chercher de nouveaux endroits, de nouvelles maisons pour élever leurs familles. Je mets en évidence une relation cyclique entre mobilité et fertilité : avoir une famille pousse les gens à prendre des risques pour de nouveaux endroits, de nouvelles maisons, de nouveaux emplois. Vous n’allez pas abandonner votre studio à Brooklyn à moins d’avoir une raison impérieuse de le faire. Les banlieues ne sont romantiques que lorsqu’elles sont peuplées de jeunes familles. En conséquence, à long terme, un taux de natalité en baisse signifie également, ironiquement, que les valeurs immobilières deviennent moins sécurisées, que les districts scolaires se réduisent, que les emplois diminuent, et que les grandes villes, où il y a encore de l’excitation, sont pleines de jeunes.
Et bien que la perte de ce que nous pourrions appeler la « frontière intérieure » ait clairement une étiologie économique, il existe des facteurs culturels complémentaires qui, je le soupçonne, limiteraient la mobilité américaine même si l’achat de maisons devenait significativement plus facile et moins cher partout. À savoir — bien qu’ils existent encore dans une certaine mesure — les différences régionales ont été atténuées par Internet et le smartphone ; le local a été absorbé par la culture de masse mondialisée. Les Américains ont encore des accents, mais ils ont désormais DraftKings, du porno, des applications de rencontre, des réseaux sociaux, et plus encore : ils ont tous les mêmes algorithmes homogénéisants dans leur cerveau. Et l’IA promet de nous rendre plus semblables que jamais. L’homogénéité, dans une autre ironie, décourage l’hétérogénéité — traverser des régions, des dialectiques, des modes culturels — parce que la récompense, le niveau de différence, est tellement réduit. La seule migration américaine significative dans les années 2020 — des conservateurs des côtes se déplaçant vers le sud — repose sur la recherche de la différence ; mais à part la polarisation politique, à quel point les vies des gens sont-elles réellement différentes lorsqu’elles sont largement médiées par la technopol ?
Les Américains nés après 1980 n’ont pas seulement moins de confiance économique, mais aussi un sens de l’aventure réduit, moins de sentiment que cela fait une différence d’aller quelque part de différent. Bien que les Américains voyagent à l’étranger plus fréquemment qu’auparavant, cela semble plus être un moyen de faire face grâce à la carte de crédit plutôt qu’un bénéfice compensatoire. Vivre trois mois à Mexico avec des économies provenant de ce bon emploi dans la tech qui a pris fin en 2022 est différent de reconstruire plusieurs fois une nouvelle vie dans différentes parties du pays, comme c’était courant dans les années 80 et 90.
La mobilité est une équation en deux parties : la confiance que vous pouvez aller quelque part et la confiance que l’endroit où vous allez en vaut la peine. En termes simples, il n’y a aucun intérêt à déménager si vous allez faire défiler votre téléphone dans une pièce éclairée par des LED, peu importe où vous êtes ; ou si vous serez en appel Zoom pour le travail, peu importe où vous travaillez. Starlink, par exemple, bien qu’il puisse avoir l’avantage louable de permettre aux gens dans des endroits ruraux de communiquer plus facilement et de fournir un accès à des reportages non censurés qui ne seraient pas trouvés à la télévision, menace toujours d’aplatir. La tragédie finale des biens communs matériels pourrait être qu’ils deviennent indiscernables des biens communs numériques. L’âme est la dernière ressource de la communauté, et la dernière ressource à être extraite.
Donc, bien qu’il soit clairement plus difficile, plus frustrant et plus risqué d’acheter une maison décente presque partout dans le pays, et que le coût d’opportunité de se déplacer soit plus élevé qu’il ne l’a été depuis peut-être un siècle, il doit également y avoir un sens à déménager.
Le déclin de la mobilité américaine est en partie un problème économique et politique, et en partie un problème spirituel. Et, comme pour tous les problèmes complexes, il n’y a pas de solutions évidentes. Pourtant, tant d’espoir réside dans l’articulation d’un sentiment de manque, la reconnaissance qu’il manque un prédicat dans la vie américaine contemporaine. Dans un sens profond et historique, le Nouveau Monde représentait un rejet du féodalisme, où les gens et leur travail étaient liés au rayon autour de l’endroit où ils étaient nés. La mobilité est l’expression économique de l’élan sous-jacent qui pousse à s’échapper vers l’horizon. S’il y a une solution, elle pourrait simplement commencer par lever les yeux.





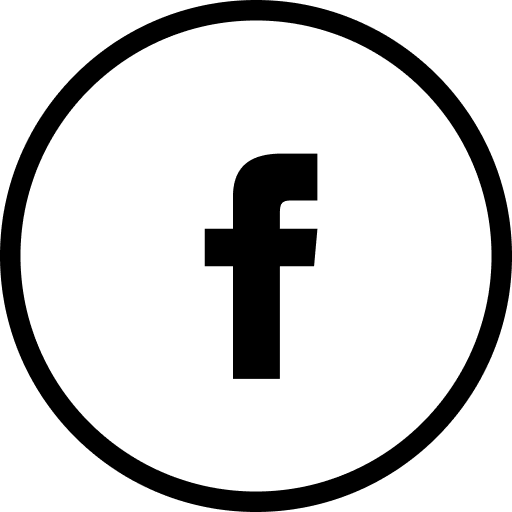
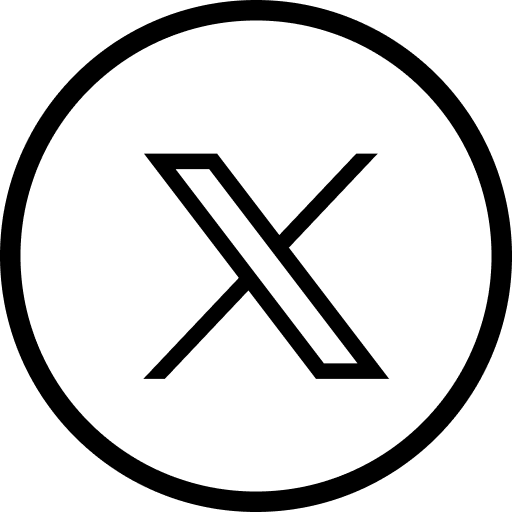
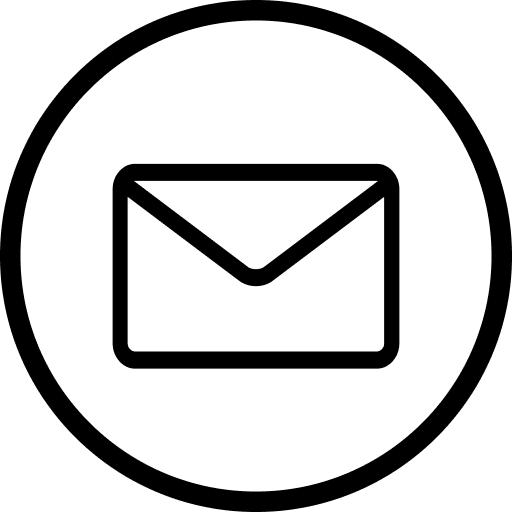
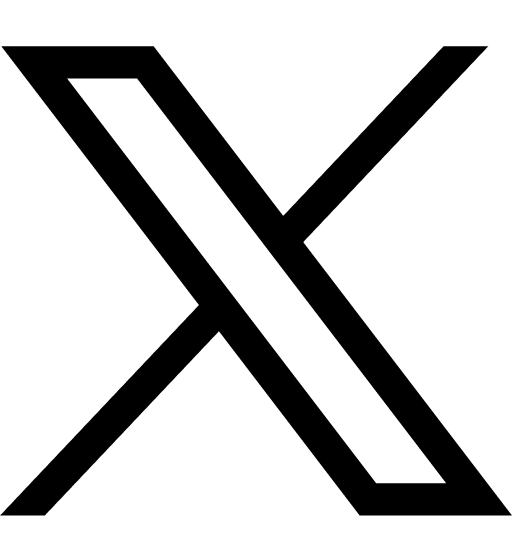
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
SubscribeThe rise of spirituality is both a response to the same questions that humans have personally had for thousands of years, as well as the human corruption too often present in organized religion. We want a spiritual dimension to our existence, but we do not want the packaging of what is on offer.
The Big Bang is very clearly not an answer to “why is there anything at all?” It assumes a super hot, super dense ball of mass-energy that then explodes. So where did that super hot super dense ball come from? Apparently that is not worth discussing because very simply, it is a question that science cannot answer.
There are many in the West these days that are “remembering” that there are many questions that are not suited for scientific inquiry, that science cannot answer.
Yet it is somehow embedded in us to seek for those answers regardless.
Heaven forbid.
As long as Gens Z and Alpha remain atheists or agnostics they will never consider converting to Islam or becoming Jehovah’s Witnesses.
Rather than putting moribund religions on life-support, how about trying something more akin to ancestor worship to fill the spiritual void? At the moment I’m reading ‘In Memory of Memory’ by Maria Stepanova and the author describes days when she was off school and her mum would retrieve the old family photo albums from a cupboard, along with various random trinkets from great-grandparents strewn across time and the Russian empire. After looking at these bearded old men and young schoolgirls in salior suits who later became grannies, a sense of the enormity of it all would overcome her. Surely this is the feeling people are after: a feeling of enormity and depth. And the bonus is that you don’t need to pretend to yourself that you believe something totally incredible.
Another book I read recently was ‘Black Robe’ by Brian Moore about French Catholic missionaries trying to convert the Native American Indians of Canada. The Indians, who already had their ancestor worship, couldn’t grasp what the missionaries were trying to convert them to, and seen from the Indians’ point of view, you could see why. Even the missionaries themselves couldn’t quite believe what they were teaching. You finish the novel feeling that the Indians’ belief that the ghosts of their ancestors constantly guide and interact with them is not nearly so strange as the one peddled by the priests.
After Gen Z, what of Gen Alpha, the ‘New Ones’?
Like Tom Holland has observed, all the young people I know have no knowledge whatsoever of the stories of either Testament. Mention the widow’s mite or the Good Samaritan and they will look blank. Some aren’t even sure where Sweden is.
The phrases from scripture that had passed into common usage by the 19th century, such as ‘the land of Nod’ or ‘Jesus called a little child’, are now never used by Gen Z or Alpha as they would have been by their grandparents.
In an earlier age there was a grander faith. That faith described by John of Revelation is difficult to find even among Christians.
“Some aren’t even sure where Sweden is“. I was unaware that Sweden even featured in the Bible.
I think that’s where Woden lives.
“And now it has been reported that British members of Generation Z — people now in their teens and twenties — are significantly more likely than their parents’ generation to identify as “spiritual”“. There is a world of difference between “indentifying as ‘spiritual'”, and being “Christian” (or indeed embracing any “old” religion). Identifying as spiritual is far more likely to come as a result of a psychedelic drug experience as from visiting a traditional “place of worship”.
Why do I get the impression you’re fervently hoping for your explanation to be true.
I can assure you that I have had plenty of experiences with psychedelics.
Is it religion or it it boundaries and parameters we are talking of here? Most of society prefers order to chaos. Increasingly we are leaning toward the latter. No surprise then that tenet based philosophies are becoming more popular amongst those more exposed and susceptible to the negative and isolating effects of social media et al. That is, the Gen Z of this article.
There’s a god-shaped itch in our society. The young feel this more acutely than older generations and are looking to belief systems for the scratch.
Yes, but the belief systems are not those of their grandparents.
Maybe they are but thankfully it does not seem to take the form of the moralising hypocritical Christianity of yesteryear and parts of the US. If anything it resembles the spiritual seeking of the yogic and Buddhist traditions where mastery of the breath is the prelude to mastery of the mind, the emotions and all desire of which the dopamine hellscape of smartphone addiction is emblematic.
Exactly!
They’ll still feel empty and lost then.
As a British Muslim, I would love it if Christianity is indeed growing amongst young Brits.
A society will eventually decline if it loses its faith. Sooner or later.
Yes, but do you also support the growth of Judaism?
Direct hit!
I support the growth of all religions. But the bloodthirsty sadists of the Likud party do not represent Judaism. Zionism is not Judaism.
Gen Z is turning back to fundamentals across many dimensions. They favour in person connections, they are developing strategies to avoid the dopamine scrolling hellscape of the smartphone, they are more curious than curated by the zeitgeist, and more confident to stand apart. Dogmatism is giving way to pragmatism, and they are more likely to respond than react. And yes, for some, spiritual enquiry is part of the journey. I would say their interest is more in faith than religion, where faith can take many forms.
I have been teaching 350 of them every year since 2020. I like them very much.
Well, organised religion yes. But surely peak consumers of all sorts of half baked cod spirituality of all kinds.
“Cod spirituality”? Surely some chips would be in order too?
Don’t worry, the atheists will be bringing shoulders full of them.
The piece of cod which surpasses all understanding
That made me laugh. Didn’t see it coming. Bravo!
There’s no plaice for that, now.
Could be the great irony of our time is that instead of the long predicted death of the Christian religion we might be witnessing the slow death of the Social Justice religion that it spawned some hundred or so years ago. It has become a commonplace on the intellectual Right to view Social Justice as a shadowy penumbra of the Christian religion that birthed it.
Social Justice, as political project, can be viewed as a kind of egalitarian evangelism – a filleted, rationalised re-imagining of Christianity, stripped of enchantment and its transcendent spiritual dimension. ‘God loves us equally’ becoming ‘this life on this earth must be strictly ‘fair’ to each and every one of us’. Maybe what’s beginning to happen now is that Gen Z is noticing that the Social Justice religion’s great egalitarian project never seems to actually deliver what it promised.
Demographers have been predicting this for almost 20 years now- but it’s great that tangible results like this are starting to come through. The greatest predictor of whether a child grows up to be religious is her parent’s faith, or lack thereof. With the exception of a few African countries, human fertility is falling all across the world. ( An interesting Unherd article published last month by Olympia Campbell called this part of an almost 200 year old trend.) Even if you throw in the moderately religious with unbelievers, birth rates are well below replacement levels. But deeply religious families are immune to this decline, having 5 or 6 children on average. This has been a persistent planet-wide trend for decades now, and is likely going to be quite tranformative for global culture.
Oh well done Unherd. You’ve managed to publish yet another article which ignores Islam. Even when it is about religion!
Or is this writer pretending Islam doesn’t exist in UK like all the other contributors? Just look the other way please.
Or, to give my opinion. Ignore something for so long and then this writer isn’t even aware what he is ignoring.
I think he was talking about spirituality, not rule-following.
He’s talking about the declining belief in the Christian religion.
Well there you go then. It’s not about Islam! You don’t half write some twaddle on here. The other post of yours on here: immortals, mortals etc. what’s that gibberish all about?
Well that is my point exactly. In Unherd nothing is about Islam.
The other post is a bit of very old philosophy.
Nobody except you want every article to be about Islam, Starmer or both. Variety is the spice of life, and we like to discuss other topics that may be happening around the globe
I hope you’re not hoping for Islam to replace Christianity, then we’re all doomed.
You are correct. If 99.99% of UnHerd contributors hate the idea of Islam, worry about what it is doing to the world, believe that it is destructive, etc ….. it is a little gauche not to want to understand more of what it is all about. This is also true of other religions but Islam is perhaps more threatening, or appears so and is certainly in the news. So articles about the spread and power of Islam would be quite important in the world today and UnHerd should see this.
Type the word “Islam” into Unherd’s Search facility, there’s plenty of articles and at least some will match that purpose.
Really, you just keep trying to bolster RL for the sake of it, out of a kind of atavistic sympathy.
I’ve also provided links for him to Unherd articles which he claims don’t exist, which he then ignores by claiming they don’t exist the day after… and the day after…
He has just paid his dues like you. None of us is special and if you think you are – you have a lot to learn.
He might have a particular problem, he might disagree with you, he might think that you have too much wind – but his input is as special as yours, which I think is about getting as many upticks as possible. And that is sad.
Uh-oh, the children are fighting again! And this time its about who is the bigger religious bigot!
On you go, lads, have at it!
I usually ignore you but you have hit the nail on the head.
The submission of the Muslim is, in its theory at least, a mere submission. The submission of the Christian – the person who has a trusted Christ – is also a reception. A reception of Christ into the heart by faith. Not just the house swept and put in order, but now housing a new Resident.
Submission is Islam or surrender, it’s mandatory. Christianity is commission, encouraged to commit but not forced. Judaism is law, follow the laws, or not and don’t participate.
> are significantly more likely than their parents’ generation to identify as “spiritual”.
We start by clarifying spiritual is not religious, and should not be conflated as such, spiritual is a word I generally used by those who want the comfort of something beyond the material but refuse the sacrifice that comes with actually living a religious life, those John the Revelator characterized as neither hot nor cold.
That being said this is hardly surprising Gen Z gets to live in the age where the New Atheism won, where God was regulated out of everything and seen that when you have nothing left they you owe your loyalty to external of yourself everything that holds us together falls apart. It is the ultimate failure of the Marxist dialectical and the failure of the Frankfurt school, if nothing is real or permanent then there is no real impetus to care for my neighbor. Whereas the Christian creed is that we are all children of God with infinite worth and divine potential and that our souls will endure eternally, and when you realize the man you meet on the street is a Divinity, not to mention that your family and loved ones around you are beings with whom you shall likely spend all of eternity. Well that changes quite a bit of how you act and what you do. Your obligation to your posterity becomes greater, your willingness to serve others increases, and your vision becomes much longer than simply having a good time now.
But hey eat drink and be merry for tomorrow we die right?
…and when you realize the man you meet on the street is a Divinity…
“Immortals mortals, mortals immortals, living the death of these, dying the life of those.”
We start… by recognising that humans are spiritual beings, due to consciousness and curiosity with how we came to be here. This was a process beginning many, many millennia before what we’d now term ‘religion’ became recognised, through the development of settled habitation, requiring power structures and the use of language and then text to codify religious beliefs.
It’s possible that some young people are turning to these organised structures, but the general search for meaning beyond “bread alone” doesn’t have to involve either the established religions or indeed, any belief in a deity.
Using terms such as “new atheists” is just falling into the trap of those who seek to monitor the waxing and waning of our spiritual lives by labelling them. It means… nothing: there’s just “atheism”. I’m an a-theist, and i’ll take no lessons from anyone on the value of the human spirit and wonder at the wider universe we inhabit – something we absolutely didn’t understand when codified religions were being developed.
Religion is as old as humanity, as any student of prehistory will tell you.
Religion doesn’t begin with power structures or codification – those arrive later.
e.g. the story of Abraham was transferred from Jewish parents to their children by word of mouth for a whole millennium before scribes wrote it down.
e.g. Jesus was crucified at the instigation of those in the religious power structures.
If there’s no God, there’s no purpose or meaning in the universe, and it’s wishful thinking to imagine there is
“Any student of prehistory”?
Nonsense. Religion is the codification of spirituality. As such, it stretches back only as far as the written word. Humanity itself, and the rise of consciousness, predates writing by tens of thousands of years, probably hundreds of thousands.
The myopia of religionists is, frankly, risible.
Religion began with an oral history, not a written one.
You sound quite desperate to be right. I hope I’m wrong.
Christianity isn’t the only religion that has “life after death” as a belief.
One of the audience in the Unherd talk with Nick Cave and Tom Holland asked, ‘What happens to us after death?’
What does justice demand? What does love demand? Although both were deeply present in what both men said in their talk, neither featured as a response to the question.
Would it be an abomination if every act of love and friendship that has ever been expressed comes to nothing at death, not even to be remembered as a story?
C S Lewis liked to remind people that our view of God is too small. A mouse regarding an elephant and forgetting how small it was.
One might mistake a person risen from the dead as a divinity. Their presence would be as a shock of nuclear heat and arresting as lighting from a blue sky. Flesh filled with the life of Christ. Against that immoveable reality we would be as an ocean wave shivering into a thousand drops against a granite cliff. Our reality would be transient, ephemeral, a momentary pattern in smoke. ‘Life after death’ is a poor thing in comparison.
Divine love without being humanised would be unbearable. Humanised it’s only just.
The beginning is not, alas, ‘spirituality’, whatever that means. Nick Cave’s wife’s simple confession, “My son has died” is in heart-sympathy the same as the simple confession, “Christ has died”. Yes, he has died. Begin with that.
Christianity is the only one that is “life after death” all the others are “death after death”. Repent and Believe and live.
Lots of religions believe in straight up reincarnation.