PARIS, FRANCE - 7 DÉCEMBRE : Le président élu des États-Unis, Donald Trump, rencontre le prince William, prince de Galles, dans la salle Salon Jaune à la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni, le jour des cérémonies de réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, cinq ans et demi après un incendie dévastateur le 7 décembre 2024 à Paris, France. (Photo par Aaron Chown - Pool/Getty Images)
Grandes statues, fanfares, costumes extravagants et défilés militaires : nous, les Britanniques, ne faisons pas ce genre de choses. Depuis 1945, les Européens considèrent tout cela comme de très mauvais goût. Les types de dirigeants qui s’y adonnent sont des tyrans comme le défunt Mouammar Kadhafi, qui se pavanent dans des uniformes militaires ouvragés ou avec des chaînes en or géantes, tout en piétinant leurs peuples misérables. En Grande-Bretagne, même une simple couronne suscite une haine de soi post-impériale.
À la place, nous avons William Windsor, qui se présente au quotidien comme un homme moderne et laïque, le genre de fonctionnaire aimable que l’on pourrait imaginer travailler dans une association caritative de campagne. En observant sa rencontre avec Donald Trump après la réouverture de Notre-Dame à Paris ce week-end, la royauté semblait marcher sur la tête. C’était le leader démocratiquement élu qui se comportait comme un monarque et disait avec grandeur au prince de sang royal qu’il faisait « un excellent travail », tandis que Wills hochait la tête et souriait comme un bureaucrate.
On a longtemps présumé que même ces nations rétrogrades qui continuent de tomber sous le charme de dirigeants autoritaires finiront par voir la supériorité de la démocratie libérale. Et cela explique en partie la panique progressiste hystérique et exagérée à propos du prétendu « fascisme » de Donald Trump. Car simplement en existant et en étant populaire, Trump contredit cet arc supposé de l’univers moral vers un procéduralisme rationnel en costume trois pièces.
Cela doit être frustrant pour les progressistes ; l’arc se plie en leur faveur depuis longtemps. Dans un essai de 1923, Le catholicisme romain et la forme politique, le théoricien politique Carl Schmitt maudissait déjà leur triomphe. À son avis, la « pensée économique-technique » qui le sous-tend — ce que nous appellerions aujourd’hui « managérialisme » — a remplacé un mode de représentation plus ancien et plus ésotérique avec son gouvernement « représentatif » par le biais d’élections et de parlements pour un bien.
Ce qu’il a remplacé, c’est la « représentation » non pas comme un décompte des électeurs mais comme une série de métonymies : des parties qui représentent un tout, comme « quille » pourrait être utilisé métonymiquement en poésie pour désigner le navire entier. Dans ce mode, des figures héréditaires ou nommées se tiennent comme représentants d’« états distincts » — c’est-à-dire des intérêts au sein de la politique globale — tels que le clergé, la noblesse terrienne, les artisans et ainsi de suite. Mais à mesure que nous nous sommes rapprochés de la modernité, Schmitt soutient que cette compréhension du « principe de représentation » a été progressivement perdue, car c’est l’« antithèse de la pensée économique-technique dominante aujourd’hui ».
Mais si ce cas semblait désespéré pour Schmitt, quelque chose a changé. Quelles que soient les politiques officielles sur la table, l’élection présidentielle américaine de 2024 a opposé l’esprit de la « pensée économique-technique » à celui de la « représentation » dans le sens que Schmitt décrit. Réfléchissons à cela : les opposants de Trump ont offert ce qui était alors très clairement un régime managérial auto-propulsé, dont la capacité à fonctionner entièrement en pilote automatique a été révélée lorsque son prétendu leader est devenu si sénile que sa démence ne pouvait plus être cachée.
Face à cela, deux des images les plus emblématiques de sa campagne présidentielle — Trump « travaillant » chez McDonalds et Trump dans un camion à ordures — le montrent déployant le vocabulaire de la représentation comme métonymie : Trump s’y tient comme un représentant partiel pour des classes entières (ou, comme le monde médiéval l’aurait dit, des « états ») de l’électorat américain, en particulier dans des emplois moins bien rémunérés et subalternes.
Et bien qu’il y ait eu des discussions sur Joe Rogan et l’écosystème des podcasts, c’est l’une des façons les moins bien comprises dont la révolution numérique a aidé à gagner l’élection pour Trump. Comme les lecteurs contemporains du grand théoricien des médias du 20e siècle Marshall McLuhan aiment à l’affirmer, « le numérique réutilise le médiéval ». Selon la théorie de McLuhan, le passage à une nouvelle technologie réutilisera souvent des formes ou des idées sociales plus anciennes que la technologie précédente semblait avoir rendues obsolètes. Les McLuhanistes contemporains soutiennent que le passage d’un environnement d’information basé sur l’imprimé à un environnement numérique a rouvert l’espace pour des normes et des pratiques culturelles qui étaient courantes au Moyen Âge, mais que les amateurs de « l’arc de l’histoire » en sont venus à considérer comme des reliques du passé.
Par exemple, les médias numériques produisent de manière fiable des concentrations de richesse et de pouvoir néo-féodales de plus en plus importantes, ce qui permet à son tour l’émergence d’une nouvelle classe de seigneurs et de princes. La même révolution a récupéré l’expérience médiévale des signes et symboles comme une langue vivante, sous la forme de mèmes. Et Trump n’est en aucun cas le seul leader politique à avoir compris le pouvoir du numérique pour récupérer la légitimité politique dans un registre qui ressemble beaucoup plus à celui que Schmitt décrit qu’à la « pensée économique-technique » qu’il a dénoncée.
Si Trump fait cela instinctivement, peut-être que le communicateur le plus habile dans ce registre est le leader du Salvador, Nayyib Bukele. Bukele (ou son équipe de réseaux sociaux) est très actif en ligne, au courant des mèmes anglophones et habile dans sa présence numérique. Son compte X combine des retweets de blagues de grenouilles, des annonces d’État conventionnelles et des montages du Petit Âge Sombre des forces armées du Salvador avec des visuels intimes et picturaux tels que celui-ci, apparemment calculés pour transmettre un sentiment de royauté parmi son peuple éclairé comme par la grâce de Dieu.
Quant à Trump, ayant sécurisé son élection au moins en partie grâce à son instinct pour la représentation médiévale médiée par Internet, il préside maintenant un tribunal de facto que ses détracteurs dénoncent comme marqué par un caractère monarchique : il a choisi des favoris, accueilli des pétitionnaires et des flatteurs et monté les courtisans les uns contre les autres. Henry VIII était apparemment tour à tour charmant, volatile, généreux et mercuriel, et toujours complètement confiant de son droit au pouvoir. Et quand j’essaie d’imaginer la vie dans sa cour, cela ressemble beaucoup plus à celle de Donald Trump qu’à l’élégant, contrôlé et formellement impuissant William.
Et tout comme un monarque médiéval, Trump choisit son cercle intime parmi les véritables seigneurs et princes du royaume. Cela a toujours été une considération pragmatique pour un monarque : comment garder les plus puissants de votre nation suffisamment proches pour qu’ils soient de votre côté, mais pas si proches qu’ils essaient de vous déposer ? En conséquence, Trump a déjà nommé assez de milliardaires dans son cabinet pour former une équipe de football. En effet, si nous étions au 13e siècle plutôt qu’au 21e, ces notables auraient probablement déjà reçu honneurs et titres. En l’état, les Américains ne fonctionnent pas vraiment comme ça ; mais peut-être que la célébrité par prénom, plus une proximité sérieuse avec le noyau nucléaire de l’empire, est l’équivalent du 21e siècle. (Elon était aussi à Notre-Dame.)
Mais bien que, d’une certaine manière, la plupart de cela ne soit qu’une inflexion différente des normes démocratiques existantes, ce qui est distinctif dans la « représentation » à l’ère numérique, c’est que vous gagnez en légitimité grâce à une affection sincère entre les gens et le leader — et cela est difficile à feindre. Comme en témoignent les politiciens méprisants, de « Bigotgate » de Gordon Brown à l’explosion migratoire de Boriswave, il est assez facile au Royaume-Uni d’être élu représentant parlementaire, via des « circonscriptions sûres » et la machine du parti, sans toutefois ressentir d’affection particulière pour ou d’affinité avec les personnes que vous représentez. Mais pour les leaders qui sont exposés en ligne, c’est presque impossible à dissimuler. Les gens ordinaires sont peut-être occupés, mais ils ne sont pas stupides : ils identifieront rapidement un représentant qui les méprise, en tiendront compte et les haïront pour cela.
L’affection sincère, en revanche, couvrira une multitude de défauts : une bénédiction pour Trump, qui n’en manque pas. Et pourtant, il a un amour clair pour l’Amérique et les Américains, évident dans la façon dont il peut poser dans un camion à ordures, un tablier de McDonald’s ou une photo de police et avoir l’air imposant, plutôt que mis en scène. Il pourrait donc s’avérer être un terrible leader ; mais il est néanmoins une antithèse puissante à l’ordre « de pensée économique-technique » sans tête et sans visage, non pas en dépit de, mais à cause de sa personnalité. Il en va de même pour Bukele : il est clair, dans la façon dont il parle aux gens du Salvador et d’eux, qu’il les considère comme une continuation de lui-même.
En revanche, il est difficile d’imaginer Starmer se montrer chaleureux et affectueux envers les Britanniques ordinaires ; il émane généralement de lui quelque chose de plus proche d’une peur et d’un dégoût étroitement contrôlés. Quant à William Windsor, je n’ai aucune raison de ne pas croire qu’il ressent une certaine affection pour le peuple britannique. Mais la question reste ouverte de savoir s’il nous représenterait jamais dans ce sens. Après tout, toute sa dynastie, et son mode de royauté, n’ont vu le jour qu’après que le dernier monarque absolu de Grande-Bretagne ait été déposé en 1688. La « monarchie constitutionnelle » qui l’a remplacée a toujours su qu’elle était dénuée de mordant, davantage une solution qui convenait à un pays de plus en plus mercantiliste et qui a bien servi la Grande-Bretagne pendant plusieurs siècles.
Pour les mêmes raisons historiques profondément ancrées, je pense que la Grande-Bretagne devra se lasser considérablement plus de notre classe dirigeante managériale que nous ne le sommes même aujourd’hui, avant que nous ne soyons prêts à revisiter le registre monarchique d’avant 1688 de manière plus sérieuse que le style pantomime de Farage. Mais il n’y a aucune raison de croire que la légitimité politique coule toujours et pour toujours par les mêmes canaux. Et il est clair que quelque chose de beaucoup plus proche de la version médiévale réémerge maintenant, à l’ère d’Internet, pour défier le managérialisme que Carl Schmitt a si vivement décrit et que l’on déteste viscéralement. Alors peut-être qu’il y a encore de l’espoir pour nous ; j’aimerais croire que la mort politique assistée par le starmerisme n’est pas une fin inévitable pour la Grande-Bretagne.
Ainsi, en ce sens, peut-être que la restauration et la réouverture de Notre-Dame servent effectivement de signe. Non pas d’un effondrement moral, mais d’une récupération de formes plus anciennes que nous pensions réduites en cendres. À la fois anciennes et entièrement nouvelles, telles une cathédrale médiévale restaurée, détruite puis restaurée, qui se dresse comme un représentant approprié pour la restauration de la représentation médiévale. Je m’attends à ce qu’aucun d’entre nous n’aime l’ensemble de ce développement ; mais le managérialisme auquel il s’oppose est un sépulcre. Qu’il soit vaincu par sa nouvelle antithèse ancienne, et à sa place, vive les nouveaux rois.





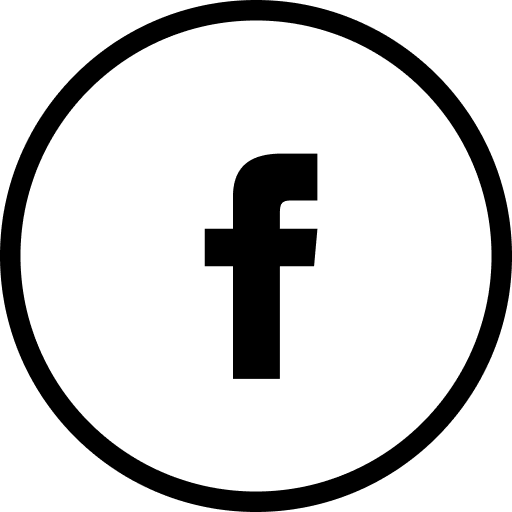
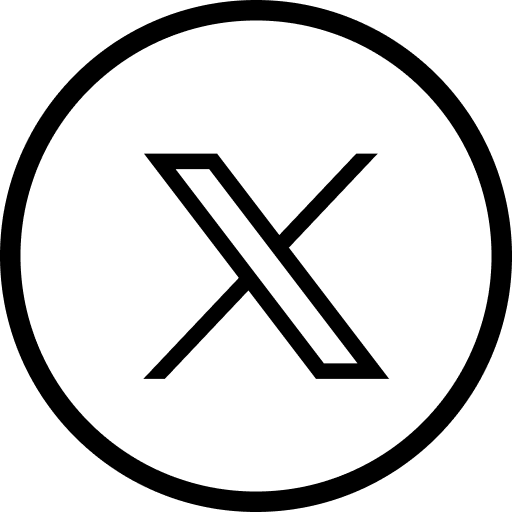
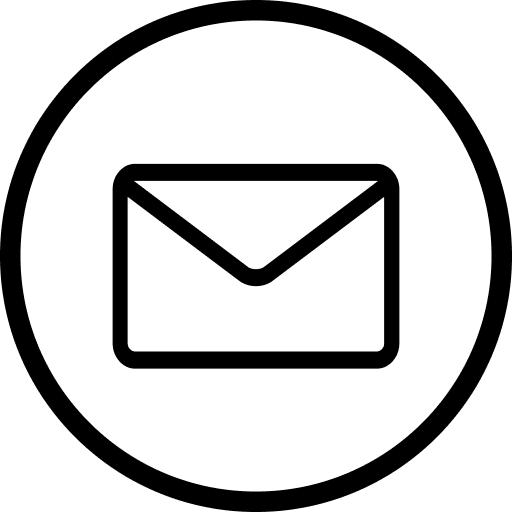
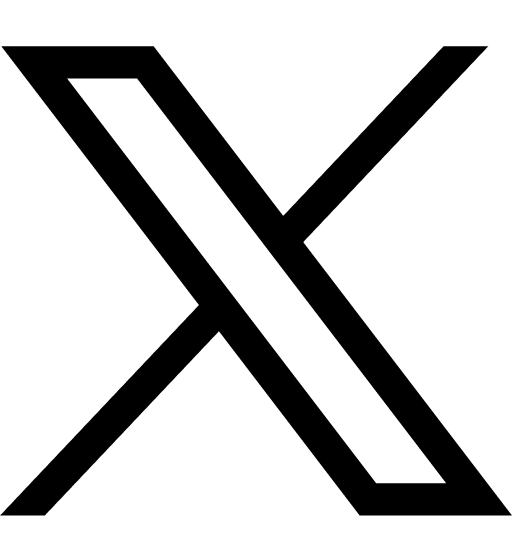
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
SubscribeGreat article. Much truth in a few words. Having waded through some of Unherd’s recent offerings relating to post-liberalism, I would recommend those authors read this article for a lesson in clarity if nothing else.
Agree completely.
The questions is – where do we go from here? Liberal left journalists do have power to shape opinions, like it or not, and do sometimes write cogent, informative articles. It would be good to acknowledge the good at the same time as raising the genuine concerns in this article.
There is a nice watermark in the United States for when the “Left” veered full speed ahead into narcissistic elitism, corporate ass kissing, and identity politics. It was the Occupy Wall Street Protests. See, a funny thing happened after Occupy, discussions of class magically vanished. You know I seem to recall when discussions of class were central to the Left’s view of the world. Oh well. Then about the same time identity politics and wokeness went full throttle. “Repent for ye are racist! Oh and we have a few other ‘ists’ as well to call you.” Now those who call themselves the “Left” in America sing the praises of globalization, megacorporations, and the security state while pretending class does not exist and rich white people are lecturing working class whites on their “privilege”.
Yes Matt. Whilst the elites put their bigotry to work via slavery and low wages, the poor white folks mixed with befriended and married people from all over the world. That mix was the working class and yet we are to believe it was the working class who were racists.
An accurate and insightful comment.
Absolutely nailed it. I have also wondered why those who live alongside and with immigrants and people of colour are painted as awful racists whilst those who do not are somehow on the moral high ground and in a position to finger wag. Good too know I’m not alone in noticing this.
Odd, reading an article from the center Right, it was like reading something illicit, or all wrong – it happens so rarely – and we spot the ‘Trigger Words, like ‘Never Trumpers’ and wait for the crashing attack, but it did not happen.
And so – we finally have a writer on the Right, then I wonder if she can tell us WHY all these Billionaires and heads of Corporations, Hedge Funds, Banking and Finance, Media Moguls, Tech Billionaires, Central Bank Heads, IMF, Davos folk, Political Donor class, and so on, Want a hard Left Socialism? They know it will make the economy a disaster, they know it will cause every kind of problem, and result in the loss of all freedom.
So, what are they up to?
A very good question! I suspect, like the aristocracy of old (maybe not so old) they live in their own bubble (left or right) where us lesser people simply do not figure as people at all. Their peers make up their world, the rest of us mere consumables.
Left and Right is a little confusing and definitely a matter of opinion. You will remember our journal, The New Statesman. On UnHerd I once called that journal Left but had a lot of indignant replies from people who insisted it was not Left.
It’s a good question. I think it may be because you need to be pretty rich in the first place to be able to afford to vote for the left. If you are uber-rich there is no consequence to you of doing so; your money rents you insulation from it all. You have private security on your own gated estate while you are defunding the police who protect the poor, for example.
The upper strata of the charity, public sector and grievance industry are well enough paid that they can ape their economic betters, so they do, because they imagine it confers status to do so.
Could it be that if the dog wants a bone then let him have it – and in the meantime it’s business as usual?
I don’t think that they do want socialism; in fact, I’m not even sure that the “progressive left” are socialist. What you do get from your virtue signing though is a way of aligning yourself with the elite and, more importantly, distancing yourself from the hoi poloi – I am educated, I am anti-racist etc. In otherwords, I might be one of the rich elite class, but I’m better than you, and I can prove it by my Tweets,therefore I deserve my status
Yes this! It’s like a new way of signalling your status. Like it used to be to have a tan, or not to have one.
The Billionaires don’t want real “soak the rich” socialism they want controlled constrained fake socialism. They want to be able to steer it. AOC swanning around in her ball gown at a US$35,000 a head charity function is what they want, just as Adolf Hitler’s rich industrialist backers wanted German National Socialism rather than red in tooth an claw Communism. It didn’t work out too well for them overall but despite the disaster of WW2 most of the families involved remain pretty rich. They just thought they would have more control than they in fact got.
Yes, the likes of Hugo Boss, Siemens, Kodak, VW, Coca Cola ad nauseum participated fully in slavery, murder, and all manner of atrocities, hiding behind a veneer of apology in order to retain profits and power. Dispicable yet the masses ignore the horrors as if it doesn’t matter! I don’t know which is worse.
They don’t want hard Left Socialism. They want fascism with its union of state and corporate power. (cf. Facebook and Twitter censoring anti-Biden news in the run-up to the last US Presidential election). Loss of freedom for everyone but them and their allies inside government is the whole point.
Good point, I think you may be right here. Also good to have someone who knows what fascism is.
I doubt that Billionaires all want the same thing – their path to being a billionaire is either birth or an ability coupled with being in the right place at the right time and determination. It would be odd if they were all equally political and even odder if they all had the same political objectives.
They DON’T want a socialist society, the virtue signalling helps distract from that! Neither by the way is modern China any sort of socialist society. That is not to say socialism would be a good thing, but the great majority of nations are not becoming, in any meaningful way, more socialist. If they were we would see the expropriation of some of these multi-billionaires etc.
Group think and cowardice have a lot to do with it. As the writer says, over 90% of journalists have been through university. As has been pointed out previously it would be more reliable to rename universities indoctrination centres.
I’m from a working class area in the north of England. When I arrived in London in the late 70s I started to make friends amongst the middle and upper classes and was shocked by the openly derogatory attitude several held for the ‘lazy’ English working class. The fact that, until recent years, that ‘lazy’ group of people had been their skivvies and a general source of low paid labour was lost to them.
I’ve experienced similar snobbery and condescension.
Maybe both see each other as useful idiots in their quest for world domination, each thinking the other can be discarded when their usefulness runs out.
You can get an inside view of the political machinations within the New York Times listening to Bari Weiss being interviewed by Jordan Peterson.
It was deplorable that Hillary Clinton was made Chancellor of Belfast University. Why do failed politicians keep getting recycled?
Because their disposal by normal means will block the drains and pollute the political environment?
Because academia is highly political and Clinton is exactly what they love most.
This was an interesting piece in an open, clear, unpretentious style. As a member of the bluecollar demographic, my exclusion from the political conversation began, pretty much, with Tony Blair. I just couldn’t relate to him. The labour party seems to represent Gaurdian readers, students and the middle class, (and now the woke brigade).
The BBC, three quarters of Parliament and most of the media were anti Brexit, I felt completely unrepresented. Paul Embery, GB News and UnHerd have at last provided some hope.
Thankyou.
The idea that people voting for Trump and not Hillary was racism, what Van Jones called “a whitelash”, was always utterly bizarre. Hillary Clinton isn’t black.
Whilst not a trump supporter myself (not American wasn’t up to me anyway), when presented with two evils maybe people chose to give the lesser a go. As an outsider they both seemed appalling, more so perhaps because most American presidents, when viewed from without, seemed to be far more serious.
That’s why I voted for Trump.
In your place I might have done so too, I make a point of always voting against entrenched cliques of power. He did seem a little unhinged, but looking to my own country, and the rest of Europe, I do not feel our electorate is in a position to judge other electorates from anything other than equal positions of moral turpitude, or perhaps exasperation at the general state of (un)civic responsibility.
Funny, ‘the poor’ are fetishised by liberal saviours lamenting their situation. Yet when the poor vote for Trump they suddenly become the ‘basket of deplorables’ who don’t know what they’re voting for
Yep.
Being in Chicago, USA, I’m always late to the conversation on these articles and I respond for cathartic reasons only. We are being gaslighted by our media today in so many ways. The main violation is when articles, commenters and leftist politicians scream from the top of their lungs that the right side of the aisle wants to destroy democracy! The only ones I see that are actually doing something to destroy democracy is the left.
In his 1970 blueprint for communist takeover of America, “Rules For Radicals”,
Chicago communist Saul Alinsky listed accusing conservatives of subverting the country, while the Left actually does that,
as an effective technique for confusing
the opposition.
There is a third, competing explanation for Trump’s win (though it together with those offered in the article surely combine to give a fuller picture): people voted against Hillary Clinton because she was known to be corrupt in ways that directly mattered to governance (the Clinton Foundation as a conduit for foreign influence buying) and symbolized the corruption of the within-government portion of the ruling class with her free pass on mishandling classified information (no, the statute on negligent handling of classified information does not contain a mens rea clause, but it was a mens rea principle that FBI Director Comey appealed to in not investigating what was at best negligent handling of classified information, and at worst deliberate misuse). And yes, Trump showed every sign of corruption, too, but it was the sort of almost working-class corruption one expects in the property developement business, not the sort that represents misrule, and thus the anti-Clinton share of his vote was willing to discount it.
I suspect the ranking of these in influence on Trump’s share of the vote, was economic anxiety, Clinton corruption, with racism (if one really uses the word with its denotation in standard English, rather than the expansive version found in the Left’s real-world analogue of Newspeak) present, but a very distant third.
Excellent explanation.
I just thought Clinton represented ‘more of the same’ and ‘disdain for patriotic rural Americans’
“- the streets were teeming with working-class Americans who had been cast out of the comforts enjoyed by the obscenely wealthy industrialists.” This, in reference to the Gilded Age.
There are quite a few things wrong with that sentence from the article. One, the streets were often teeming not with the ordinary working Americans but with immigrants, new arrivals in the New World. In the late 1800s, America was still mostly rural, even if more Americans were working for an employer than for themselves by that time. Perhaps some streets were teeming briefly with working-class Americans when their work day was beginning or ending. The new Americans probably had to work very close to where they lived: in the crowded slums of the big cities. The only time Americans away from work were teeming the streets was probably when there was a big parade or demonstration, such as July 4th: and you might say then that the streets were teeming with excitement.
Where was I? Oh yeah, number two. What, cast out of the comforts enjoyed by the obscenely, horrendously, horrifically wealthy industrialists? What comforts were those? Perhaps when Prohibition came, the working class did not have the quality and quantity of liquor the wealthy may have been still able to acquire.
And three. And what of those industrialists? Many of whom may well have known poverty when they were children? Although not born in America, Andrew Carnegie, who had emigrated to America when he was twelve and made his fortune in steel, in the late 1800s, became a philanthropist. The Carnegie libraries around the world are one example of his legacy.
A very good and interesting article, by the way.
Spent many days in the Nashville Carnegie library. Always been grateful to him for it.
Ironic how you’ve really got the pulse of why the journalist class is so insufferable. But then you kind of blow it by dropping in the obligatory
This is a lie perpetuated by the journos you just derided. They use anecdotal incidents and half-baked statistics that aren’t adjusted for a myriad of other factors to widen the race divide which fattens their pockets. It’s just simply wrong.
The police use more deadly force against white, both in absolute numbers, and in terms of their contribution to crime in our society.
1,000 people killed by police every year (including justified uses of force—and I use that term lightly because I’m not a big fan of police)
About 50% are white.
About 25% are black.
Of this 1000, last year about 50 were unarmed. Just over 10 of those unarmed were black.
13% of the population are black, but blacks commit at least 50% of murders and other violent crimes, and in some cities 66% of all violent crimes. The overwhelming majority of the victims are black.
Nationwide, blacks are 6x more likely to be murdered than whites, in some cities like Milwaukee, it’s double that. Around 95% of these murders are committed by the black community.
The weekend the Floyd protests and riots were kicking off nationwide, 92 people were shot and 27 killed in Chicago alone.
I’m not saying police don’t need improvement, but here’s a list of things that have a higher rate of death per 100,000, many of these things which affect blacks disproportionately, but get a tiny fraction of the attention:
193—Heart disease
186—Cancer
46—Lung disease
43—random accident
42—Stroke
29—Alzheimer’s
24—Diabetes
17—Flu
15—Overdose
13—Suicide
12—Car accident
8—Parkinson’s
2—HIV
1.8—Encountering a cop
It just blows my mind how people purporting to care about POC will do everything they can to avoid addressing real issues, and then hyperfocus on something as minuscule as “police brutality”.
Excellent catch, Jordan – I was hoping someone would focus on that obligatory line about the “scourge” of police brutality!!
Brilliant. It’s one of the bizarre turnarounds of our time: you hear more about the working class and the poor from ‘right-wing’ sources like Quillette and some in the Conservative Party than from the left.
Excellent article, thanks.
Once upon a time The New York Times was so woke that it hired a journalism student from a, Mon Dieu, public uni. This student was so brilliant, and his stories were so good, that he was put on the fast track and had a meteoric rise at The Times. As noted, he was not from the best private uni and he was not even a college graduate–yet work was so epic that The Times didn’t wait–how could they afford to lose this treasure?
Still with me? Jason Blair. Serial fabricator/plagiarizer. Hired/promoted/protected/admired simply because he was black. Positive discrimination at its best.
This took place in the early 2000s. Perhaps as a result of this, journalism became even more woke advocacy and less journalism, yielding the endless propaganda of The Times today, even on the news side.
His book Burning Down My Masters’ House is an expose of how he was hard done at The Times.
I receive the NYT and WaPo stories via their free daily snippets and use my local library to read stories of interest but not that many. I pay for my local newspaper for news the local TV will never cover and each year it’s become more expensive now at a cost beyond the means of many. I now watch Fox and CBS for TV news, the others are too biased to accept anymore. I enjoy the longer material from Substack writers – some free, some not. But I am retired and have the time but the majority are too busy and catch only bits from TV, priced out of newspapers. They might look at FB to see what’s new and skim headlines. Those penny papers seem still useful but unable to compete anymore in reaching the masses. Leaves a lot of frustrated people out there.
I understand that you may watch Fox News to get another point of view, but to say (or imply) that it is not biased rather bewilders me – it is biased even if it is biased in the way you may want it to be. It is so easy for people on all parts of the political spectrum to assume that because some news outlet produces copy that one agrees with it’s not biased; one needs to read/watch/listen to different outlets to get anything nearing a complete picture, and even then there will be a lot of holes.
Fair comment.
I read Hardee’s comment completely differently. He said the others are ‘too biased’, not ‘biased’. The implication is that Fox is biased but not as much as most of the others.
Dickens left education by the age of fifteen and by that time had learnt enough English to become a greater writer, including being a journalist. So why does journalism now need a degree ? Is it the decline in education ?
Yes but (for journalists) the Left Wing indocrination also takes longer than it used too.
I’ve been reading the American press for years, and subscribing to the Washington Post, so I can get insights on our major influencers, and it’s astonishing the level of bigotry expressed in the articles and the comments against anyone they don’t agree with.
It just astounds me that these people, who think they’re liberals, lack the self awareness to realise their own narrow outlook is prejudiced. And it helps me understand why, in desperation for someone who might speak for them, that working class Americans of all ‘stripes’ voted for Trump.
I rather think that the author’s use of the Brahmin / Indian caste system metaphor is a good one , and to some extant many of the views expressed above are over-thinking the situation. It appears to me that the Left/haves are mer ely creating a western caste system – which is what all humans attempt to do – as well as pretty much all birds and animals. In reality HUMANS ARE JUST PRIMITVE CREATURES ACTING OUT THEIR PRIMITIVE DRIVES -as they have always done. The simplest explanation is usually the truest-we are merely higher functioning chimps and all the rest is surface verbiage…. As to what to do about that ?? maybe just go thru life as if humans have had another 1000yrs of cultural/spiritual evolution behind them and dont be constantly shocked at their primitiveness in the “present’ – damned hard tho !
Thank you Batyua for being courageous and honest! The truth is spoken – a remarkable event. “the racial moral panic obscures — and therefore perpetuates — the real divide separating America” – so true and amoral.
Yes, journalism was generally a career for people who didn’t go to ‘Uni’ but who worked their way through the trade, first at local level and then maybe onto the nationals, although this was not a necessity as there were many good-quality local papers where a good living could be made. Indeed ‘The Press’ in general was staffed by working-class printers, compositors, readers, revisers and many semi-skilled literate non-graduates who were rich in accumulated knowledge, skill and experience. Now what remains of the fourth estate is staffed almost exclusively by middle-class university-educated social justice activists. Another victory for equity and diversity.
Journalism degrees…hmm. Attending universities drenched in wokeness. Is it any wonder we are churning out same-thinking scribblers?
I’m afraid that my idea of a journalist is someone who has to write something against a deadline. It is human nature to make that ‘something’ easy to swallow for the bosses and the readers – the same old, same old…
Now that journalists are in the higher echelons of life, they have nothing to fight for from their own point of view. Why fight when you still get paid for not fighting?
The article above, naturally, tries to show journalists as special people, perhaps the conscience of society. Maybe this was true in Mencken’s time but why should it be true today?
My brother-in-law used to be a journalist (on a large national paper) and he once said that the editor’s advice to a new journalist was:- make it short, make it quick, make it up. I think that he was only half-joking
Many thanks, Batya Ungar-Sargon, for a great article. There has been some transitioning from the ultra-hypocritical time when they pretended that their journalism was supporting the “downtrodden masses” (whilst actually being proto-woke) to the situation today.
Many thanks, Batya Ungar-Sargon, for a great article. There has been some transitioning from the ultra-hypocritical time when they pretended that their journalism was supporting the “downtrodden masses” (whilst actually being proto-woke) to the situation today.
An excellent snapshot of how journalism has changed since the beginning of the 20th century, Batya.
During the 60s and 70s I worked as a newspaper reporter and editor for the Bangor Daily news, when it was the largest circulation newspaper north of Boston.
Our newsroom was truly diverse, by which I mean our managing editor did not hire reporters based on skin color, or gender, or “journalism” degrees.
To the left of my desk was a young women with a masters degree, albeit not in journalism. And no, she was not a fashion reporter. Her ability to create compelling and well constructed news stories was second to none in our newsroom.
I worked with several talented reporters who never finished high school. There were a number of reporters and editors like me, who never received a university degree. About 10 of the reporters and editors were veterans of the Korean conflict or World War II.
I was discharged from the Air Force in Bangor, ME.
The military generously allowed me to accumulate just shy of a hundred credit hours from the University of Maryland’s program that sent professors overseas.
I wanted to further my education at the University of Maine, but needed a job to fully support my goal.
At the time, I had no idea what a copy boy did at a newspaper, but decided to find out. The city editor interviewed me, and within a short time he offered me a job as an apprentice reporter.
He was more impressed by my ability to type 70+ words per minute on a clunky manual Remington than the college credits I’d accumulated during my four year enlistment.
The senior editors consistently red lined most of my reporting until my young brain learned to keep my own opinions to myself.
My career as a reporter and editor ended in the late 70s when I noticed every young reporter wanted to be called a journalist, and insisted that their greatest goal was to get a U.S. president impeached.
My wife looked over my long retired shoulder to see what I was reading, and then and went to her own computer to order your book for me from her Amazon account.
She is a most observant lady.
-30-
An excellent snapshot of how journalism has changed since the beginning of the 20th century, Batya.
During the 60s and 70s I worked as a newspaper reporter and editor for the Bangor Daily news, when it was the largest circulation newspaper north of Boston.
Our newsroom was truly diverse, by which I mean our managing editor did not hire reporters based on skin color, or gender, or “journalism” degrees.
To the left of my desk was a young women with a masters degree, albeit not in journalism. And no, she was not a fashion reporter. Her ability to create compelling and well constructed news stories was second to none in our newsroom.
I worked with several talented reporters who never finished high school. There were a number of reporters and editors like me, who never received a university degree. About 10 of the reporters and editors were veterans of the Korean conflict or World War II.
I was discharged from the Air Force in Bangor, ME.
The military generously allowed me to accumulate just shy of a hundred credit hours from the University of Maryland’s program that sent professors overseas.
I wanted to further my education at the University of Maine, but needed a job to fully support my goal.
At the time, I had no idea what a copy boy did at a newspaper, but decided to find out. The city editor interviewed me, and within a short time he offered me a job as an apprentice reporter.
He was more impressed by my ability to type 70+ words per minute on a clunky manual Remington than the college credits I’d accumulated during my four year enlistment.
The senior editors consistently red lined most of my reporting until my young brain learned to keep my own opinions to myself.
My career as a reporter and editor ended in the late 70s when I noticed every young reporter wanted to be called a journalist, and insisted that their greatest goal was to get a U.S. president impeached.
My wife looked over my long retired shoulder to see what I was reading, and then and went to her own computer to order your book for me from her Amazon account.
She is a most observant lady.
-30-
“We are only limited by our inability to imagine”
~ Lloyd Byler, circa year 2014
As long as the mass media can come up with meme ideas, their dominance, and thus their profits will continue.. if they start losing money, Congress will bail them out… bailing the media out will only continue as long as Congress can give give fancy names to their bills they pass.
.. and so on.. and on… and on…
Hmm… I agree with the political objectification of the poor. I don’t know about the evils of globalization and capitalism, though. Are you quite sure that globalization was all bad for everyone except the upper crusties? And what should everyone have done instead of globalized capitalism?