Pauvre vieux Jimmy Carter. Getty images
Pauvre vieux Jimmy Carter. L’homme le plus décent à avoir été président des États-Unis, mais avec un air irrévocable de malchance. Ses admirateurs, à juste titre — et avec un sérieux qui imite leur héros — célèbrent sa carrière post-présidentielle de quatre décennies, au cours de laquelle il a remporté un prix Nobel pour son travail visant à rassembler des parties en guerre et a presque totalement éliminé les vers de Guinée. Il n’y a rien de sordide chez Carter — aucune tache de corruption personnelle, aucun effort sordide après la présidence pour s’enrichir, aucun siège au conseil d’administration d’une compagnie pétrolière, aucun polissage vaniteux de son propre héritage. Personne ne devient président sans ambition et une certaine estime de soi, pourtant l’ascension politique de Carter était manifestement une extension de son dévouement de toute une vie en tant qu’enseignant d’école du dimanche : une recherche de moyens pour rendre le monde plus juste et plus heureux.
Il y a même un mouvement pour réévaluer son seul mandat en tant que président. Éjecté de ses fonctions en 1981 avec des sondages désastreux, l’économie en désordre, et son parti en guerre avec lui-même, ses années à la Maison Blanche sont désormais présentées par ses fans libéraux comme un triomphe d’une politique prévoyante avec un héritage étonnamment durable. Le distingué journaliste politique Jonathan Alter a salué les « réalisations domestiques visionnaires » de Carter. Il a nommé plus de juges femmes que tous ses prédécesseurs réunis (bien que, de manière pathétique, il soit le seul président à avoir servi un mandat complet sans pouvoir nommer un juge à la Cour suprême). Quinze lois environnementales ont été adoptées sous la surveillance de Carter, doublant la taille des parcs nationaux et fournissant des subventions pour l’énergie verte. Il aimait se considérer comme un scientifique (exagérant parfois sa formation d’officier de marine pour se décrire comme un « ingénieur nucléaire ») et reconnaissait l’impact des combustibles fossiles sur le climat. Il a même installé des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche (le président Reagan les a fait enlever, expédiant l’un des panneaux à la bibliothèque Carter, ce qui semble être un acte de trolling plutôt ciblé).
En matière de politique étrangère, l’accomplissement majeur de Carter a été les accords de Camp David en 1978 — l’accord de paix signé entre le président égyptien Anwar Sadat et le Premier ministre israélien Menahem Begin, un rare moment d’espoir au Moyen-Orient. Les accords étaient un véritable accomplissement pour un homme modeste qui avait néanmoins une foi profonde, bien que parfois mal placée, en sa capacité à rassembler les gens.
Cependant : pauvre vieux Jimmy Carter. Pour tous ces accomplissements, et pour toutes ses nombreuses vertus personnelles, il reste l’homme en cardigan qui a harcelé les Américains pour baisser le thermostat, le pêcheur solitaire dans un étang de sa ville natale de Plains, en Géorgie, qui a été, c’est peu plausible, attaqué par une créature jusqu’alors inconnue appelée un « lapin des marais ». Ses relations avec le Congrès — qui était, après tout, contrôlé par son propre parti — étaient probablement les pires de tous les présidents depuis qu’Andrew Johnson a provoqué la Chambre des représentants à l’impeachment en 1868. Tip O’Neill, le président de la Chambre de longue date, ne pouvait pas supporter le cultivateur d’arachides de Géorgie, le considérant comme un provincial qui pensait être au-dessus d’apprendre les manières de Washington. Carter a une fois invité O’Neill à la Maison Blanche pour le petit-déjeuner mais lui a servi des biscuits et du café au lieu de jambon et d’œufs. Dans une tentative d’économie malavisée, il a cessé de servir de l’alcool lors des réceptions. Carter donnait l’impression que la seule raison de faire passer une législation était parce que c’était la bonne chose à faire, ce qui était presque l’opposé de la façon dont les politiciens de Washington le comprenaient. Le résultat fut que, malgré de grandes majorités et une « moyenne de réussite » relativement élevée pour faire passer des projets de loi au Congrès, des législations importantes sur les soins de santé, la réforme fiscale et l’aide sociale échouèrent. De longues files d’attente aux stations-service témoignaient chaque jour de l’incapacité de Carter à maîtriser l’inflation et la crise de l’approvisionnement énergétique. Et avec des conséquences politiques fatales, il semblait hésiter sur le sort des otages américains à Téhéran.
Son attrait lors de l’élection de 1976 était celui de l’anti-Nixon. Il souriait plutôt que de grimacer. C’était un Sudiste aux cheveux clairs qui promettait, comme un scout, de faire de son mieux, qui retrousserait ses manches et réparerait la machine gouvernementale. Il est vrai qu’à l’époque où il se présentait au poste de gouverneur de Géorgie en 1970, Carter n’avait pas hésité à faire quelques clins d’œil pseudo-nixonien aux ségrégationnistes, mais une fois en fonction, il était clair comme de l’eau de roche dans son opposition à la discrimination raciale. Avec Carter, il n’y avait pas de grossièretés, pas d’écoutes téléphoniques, pas de paiements de silence, pas d’impeachment — et pas de système d’enregistrement à la Maison Blanche pour le bénéfice des historiens futurs. Donc, sans aucun doute, il a réussi triomphalement à ne pas être Nixon. Mais c’est placer la barre assez bas.
Nous pouvons admirer l’ascension à la présidence de quelqu’un d’aussi fondamentalement honnête — surtout à la lumière de certains de ses successeurs. Mais la triste vérité est que Jimmy Carter pouvait être excruciant d’ineptie dans le domaine de la politique, c’est-à-dire dans l’art de gagner le pouvoir et de l’utiliser. Il était un prophète jeté dans une nation de pécheurs, et le problème est qu’il parlait comme tel.
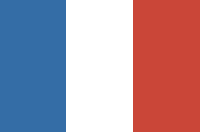
 Édition Principale
Édition Principale US
US





Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe