'Austria-Hungary staggered from crisis to crisis' (Radetzky March, 1994)
Keir Starmer a beaucoup parlé de son espoir de rapprocher la Grande-Bretagne et l’Union européenne. Son souhait s’est réalisé plus rapidement qu’il ne l’aurait imaginé. Récemment, il a rencontré la Première ministre italienne de droite, Giorgia Meloni, pour discuter de la manière de lutter contre la migration illégale, suite aux bouleversements de fin juillet et début août lorsque certaines parties du pays ont brièvement connu des émeutes anti-immigrés. Ces troubles étaient remarquablement similaires à ceux qui avaient précédemment agité la France, l’Allemagne et la République d’Irlande. Ce n’était certainement pas le type de convergence que la Première ministre avait en tête.
Les points communs à travers la mer d’Irlande et la Manche — un profond malaise face à l’immigration, la montée continue du populisme et la propagation du discours extrémiste, notamment en ligne — reflètent les similitudes des défis. La question de la manière d’accommoder des identités plurielles est pressante.
Alors que le Royaume-Uni et le reste de l’Europe luttent contre la fragmentation sociétale et nationale, il vaut la peine d’examiner comment certains des États les plus divers ont géré la différence dans le passé. Et il serait difficile de trouver un meilleur exemple que l’Empire austro-hongrois, ou l’Autriche-Hongrie comme on l’appelait durant la dernière phase de son existence. D’une population totale de 51,4 millions en 1910, 23 % utilisaient principalement l’allemand, 19,6 % le hongrois, 12,5 % le tchèque et 9,7 % le polonais. Le reste utilisait principalement l’italien, le croate, le ruthène, le roumain, le slovaque et le slovène. C’était une véritable Babel et reflétait, en gros, les profondes divisions nationales entre les peuples qui composaient l’empire. Pourtant, grâce à une série d’expédients, les Habsbourg ont pu naviguer à travers cette situation — fortwursteln — sans un effondrement interne catastrophique jusqu’à la défaite lors de la Première Guerre mondiale.
En raison de cette survie à long terme, certains au Royaume-Uni ont vu dans l’Autriche-Hongrie une solution à leurs propres problèmes de réconciliation entre les Anglais, les Écossais, les Gallois et les Irlandais. Comme le souligne l’historien Alvin Jackson dans son étude révolutionnaire sur ces questions, lorsque le Premier ministre William Gladstone a tenté de s’attaquer à la ‘question irlandaise’ à la fin du 19ème siècle, il a étudié très attentivement le ‘compromis’ atteint entre les Habsbourg et les Hongrois. Arthur Griffith, qui a fondé le Sinn Féin en 1905, a même salué cet accord comme la ‘résurrection’ de la Hongrie qui pourrait servir d’exemple pour une monarchie anglo-irlandaise duale.
Le Royaume-Uni et l’Autriche-Hongrie ont tous deux émergé de monarchies composites modernes précoces, des entités où la couronne régnait sur des territoires gouvernés de manières très différentes. Dans le cas britannique, la solution a été trouvée dans l’établissement d’une union parlementaire, en 1707, puis élargie en 1801, dans laquelle tout le monde était représenté sur une base égale — selon le droit de vote de l’époque — à Westminster. L’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande ont cessé d’exister, politiquement ; le Pays de Galles avait été aboli quelque temps plus tôt. Cet arrangement a facilité la base pour l’essor de l’un des États les plus puissants que le monde ait jamais connus.
Les Habsbourg ont pris la route opposée. Après divers essais de leur part, ils se sont fixés sur une ‘démocratie composite’ avec un monarque à sa tête. En 1867, l’Ausgleich de l’empereur François-Joseph — ‘compromis’ — a divisé l’empire en deux moitiés, toutes deux avec une représentation parlementaire. Bien qu’ils ne représentaient que 40 % de la population de la moitié ‘hongroise’, les Magyars dominaient les Slovaques, Roumains, Serbes et Croates ‘sujets’. L’autre moitié n’avait pas de nom officiel mais avait une pluralité (environ 37,5 %) de locuteurs allemands principalement en Bohême, en Moravie et dans l’Autriche actuelle. Comme les deux parties étaient séparées par la rivière Leitha, elles étaient connues sous le nom de Cisleithanie et Transleithanie.
Le Royaume-Uni et l’Empire Habsbourg ont tous deux fait face à l’assaut de la politique européenne de la fin du 19ème siècle : le nationalisme croissant avec les politiques identitaires qui en résultent sur la langue, l’éducation et l’emploi, et le conflit de classes. Tous deux ont vu des demandes de solutions basées sur le partitionnement, et tous deux ont été soumis aux rigueurs de la Première Guerre mondiale. Mais ils ont fait face de manière très différente.
L’Autriche-Hongrie a vacillé de crise en crise alors qu’elle tentait de faire face à ce que l’historien Steven Beller appelle un ‘mélange de sorcières’ de demandes et de haines concurrentes. Vienne cherchait à maintenir le contrôle à travers une série de ‘compromis’ en Croatie, en Moravie, en Bucovine et en Galicie. La gouvernance, comme l’a un jour fait remarquer le vétéran Premier ministre de la Cisleithanie, le vicomte Eduard Taaffe, était une question de maintien des divers groupes dans un état de ‘mécontentement bien tempéré’. Par exemple, le ‘compromis’ avec les Polonais se faisait au détriment de leur domination sur les Juifs et les Ruthènes de Galicie. Le parlement était un zoo. La capitale, qui abritait une énorme population immigrée, en particulier des Slaves de toutes les parties de l’Empire et des Juifs, notamment de Galicie, a également engendré un discours xénophobe et antisémite virulent. Il n’est pas surprenant que le satiriste viennois Karl Kraus ait qualifié l’empire de ‘Laboratoire de la destruction mondiale’.
Le Royaume-Uni a beaucoup mieux réussi à gérer les tensions entre ses territoires. La plupart des îles britanniques ont développé une forme de politique idéologique, plutôt que nationale : les Conservateurs, les Libéraux et plus tard le Parti travailliste ont obtenu du soutien dans trois des quatre nations. Ce n’est qu’en Irlande, où les différences entre catholiques et protestants continuaient à jouer un rôle majeur, que le nationalisme est devenu dominant. Mais, malgré leurs meilleurs efforts pour obstruer et perturber le parlement, les nationalistes irlandais n’ont jamais réussi à plonger Westminster dans le même état de confusion que celui infligé par les nationalistes tchèques, polonais, slovènes, italiens et même allemands au Reichsrat à Vienne.
De plus, contrairement à l’Empire des Habsbourg, qui s’est effondré en 1918, le Royaume-Uni est sorti de quatre années de conflit lors de la Première Guerre mondiale en tant que vainqueur, ne perdant que l’État libre d’Irlande dans son sillage. Six des neuf comtés d’Ulster sont restés au Royaume-Uni. La partition a été traumatisante, c’est sûr, mais elle est restée un événement largement contenu qui n’a pas beaucoup affecté le reste de l’Europe. En fait, la séparation des 26 comtés a été rendue possible par la victoire britannique sur l’Allemagne, car il était difficile d’envisager comment un État séparé sur le flanc occidental présenterait un défi militaire immédiat.
Malgré le succès relatif du modèle britannique, comparé à ses alternatives européennes, la demande de reconnaissance nationale a augmenté tout au long de la fin du 20e siècle. En Irlande du Nord, l’introduction d’un parlement dévolu en 1920 a facilité la discrimination contre la population catholique. Après la fin de la guerre froide, et le passage apparent des menaces stratégiques pour le Royaume-Uni, le Premier ministre Tony Blair a introduit la dévolution en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles. Il y avait maintenant des organes représentatifs de l’autre côté de la mer d’Irlande, de l’autre côté de la rivière Wye, et au-delà du Tweed, qui s’occupaient des questions non ‘réservées’ à Westminster. Certains, comme le secrétaire d’État fantôme pour l’Écosse, George Roberston, ont prédit que ‘la dévolution tuera le nationalisme sur le champ’.
L’Ausgleich britannique était également déséquilibré. Il donnait une expression au nationalisme de seulement trois des quatre nations. L’Angleterre n’avait pas d’assemblée parlementaire séparée, et politiquement, elle était définie par son absence de dévolution. Toutes les lois de l’Angleterre étaient votées par des représentants des quatre nations, mais le pays n’avait pas son mot à dire sur les lois adoptées par les assemblées dévolues. La plus grande nation semblait être laissée de côté.
Le Royaume-Uni, donc, au 20e siècle semblait s’inspirer de l’expérience de l’Empire des Habsbourg — mais son héritage est contesté. L’échec des États successeurs, qu’ils soient fascistes ou communistes, remet les choses en perspective. Alors qu’ils mijotaient dans le Bloc soviétique, de nombreux intellectuels d’Europe centrale ont développé une nostalgie pour un cadre qui leur avait permis de coexister dans une relative liberté. Peu après la fin du communisme, l’historien hongrois renommé István Deák a soutenu dans son livre de 1990, Beyond Nationalism, que l’ ‘Expérience des Habsbourg’ en matière d’organisation supranationale devrait être revisitée. ‘Je suis convaincu,’ a-t-il écrit, ‘que nous pouvons trouver ici une leçon positive tandis que l’histoire post-1918 des États-nations d’Europe centrale et d’Europe de l’Est ne peut que nous montrer ce qu’il faut éviter.’ L’historien Solomon Wank, en revanche, a souligné en 1997 que l’empire avait simplement ‘attisé les feux de la rivalité nationale’ qui l’ont finalement consumé.
Quoi qu’il en soit, il n’est pas évident de savoir ce que le Royaume-Uni peut maintenant apprendre des Habsbourg aujourd’hui. D’abord, parce qu’ils avaient peu de choses utiles à dire sur l’immigration, l’une des principales préoccupations des récentes émeutes. En effet, le maire de Vienne, Dr Karl Lueger, a célèbrement exploité la haine antisémite envers les migrants juifs à des fins politiques personnelles. Deuxièmement, comme nous l’avons vu, parce que la direction austro-hongroise a aggravé les différences nationales, autant qu’elle les a atténuées.
Ce que le Royaume-Uni peut faire, c’est apprendre des erreurs des Habsbourg. L’indulgence de l’État envers le nationalisme avant 1914 n’a fait qu’accroître le chaos. De même, l’introduction de la dévolution au Royaume-Uni, loin de ‘tuer’ la demande de séparation ‘à jamais’, a en réalité aiguisé les appétits. En Écosse, l’établissement de l’assemblée à Édimbourg a accru les appels à la séparation du Royaume-Uni au point que Londres a été contraint de concéder un référendum en 2014 qu’il craignait à un moment de perdre. Au Pays de Galles, l’intérêt pour l’indépendance, bien que toujours faible, a augmenté après l’introduction de la dévolution. En Irlande du Nord, les institutions dévolues ont peut-être aidé à instaurer une certaine forme de paix, mais elles facilitent également les querelles continues entre les deux communautés. Nous avons donc suffisamment, et peut-être trop, de dévolution — nous n’avons pas besoin de plus de compromis.
L’Union britannique est fondée sur l’hypothèse que nous avons quatre nations dont les membres sont anglais, écossais, gallois et irlandais, mais aussi — s’ils le souhaitent — britanniques. Si le Royaume-Uni suivait davantage l’exemple austro-hongrois, le résultat pourrait être la ‘résurrection’ de l’Irlande, de l’Écosse, du Pays de Galles et même de l’Angleterre — mais ce serait aussi la mort de la Grande-Bretagne.





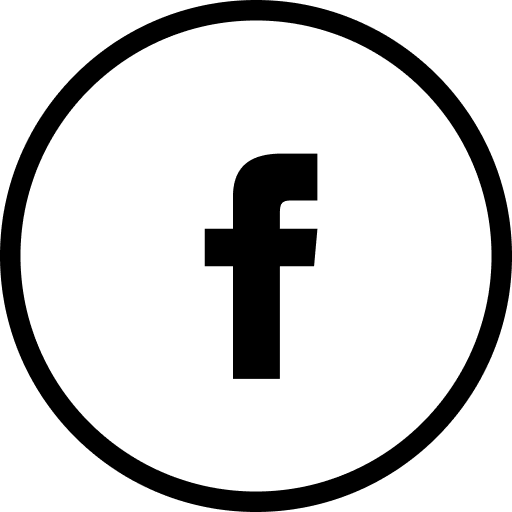
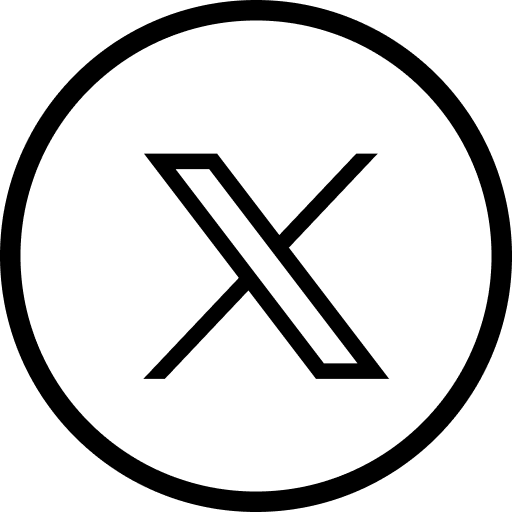
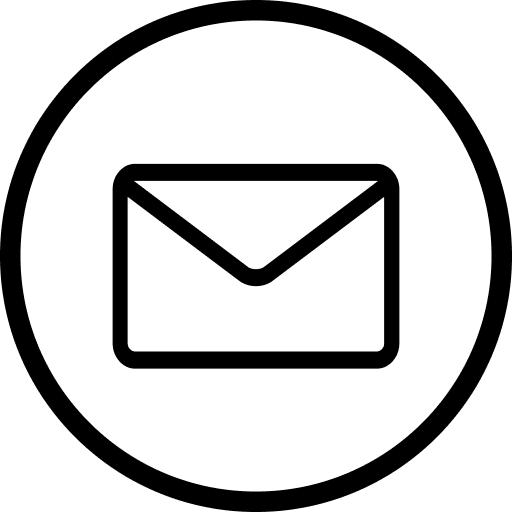
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe“…its president, provost and deans would no longer make public statements on current events…”
So, a handful of administrators will remain studiously mum while–wink wink–thousands of faculty are free to continue indoctrinating students in progressive orthodoxy. These are meaningless actions meant only to silence critics without changing the underlying source of the problem.
Correct, this has got mainly to do with appeasing sponsors. A very important stakeholder in US Ivy league education.
Not so fast. President Pollack was pushed out and her successor is on thin ice while they search for a new Prez. The Cornell Free Speech Association has been at the forefront of bringing pressure to bear on the administration. Things are changing. CFSA will continue to monitor and act on any official actions of the university like deplatforming of speakers, harrassment, etc. I expect the Admin will become neutral.
That’s all you can expect. Individual professors have as much right to speak freely as you do.
Unfortunately many of those professors are still indoctrinated and insist on doing the same to their students. It will take much longer for universities to shed the neo-marxism that has contaminated higher education.
I’m not being fast. You are slow to appreciate the current state of academia. You seem to take comfort in the ability of “individual professors having the right to speak freely” but that is moot if the professors are homogeneously progressive, which they are. Generations of potential conservative professors have opted out of academia for the last quarter century because they rightfully perceived as undergrads that a university neither offers them opportunity for advancement nor even welcomes their presence. They’ve gone into other professions instead. Many existing conservative faculty left academia when they saw the handwriting on the wall. The demographic compositions of faculties is now above 90% liberal. Contracts for new faculty require the signing of progressive compliance documents that make a mockery of free thought. And institutions blatantly discriminate in hiring against those known to profess conservative ideas. So what good is free speech if the composition of faculties are effectively unanimously progressive? There are no longer significant numbers of alternative faculty voices willing to confront the status quo. Academic “freedom” policies in such a context only codify coverage for leftist faculty’s continued condemnation of the rara avis conservative. We also have recently seen the hollowness of university administrative actions vis a vis recent protests where in the overwhelming majority of cases the miscreants who defied policies and (seldom) received some type of suspension or dismissal saw the punishments quietly vacated. Only the credulous would expect administrations to enforce policies in the future if doing so is inconvenient to the prevailing established orthodoxy.
Additionally, the lock on thought-expression in academia extends beyond universities to the realms of academic journals, where heterodox ideas are professionally dangerous to submit and usually rejected, and to professional associations that have become politicized in conformance with progressivism. University administrations have no control over these entities but these entities police and enforce academic orthodoxy. Finally, MY “speaking freely” that you refer to is on any platform like this contingent upon the whims of some nameless, faceless, content mediator and algorithm. Many of them would block what I’ve written or, in the case a social media, withdraw amplification of it.
Institutional neutrality, most famously articulated in the 1968 Chicago Statement
I’m always proud of my alma mater’s continued commitment to academic freedom.
There you are. No speech without responsibility for what’s said.
So a handful of universities are starting to appear to be fair-minded. Whoop-de-do ….
These are important universities that the less famous ones will follow. This represents an early step in the new, conservative march through the institutions to take them back to sanity.
Not a conservative match, thank goodness, but the simple acknowledgement that statements confer responsibility. If you can’t take it, don’t make it.
And the pendulum continues to swing, back and forth, back and forth…
Now only if the major news outlets will get the hint!
Time will tell whether these universities really live up to these commitments, but it is most certainly really encouraging that the dawn following a very dark night of wokism is really breaking in the USA. It is such a shame that the UK is heading further into the darkness with freedom under attack from every direction at the moment. The US experience does however show that it is possible to wake up from the woke nightmare.
Sorry, it’s a dawn following a very dark night of ‘free speech’.
Here are some well developed thoughts on free speech.
Doesn’t seem that complicated.
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/not-in-our-name
To find Cornell’s position on anything look up Harvard’s six months earlier.
Ouch!
Which shows how little novelty of thought exists in academia and how much pure mimesis.
I have zero confidence this will make one iota of difference. Progressives are accustomed to, and take actual pride in, being heartily disliked by ordinary people. They will redefine doing the same thing as making a huge change and then carry on as usual.
It’s ‘ordinary people’ who push for progress. That’s what reactionaries can’t stand.
I strongly suspect that most ordinary people want to not have obstructions imposed on their lives and to not be told what they should think. In our times, that would be progress.
Greek life?
I wondered that.
Fraternities and Sororities. Think “Animal House”.
Sounds great…on paper. But will these woke institutions really permit free speech, or will they find ways to continue speech codes and censorship of non-woke beliefs as they have tried to skirt SCOTUS rulings on affirmative action?
What a morose and skeptical (US spelling) collective reaction here! Of course these moves don’t establish a sincere or total change of campus atmosphere, but they are a legitimate good start—right? Even 12-plus years of your favorite MAGA strongmen—for those who are fans of such flame-fanners— won’t create the ideal conservative/radical-right Academy of one’s dreams, but why not relax your pessimism and gloom for a moment?
Those charlatans Robin DiAngelo and Ibram X. Kendi are exposed—though way belatedly—and Woke Racism by John McWhorter and The Identity Trap by Yascha Mounk are more in line with the zeitgeist. That’s better than nothing.
How staggeringly stupid for an institution ever to have taken any other position. That they did speaks volumes for the intellectual mediocrity of these universities.
What matters more than staying mum is that university presidents are not DEI types and know how to handle issues. It is also important that university life is not brought to a halt by any side in a debate.
I’m deeply sceptical. Vast swathes of academia have basically given up on empiricism and trying to think beyond one’s biases. I’m not just trying to be insulting here – many academics across the social ‘sciences’ and humanities will freely admit to that, though language like ‘prioritising individual subjectivities and reflective analysis’ or all things ‘critical’ (which specifically sets out to ‘counter hegemonic narratives and elevate marginalise voices’, meaning ‘I write what I do to further social justice’)
You can’t have free and open debate at an institution when over half of the professors there don’t rely on rationalism as a means of deriving truth, and will hound and isolate anyone who does fundamentally disagree with them as a bigot. It’s like expecting the Catholic Church to be home to spirited debate about the existence of god, it’s not a neutral environment for that discussion.
True political neutrality at these institutions would mean that half of all faculty will need to be replaced by conservatives and/or right wingers. That the administrators will henceforth hold their tongue on political issues is just a gesture to ensure continued enrollments into what are really left-wing indoctrination centers.