WASHINGTON, DC - JANUARY 12: President Barack Obama delivers his State of the Union address before a joint session of Congress on Capitol Hill January 12, 2016 in Washington, D.C. In his final State of the Union, President Obama reflected on the past seven years in office and spoke on topics including climate change, gun control, immigration and income inequality. (Photo by Evan Vucci - Pool/Getty Images)
En mars 2008, dans l’effervescence de sa campagne présidentielle, Barack Obama s’est soudainement retrouvé au bord d’un abîme. L’ancien pasteur noir de son église de Chicago, Jeremiah Wright, que Obama connaissait depuis 20 ans, a prononcé des déclarations déséquilibrées sur l’Amérique. Parmi elles : la Cour suprême était ‘une cour du Klan cachée’ ; ‘le gouvernement a menti en inventant le virus du VIH comme moyen de génocide contre les personnes de couleur’ ; et ‘Que Dieu maudisse l’Amérique pour traiter nos citoyens comme moins qu’humains’. La situation était, derrière les apparences, shakespearienne dans sa complexité, mais Obama était à un pas de devenir une note de bas de page historique. Il a fait un pari audacieux pour sauver sa candidature. C’était un discours qu’il a prononcé à Philadelphie, et c’était un chef-d’œuvre.
Le discours était si éloquent et complexe que, en l’entendant, on craignait qu’il ne le disqualifie pour être président. Il abordait la question de la race directement, sans détours ni formules vertueuses. Ce qui le distinguait vraiment, cependant, c’était que même en disant à l’Amérique blanche la dure, honnête et douloureuse vérité sur ce que c’est que d’être noir en Amérique, il disait aux Noirs ce que cela signifiait d’être une personne blanche ordinaire, décente et non raciste en Amérique.
Il faut dire que le discours lui-même était, en partie, malhonnête puisque Obama déplorait les divisions raciales après avoir passé sa campagne à les mettre en avant afin de se présenter comme un guérisseur. Bien que beaucoup plus optimiste que Trump — ‘l’audace de l’espoir’, si vous vous en souvenez — l’insistance rhétorique d’Obama sur le fait que la race était la question suprême en Amérique (ce n’est pas le cas) le plaçait juste au centre du destin américain, en tant que premier candidat noir à la présidence. C’était la version d’Obama du ‘carnage américain’ de Trump. Les deux hommes devaient faire en sorte que l’Amérique se sente mal à propos d’elle-même dans des termes qui reflétaient leurs propres personnalités, dans le but de faire valoir qu’eux — et eux seuls — pouvaient faire en sorte que l’Amérique se sente bien à propos d’elle-même.
Et puis les démons qu’Obama avait lâchés se sont retournés contre lui avec les commentaires de Wright. Obama a dû faire volte-face et maintenant raconter aux Américains une histoire compliquée sur la façon dont les races coexistent harmonieusement les unes à côté des autres même si, de temps en temps, elles ne le font pas.
En lisant le transcript de son discours maintenant, vous aspirez aux jours avant que la politique de la piété ne prenne le dessus. Au lieu de se présenter avec désinvolture comme un héros en combattant courageusement des batailles qui avaient été gagnées des générations auparavant — en s’insurgeant contre les monuments confédérés, par exemple — Obama a rappelé aux gens comment ‘en Caroline du Sud, où le drapeau confédéré flotte encore, nous avons construit une puissante coalition d’Afro-Américains et d’Américains blancs’. On pourrait imaginer la légion d’éditeurs piétistes au The New York Times entendant cette phrase aujourd’hui : « Où est-ce que le drapeau confédéré flotte-t-il encore ? Blancs et noirs ensemble ? Est-il un crypto-fasciste ? »
C’était une péroraison magistrale. Il a dénoncé l’injustice ‘d’une vision qui voit le racisme blanc comme endémique [sans parler de ‘systémique’], et qui élève ce qui ne va pas avec l’Amérique au-dessus de tout ce que nous savons être juste avec l’Amérique’. Il a parlé de ‘problèmes qui ne sont ni noirs, ni blancs, ni latinos, ni asiatiques, mais plutôt des problèmes qui nous concernent tous’. Et il a parlé avec compassion de ‘la femme blanche qui lutte pour briser le plafond de verre, de l’homme blanc qui a été licencié, de l’immigrant qui essaie de nourrir sa famille’.
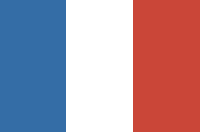
 Édition Principale
Édition Principale US
US





Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe