Never truly alone. In Pictures Ltd./Corbis/Getty Images.
De toutes les petites villes dans lesquelles j’ai séjourné le long de la vallée du Rhône en France, Tournon-sur-Rhône est celle que j’ai le moins aimé. C’est une ville bruyante traversée par une vieille voie rapide, la route nationale 86.
Pourtant, même à Tournon, un mercredi après-midi ennuyeux, il y avait une scène sociale active, un sentiment commun de devoir être, sinon directement avec d’autres personnes, du moins près d’elles. Dans un café local, des amis, des collègues, des couples, des familles venaient et repartaient. Ceux qui arrivaient seuls, principalement des habitués plus âgés, venaient pour s’asseoir, regarder le monde et discuter avec les serveurs et les autres clients. Ils étaient seuls uniquement de nom. Chacun avait sa place, comme je l’ai découvert plus tard lorsque j’ai réalisé avoir pris la place d’un habitué. J’ai proposé de changer de place, mais ils ont décliné avec un sourire, marmonnant quelque chose que, j’espère, pouvait se traduire par : ‘Je suis peut-être attaché à mes habitudes, mais je n’y suis pas si attaché’.
J’ai passé près de trois heures dans ce café, et bien que j’y étais seul, je ne me suis jamais senti seul. Je n’ai pas commandé grand-chose, mais je ne me suis jamais senti pressé. Les Français comprennent la valeur de passer un long moment assis avec d’autres, tout en faisant, en apparence, rien.
Après ce café, je suis allé dans quatre autres, certains bondés, d’autres presque vides. Malgré la laideur de la ville, cela n’a jamais paru déprimant. Et peut-être est-ce parce que le fait d’être social est central pour le bonheur humain. La solitude, l’isolement, le fait de ne pas avoir de communauté à laquelle appartenir — voilà ce qui est déprimant. C’est le genre de désespoir qui peut rapidement atteindre des niveaux terribles. Suicidaires.
Cette culture du café, que j’ai observée au quotidien dans chaque communauté le long de la vallée du Rhône, n’est qu’un exemple du sens sain du communautarisme en France. Le fait de socialiser ici n’est pas du ‘réseautage’ — le but n’est pas de faire des connexions professionnelles ou de grimper dans la hiérarchie sociale, mais plutôt de faire partie d’un collectif, avec une compréhension partagée de qui vous êtes (dans ce cas, Français) et pourquoi c’est bien d’être ainsi. Ce sens de soi si ancré n’est pas explicitement reconnu. C’est le bassin dans laquelle vous nagez, mais que vous ne remarquez pas.
Ce sentiment de savoir qui vous êtes, de reconnaître que vous êtes une partie précieuse de quelque chose de plus grand et meilleur que vous-même, est bien moins courant aux États-Unis. Dans mon pays d’origine, être vous, autant que vous le pouvez l’être, et être défini par votre propre saveur d’unicité est central. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que l’Europe (ou du moins de grandes parties de celle-ci) est bien plus saine que les États-Unis : vous pouvez le constater dans les statistiques de suicide et de mortalité, mais vous pouvez aussi le voir de vos propres yeux, si vous passez du temps à voyager entre les deux. Il ne faut pas longtemps pour réaliser que nous, Américains, ne sommes pas en bonne santé, ni physiquement ni mentalement. Nous sommes un pays malade et nous nous enfonçons. Nous faisons face à un niveau anormalement élevé de maladies mentales, diagnostiquées ou non. Nous sommes accros aux médicaments, qu’ils soient légaux ou illégaux, pour essayer de faire face. Nous nous tuons en nombre record.
Les Américains prétendent que parce que nous avons plus de choses, nous sommes meilleurs que d’autres nations. À mon avis, le contentement, le bonheur et l’épanouissement sont des mesures plus importantes de la réussite.
Pourtant, les Américains passent souvent à côté de la force de l’Europe car ils ne sortent que rarement des centres-villes touristiques. Les grandes villes européennes deviennent de plus en plus lisses, menaçant de former une entité unique et ennuyeuse. Cette américanisation sans âme a considérablement accéléré au cours des dernières décennies, poussée par la mondialisation, le tourisme et le capitalisme séculier. Le résultat est un genre de McEurope — une chaîne de grandes villes dont certaines parties sont identiques. La marque des franchises peut être légèrement différente, le paysage un peu modifié, mais ces parties offrent la même expérience fade.
Il ne reste pas beaucoup de dignité dans ces ‘centres-villes historiques’, la plupart étant perdue dans la course à la monétisation des foules. Les enterrements de vie de garçon et de jeune fille débarquant par avion avec Ryanair. Les tournées des bars. Les rues pavées bordées des mêmes magasins vendant des baskets, des sex toys, des paninis crus sous des lampes à lumière, des sucreries aux niveaux de calories absurdes et tout autre bêtise que les touristes achètent pour se sentir spéciaux. Même les cathédrales ont été réduites à une case à cocher sur les listes de touristes pour justifier un restant de journée passé à boire.
Ce qui manque le plus à la McEurope, c’est le communautarisme qui est central à la culture européenne. Heureusement, McEurope est confiné à quelques quartiers, et il est très facile de s’en éloigner. Je recommanderais toujours de visiter une ville moyenne choisie au hasard en Europe, plutôt qu’une capitale. Un endroit comme Valence en France, qui, comme Paris, a une longue histoire et une cathédrale ancienne et sublime, mais qui n’a pas encore totalement cédé aux forces mondiales tentant d’aplanir le monde.
Dans des endroits comme celui-ci, vous pouvez voir l’attention que les Européens accordent encore à la vie : manger, se détendre, faire partie d’un groupe, travailler dans un but autre que celui de gagner de l’argent. Ici, nous trouvons l’antidote à l’idéologie très américaine de la libération individuelle. L’idée que tout le monde doit être émancipé de tout. Tout le monde doit trouver son vrai moi et l’adopter — même si cela signifie rompre avec la famille, les amis, l’église, la nation, et tout ce qui précède. Ces notions sont provinciales, arriérées et vous tirent en arrière.
Le but de la vie en Amérique est donc d’être libre. Pourtant, la liberté est un objectif pervers, un Telos brisé, qui ne peut être considéré comme positif que si vous avez une perception anormale de ce que signifie être humain. Être humain, c’est être social ; les anciens Grecs le savaient, les Chrétiens médiévaux le savaient et même les premiers Libéraux le savaient. Mais nous, citoyens modernes, l’avons oublié d’une manière ou d’une autre. Une fois que vous comprenez cela, vous comprenez que la définition américaine de la liberté se conclut par le désespoir.
La vraie liberté n’est pas d’être tellement émancipé que vous finissez par être isolé, c’est le contraire — faire partie d’un groupe et savoir où vous vous situez et être valorisé, que ce soit dans un café, un club ou une nation. En ce sens, l’Europe est plus libre et plus saine que les États-Unis. La plupart du reste du monde l’est aussi. Mais aux États-Unis, et en McEurope, nous considérons la communauté comme quelque chose à dépasser. Cela est particulièrement vrai pour la classe intellectuelle, qui joue un rôle disproportionné dans les décisions politiques et commerciales.
Pourtant, même en Amérique, vous pouvez voir une lueur de résistance. Les Américains sont aussi des animaux sociaux, comme tous les humains ; nous avons tellement besoin de communauté que nous chercherons à construire des relations dans les environnements les plus hostiles. Il suffit de regarder la franchise McDonald’s, conçue comme un moyen impitoyablement efficace et transactionnel de vendre de la nourriture. Vous entrez, vous achetez des calories, vous partez, le plus rapidement possible. Pourtant, de nombreuses succursales de McDonald’s à travers l’Amérique se sont transformées en centres communautaires, où certaines personnes se retrouvent même pour prier. (À son crédit, l’entreprise a reconnu cela et a changé son approche, bien que l’objectif principal reste l’efficacité.)
Pendant mes années consacrées à la pauvreté, à la toxicomanie et au désespoir en Amérique, j’ai vu des communautés émerger dans les endroits les plus désespérés : des foyers de toxicomanie dans le Bronx, des camps de sans-abri sous les ponts ou des bars miteux à Los Angeles. Sans communautés fonctionnelles auxquelles se joindre, de nombreux Américains finissent par graviter vers des communautés dysfonctionnelles par désespoir. Sans églises ou cafés, ils se dirigent vers la drogue ; sans familles, vers des politiques extrêmes ; sans clubs sportifs, vers des gangs ; sans amis, vers des forums en ligne où déverser leur colère.
Malheureusement, une minorité croissante échoue complètement à trouver une chose à laquelle appartenir et finit dans un état de perversion complètement antisocial. Un état de dépression, de confusion, de vide et ensuite de violence, contre les autres et contre eux-mêmes. Un état qui, pour trop de gens, se termine par un suicide, rapide ou lent, une seringue à la fois. C’est une liberté transformée en une tyrannie du vide.
Une version de cet essai a tout d’abord été publiée sur Substack.








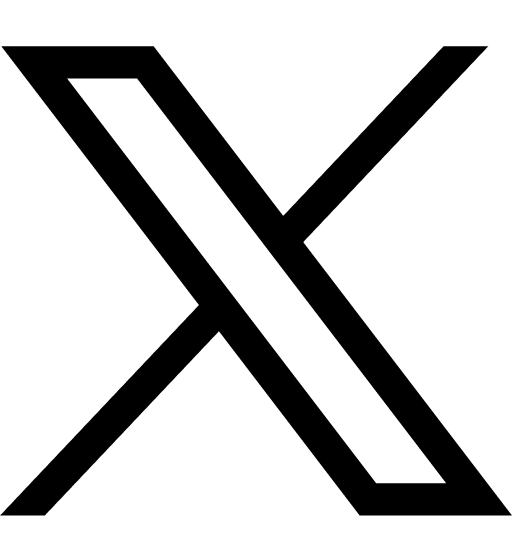
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe