En février, Hamit Coskun, âgé de 50 ans, a été accusé d’avoir causé « harcèlement, alarme ou détresse » à la foi islamique après avoir brûlé un Coran devant le consulat turc à Londres. Un KC a déclaré à la National Secular Society que les accusations étaient « manifestement défectueuses », tandis que la NSS a accusé les procureurs de réintroduire une loi sur le blasphème « par la porte de derrière ».
Il est vrai que si Coskun est condamné, cela marquerait une nouvelle étape dans la capitulation progressive de l’Europe face au « Veto des Jihadistes » — où la peur des représailles violentes dicte les limites de l’expression légale. Coskun a déclaré que son acte était une protestation contre le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Sur X, Coskun a affirmé que la Turquie était en train de devenir une « base pour les islamistes radicaux ». Il voulait également exprimer sa solidarité avec Salwan Momika, un réfugié irakien qui a été assassiné en Suède en janvier après avoir brûlé des Corans lors de manifestations publiques répétées.
La référence de Coskun aux événements en Suède illustre une tendance européenne plus large. Une série de brûlages de Corans, en particulier en Scandinavie, a exposé l’influence croissante de ce qui pourrait être appelé la censure externalisée. Cela résulte d’un mélange de pressions exercées par des régimes autoritaires, en particulier les États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ; de menaces de groupes jihadistes ; et d’apaisement par des démocraties libérales.
L’OCI est un organe intergouvernemental représentant 57 pays à majorité musulmane qui, ces dernières décennies, a souvent conflé le blasphème — qui est légal dans la plupart des démocraties libérales occidentales — avec des discours de haine inacceptables selon les lois internationales sur les droits de l’homme. Clairement, il s’agit d’une stratégie pour promouvoir des lois mondiales contre le blasphème.
Le premier domino à tomber a été hautement symbolique. En 2017, le Danemark a fièrement abrogé sa loi sur le blasphème, longtemps dormante. Le Premier ministre de l’époque, Lars Løkke Rasmussen, a déclaré que c’était un triomphe pour la liberté d’expression — particulièrement puissant dans le pays qui avait refusé de céder après que le journal danois Jyllands-Posten ait déclenché la crise des caricatures du prophète Muhammad en 2005. Le pays a subi une réaction violente et une pression diplomatique concertée. L’abrogation a envoyé un message clair : les sociétés démocratiques ne doivent pas céder aux sensibilités religieuses ou à l’intimidation.
Mais en 2023, Rasmussen — devenu ministre des Affaires étrangères — a inversé sa position. Après une série de brûlages de Corans par des manifestants d’extrême droite qui ont ravivé une réaction internationale et des menaces d’extrémistes, il a déploré que le Danemark soit « perçu comme un pays qui soutient l’insulte et la dénigration d’autres pays et religions ». Une nouvelle loi a été adoptée interdisant le « traitement inapproprié des écritures » — un retour de facto de l’interdiction du blasphème, bien que d’une portée plus étroite.
Ce n’était pas juste un revirement. Cela a marqué la capitulation silencieuse du Danemark face aux forces mêmes qu’il avait autrefois résistées. L’OCI, qui avait longtemps poussé un agenda pour criminaliser la « diffamation de la religion », a saisi les brûlages de Corans en Scandinavie pour faire adopter une résolution de l’ONU équivalant l’offense religieuse à l’incitation à la haine religieuse. Elle a été soutenue par la Chine, la Russie et l’Arabie Saoudite. Le Danemark, autrefois la cible défiant de l’OCI, avait maintenant intégré ses lignes rouges.
Ces lignes rouges sont en train d’être appliquées. Deux manifestants d’extrême droite ont été accusés en vertu de la loi danoise, après avoir déchiré deux pages d’un Coran et les avoir jetées dans une flaque d’eau lors d’un débat public sur la loi même en vertu de laquelle ils sont maintenant accusés.
Le voisin du Danemark, la Suède, a emboîté le pas. Accusé d’incitation à la haine après avoir brûlé un Coran, Salwan Momika a été poursuivi pour son protestation non-violente contre le fondamentalisme islamique. Quelques jours avant son verdict, il a été abattu dans son appartement. Son co-accusé, également d’origine irakienne, a été condamné à une amende pour le même acte. Dans une démocratie, l’expression pacifique a été punie deux fois : d’abord par les tribunaux, puis par un tueur que l’État n’a pas réussi à arrêter.
Le Royaume-Uni a ses propres exemples où l’État a échoué à défendre le droit de ses citoyens à critiquer la doctrine religieuse. Dans le cas de l’enseignant de la Batley Grammar School — qui est toujours caché quatre ans après avoir montré une caricature du prophète Muhammad lors d’un cours d’éducation religieuse — il ne critiquait même pas la religion. Pourtant, le gouvernement britannique a permis à la foule de menacer et d’intimider quelqu’un qui faisait simplement son travail. Et qui peut oublier le cas de 2023 de l’élève autiste qui a reçu des menaces de mort pour avoir prétendument endommagé un exemplaire du Coran ?
La leçon de ces événements est sombre : lorsque les démocraties cèdent au veto de la violence, elles encouragent ceux qui voudraient faire taire par des menaces. La vraie question n’est plus si la liberté d’expression est menacée par des extrémistes violents — elle l’est sans aucun doute. La question maintenant est de savoir si nous avons encore le courage de la défendre. On ne peut qu’espérer que le Royaume-Uni revienne à la raison et rompe la tendance à apaiser le veto des jihadistes.





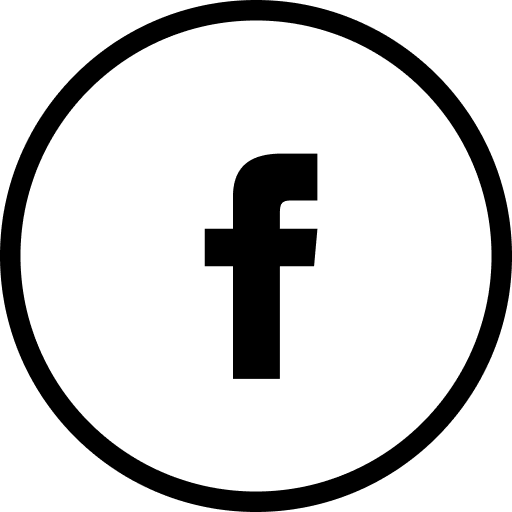
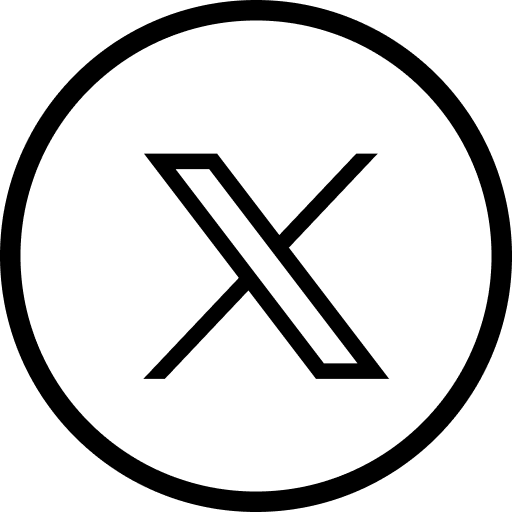
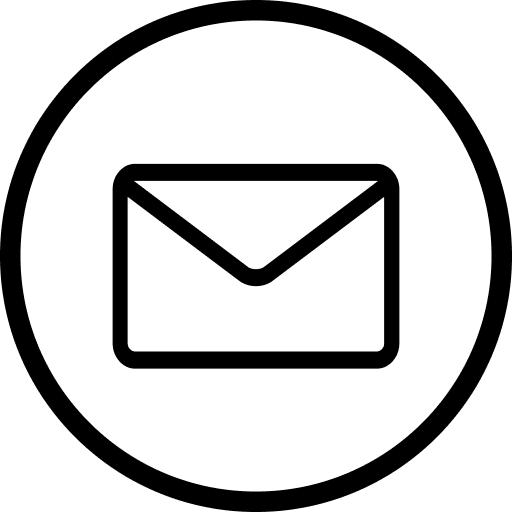

Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe