Depuis une grande partie de cette semaine, X a été rempli d’images étrangement familières mais indéniablement rebutantes qui représentent une nouvelle frontière dans la consommation de l’art humain par l’IA. Les utilisateurs ont découvert que la dernière mise à jour de ChatGPT leur permet de transformer n’importe quelle photographie en quelque chose ressemblant à une scène d’un film de Studio Ghibli. En quelques heures, Internet était inondé de ces rendus troublants — tout allant du 11 septembre et de l’assassinat de Kennedy au suicide télévisé du trésorier de Pennsylvanie, R. Budd Dwyer, tous réimaginés dans le style distinctif de l’animateur japonais Hayao Miyazaki. Cependant, ce n’est pas qu’une simple tendance passagère. Au contraire, c’est une autre étape dans l’appropriation continue de l’expression artistique humaine par l’IA.
Tout d’abord, il y a eu la nouveauté de voir des événements historiques sérieux transformés en pastiches d’anime fantaisistes. Puis est venue la ruée pour alimenter chaque modèle de mème concevable dans la gueule algorithmique. D’ici mercredi, Elon Musk participait, un signe certain que tout cachet subculturel que la tendance aurait pu posséder brièvement s’était complètement évaporé.
Il y a quelque chose de particulièrement déprimant à propos de l’esthétique de Miyazaki devenant le modèle involontaire de cette expérimentation de masse par l’IA. Le style méticuleusement élaboré de l’animateur de 83 ans — produit de milliers d’heures de travail humain — a été approximé de manière grossière par la technologie même qu’il méprise si ouvertement. Lors d’une démonstration en 2016 qui a refait surface au milieu de cette tendance, Miyazaki a regardé des chercheurs en IA présenter une créature numérique grotesque qui se déplaçait en traînant sa tête sur le sol. Sa réponse était sans équivoque : « Je ressens fortement que c’est une insulte à la vie elle-même. » Il a poursuivi : « J’ai l’impression que nous approchons de la fin des temps. Nous, les humains, perdons foi en nous-mêmes. »
Neuf ans plus tard, les mots de Miyazaki semblent presque prophétiques. Que représente ce déluge de contrefaçons Ghibli générées par l’IA sinon une reddition collective de notre souveraineté artistique ? L’utilisateur moderne d’Internet, bombardé par un flux incessant de contenu, a externalisé même l’acte de manipulation d’image — autrefois une forme légitime d’art populaire numérique — aux machines. Le raccourci paresseux de demander à l’IA de simplement « faire en sorte que cela ressemble à Ghibli » remplace l’expression créative authentique par la pression d’un bouton.
Cette vacuité pointe vers une crise artistique plus profonde. Les mèmes créés par des humains, à leur meilleur, représentent une forme d’art légitime qui émerge organiquement de sensibilités individuelles distinctes. Considérons Donald Trump, dont le style de communication idiosyncratique a engendré d’innombrables mèmes mémorables qui ont contribué à le propulser vers la notoriété politique. De « covfefe » à « des mamelons proéminents […] très très irrespectueux » en passant par « des gens très bien », les particularités linguistiques de Trump ont créé de véritables moments culturels novateurs qui ont résonné bien au-delà de leur contexte immédiat. Ce n’étaient pas que des blagues mais des artefacts culturels authentiques, portant la signature indéniable de la créativité individuelle que l’IA ne peut pas reproduire.
Cependant, la tendance des mèmes de Studio Ghibli constitue la further “ensloppification” de la culture Internet. Quand n’importe qui peut générer des variations illimitées du même modèle de base avec un effort minimal, nous nous retrouvons avec une masse indifférenciée de contenu — ou « slop », pour utiliser le jargon Internet de plus en plus courant.
La rapidité avec laquelle le cycle Ghibli IA s’est déroulé illustre cela parfaitement. Ce qui aurait pu être autrefois une tendance d’une semaine avec des phases distinctes d’adoption, de perfectionnement et finalement de méta-commentaire ironique a été compressé en moins d’une journée. Au moment où les utilisateurs moyens prenaient conscience du phénomène, il était déjà déclaré « terminé » par ceux à la pointe. Et contrairement aux mèmes organiques qui pourraient connaître des renaissances ou évoluer en nouvelles formes, cette tendance générée par l’IA ne refera probablement jamais surface, sauf comme une note de bas de page dans le catalogue d’un futur archéologue numérique des phénomènes éphémères de 2025.
L’implication de Musk a scellé le destin de cette tendance. Lorsque les propriétaires de plateformes participent à la culture des mèmes, ils dépouillent toute énergie contre-culturelle restante. Tout au long de son mandat chez X, Musk a fonctionné comme un système de validation à lui seul pour le contenu qui attire son attention, transformant l’humour de niche en produits culturels largement accessibles mais rapidement épuisés. Sa participation marque le moment où une tendance devient officiellement mainstream — et donc instantanément passé.
Cependant, le schéma plus large représenté par la tendance Ghibli — la consommation algorithmique de l’art humain, la dévaluation du travail artistique et la reddition de l’agence créative aux machines — se poursuit sans relâche. La véritable tragédie n’est pas seulement que l’IA puisse désormais imiter le style de Miyazaki, mais que nous semblions de plus en plus contents de laisser les algorithmes remplacer entièrement l’impulsion artistique humaine. Lorsque nous abandonnons l’art à l’automatisation, nous perdons non seulement les voix distinctives des créateurs individuels, mais aussi notre pouvoir collectif d’expression créative.





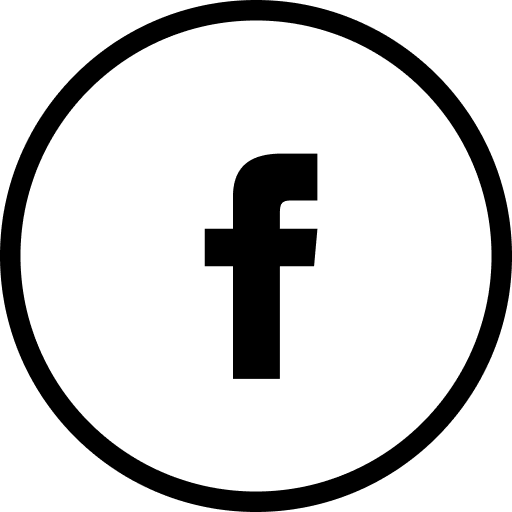
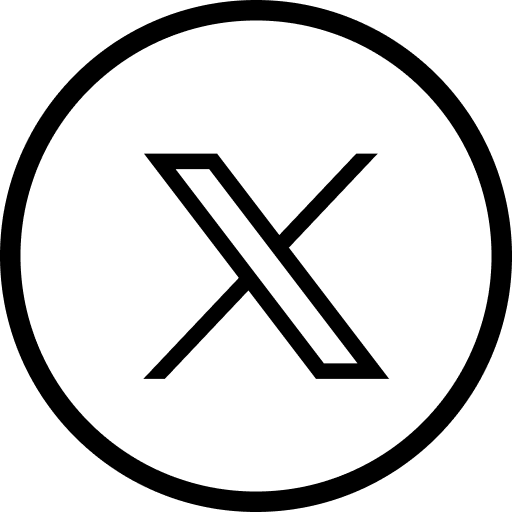
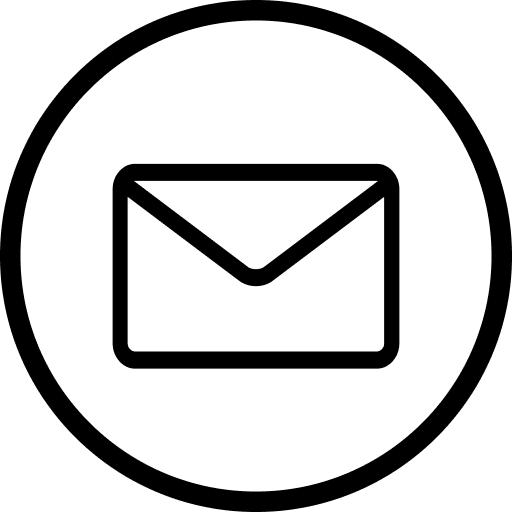

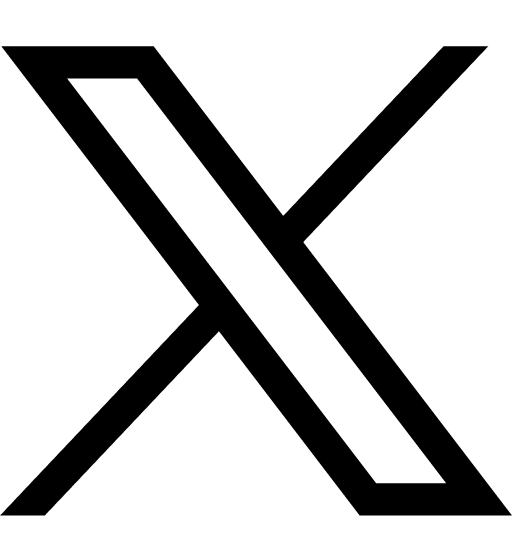
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe