Les jeunes hommes ne se battront plus pour la Grande-Bretagne. John D McHugh/AFP/Getty
La politique partisane britannique est devenue, au cours des dernières décennies, un exercice d’évasion de la réalité, ne traitant le monde — et les conditions matérielles de notre pays — que comme nos dirigeants souhaiteraient qu’il soit. La réaction chaotique de Westminster à l’inversion abrupte de Washington sur la guerre en Ukraine et la sécurité européenne, bien que longtemps annoncée, révèle que nos dirigeants découvrent tardivement le coût de vivre dans un monde de rêve. C’est une crise bien plus grave que celle de Suez, où la Grande-Bretagne a été brutalement montrée qu’elle n’était pas un partenaire égal dans les affaires mondiales, mais simplement un client subordonné. Les événements d’aujourd’hui, se déroulant si rapidement qu’à peu près tout commentaire est immédiatement obsolète, montrent que nous ne sommes même pas cela. Je ne peux pas penser à un gouvernement britannique de ma vie qui soit plus otage d’événements échappant à son contrôle. Dans la perte soudaine d’hypothèses de défense qui durent depuis des décennies, c’est une crise plus proche de celle de 1940 que de 1956.
Cependant, n’ayant pas su lire les signes il y a des décennies, ni même depuis 2022, la Grande-Bretagne ne créera pas une nouvelle architecture de sécurité fonctionnelle au cours de cette semaine. Si nous étions aussi proches de la guerre que le suggère Keir Starmer, le gouvernement ne procéderait pas avec l’accord ruineux sur Chagos ni avec le Net Zéro : le besoin de la Grande-Bretagne de repenser ses hypothèses stratégiques au cours des prochaines années doit être distingué du désir du Parti travailliste de prendre une pose patriotique à des fins électorales étroites.
Dans ce contexte, les discours bombastiques du groupe de centristes vieillissants de la Grande-Bretagne sur l’envoi de troupes pour faire respecter un accord de paix en Ukraine semblent valider la politique de Kyiv qui consiste principalement à mobiliser des hommes d’âge moyen : au-delà de la bulle de Westminster, il y a peu d’appétit pour engager notre armée brisée dans une tâche bien au-delà de ses capacités matérielles. Au cours des dernières décennies, l’armée britannique s’est entièrement refaite en une gendarmerie coloniale pour servir dans les guerres impériales de l’Amérique ; en Irak et en Afghanistan, elle a même échoué dans ce rôle. La guerre en Ukraine est une question de capacité industrielle et de main-d’œuvre, dont la Grande-Bretagne manque désormais totalement à cause de décennies d’échecs politiques. Même si l’armée se reconfigure entièrement pour cette nouvelle tâche, consacrant toutes ses ressources à l’effort, elle ne sera pas prête avant trois à cinq ans. Même alors, cette unique tâche est tout ce qu’elle serait capable de faire : patrouiller les lignes de cessez-le-feu de l’est de l’Ukraine signifiera un retrait de l’effort de dissuasion en Estonie, et l’absence d’une réserve stratégique pour une urgence. Quoi qu’il en soit, la prévarication de Starmer, même maintenant, sur l’augmentation des dépenses de défense à 2,5 % du PIB avant 2030 met même ce déploiement lilliputien hors de portée.
Ainsi, tout le drame de cette semaine n’était qu’un autre exercice de politique de défense fantasmée. Comme l’a correctement noté un observateur, le déploiement envisagé ne serait pas une mission de maintien de la paix, traditionnellement comprise comme l’imposition de forces par une puissance supérieure entre deux côtés belligérants plus faibles qui ont convenu de se désengager. En réalité, ce serait un effort de dissuasion qui, surclassé par des forces russes hostiles et nos alliés ukrainiens, manque totalement de la capacité de dissuader : un fil de fer vulnérable qui n’appelle aucune réponse. Les États-Unis ont déjà déclaré fermement que toute force européenne en Ukraine ne sera pas une mission de l’OTAN et ne bénéficiera pas du soutien américain ; la Russie a averti qu’en négociant un accord de paix avec Washington, elle n’acceptera pas de troupes de tout pays de l’OTAN en Ukraine. En proposant une mission britannique contre la volonté de la Russie, sans soutien américain, Starmer promet à Kyiv quelque chose qu’il n’a pas le pouvoir d’offrir. C’est semblable à sa promesse récente à l’Ukraine d’un pacte de sécurité d’un siècle. Qui peut dire que l’Ukraine existera encore dans 100 ans ? Qui peut dire que le Royaume-Uni le fera ? En l’absence de puissance militaire, la Grande-Bretagne ne peut offrir que des politiques de rêve, si abstraites et déconnectées de la réalité qu’elles en deviennent dénuées de sens. Quoi que la Grande-Bretagne puisse finalement offrir à la fin de la décennie, si des décisions difficiles sont prises maintenant, cela se fera soit avec l’approbation conjointe de Washington et Moscou — soit pas du tout. La dure vérité est qu’en l’absence de soutien américain, la Grande-Bretagne a désormais épuisé ses options pour soutenir l’effort de guerre de l’Ukraine.
La semaine dernière a donc servi de test à la capacité de nos dirigeants à distinguer entre des sentiments grandiloquents mais dépourvus de contenu, et la réalité objective : c’est un test que la plupart de Westminster a échoué. Comme l’observe l’historien militaire Robert Lyman, depuis longtemps critique du désarmement unilatéral de la Grande-Bretagne, cette semaine, le discours a été « des absurdités embarrassantes, des slogans politiques de personnes vides leur permettant de paraître dures et vertueuses ». Les événements de la semaine tournent autour de la question la plus grave imaginable, concernant la sécurité de la nation et, en fin de compte, sa survie. Voir un homoncule politique comme Ed Davey, leader du quatrième parti le plus populaire du pays et mieux connu pour danser sur TikTok, condamner toute expression de prudence comme du léchage de bottes poutinien éteint toute crédibilité qu’il aurait pu avoir en tant que figure sérieuse.
Au lieu de cela, l’évaluation sobre et prudente des options militaires déclinantes de la Grande-Bretagne par le député libéral-démocrate et analyste stratégique Mike Martin peut être lue comme un doux reproche à son absurde leader de parti. Comme le note Martin, l’idée de tout déploiement immédiat de troupes britanniques est à la fois « prématurée et stratégiquement illettrée ». De plus, il ajoute, « ‘fixer’ des troupes européennes en Ukraine rend la Pologne, la Finlande et les États baltes beaucoup plus vulnérables » — en dépouillant l’UE et ce qui reste de la capacité de l’OTAN à défendre ses propres frontières, en envoyant toute sa capacité militaire dans une mission vulnérable et non soutenue sur un front lointain. C’est pour cette raison précise que la Pologne, un faucon ukrainien et un acteur militaire sérieux en première ligne contre une Russie renaissante, a désavoué la proposition : un tel réalisme sobre est presque entièrement absent parmi notre propre classe politique.
Peu de personnalités de Westminster ont bien émergé de cette crise. Au-delà de Martin, une exception est le député conservateur Nick Timothy, qui a observé avec précision que la seule réponse crédible à la crise actuelle n’est pas des promesses vides à l’Ukraine maintenant, mais un effort rapide de réarmement et d’industrialisation pour défendre la Grande-Bretagne à l’avenir. L’approche de crise par essais du Labour en matière de sécurité nationale — courant partout pour faire des promesses à Kyiv qu’il ne peut pas tenir, tout en tentant de convaincre Washington de s’engager dans un « filet de sécurité » qu’il a déjà rejeté — montre notre gouvernement refusant d’accepter la réalité du monde dans lequel il vit. En période de crise nationale, l’État britannique est aussi convaincant dans son tourbillon d’activité professionnelle que des enfants dans une crèche jouant au magasin.
C’est un peu la même chose avec les dirigeants européens assis autour d’une table à Paris, comme un conjoint refusant d’accepter que son mariage est terminé : nous allons changer, promettent-ils, nous allons nous mettre en forme et nous engager davantage dans la relation. Mais Washington est passé à autre chose, regardant des partenaires plus attrayants. Pour les Américains, la Russie est une puissance sérieuse avec laquelle ils peuvent traiter, si ce n’est pas en tant qu’égaux, alors avec un niveau de respect que l’Europe ne mérite pas. Si l’Europe n’avait pas fermé sa capacité industrielle, si elle s’était sérieusement réarmée en 2022, ses dirigeants seraient en mesure d’offrir des garanties de sécurité à l’Ukraine maintenant. Le fait que l’Europe ait choisi Kaja Kallas, ancienne Première ministre d’un pays dont la rhétorique belliqueuse contre la Russie était soutenue par une population de la taille de Birmingham, comme sa responsable de la politique étrangère révèle la préférence du continent pour une rhétorique grandiloquente plutôt que pour l’action, des mots sévères dissimulant des arsenaux vides. Il y a moins d’un an, Kallas était engagée dans des fantasmes publics de découpage de la Russie en petits États ethniques faibles ; maintenant elle implore Washington d’avoir une place à la table pour décider de l’avenir de l’Europe. C’est notre destin d’être gouvernés par des gens peu sérieux, et de souffrir en conséquence.
La faiblesse de l’Europe, il faut s’en souvenir, est autant le produit de la politique américaine que de notre propre incapacité. Après la guerre froide, il convenait à Washington de maintenir l’Europe en tant que partenaire subordonné, tout comme il convenait à l’Europe de dilapider le dividende de la paix sur sa propre vision imaginaire de l’ordre mondial. Notre classe de securocrates européens, les plus serviles en Grande-Bretagne, ont été élevés à leurs fonctions précisément en raison de leur engagement envers la dépendance : Washington les a maintenant abandonnés aussi brusquement qu’il l’a fait avec leurs équivalents afghans, mais contrairement à l’Afghanistan, ils restent en poste, serviteurs sans maître. Ils tiennent des conférences qui ne peuvent rien décider, car toute décision appropriée au moment est hors de leur portée ; ils déplacent des armées fantômes sur des cartes uniquement comme un exercice pour signifier leur détermination aux Russes, leur sérieux aux Américains et leur compétence à leurs propres électeurs. Comme dans tous les aspects de la gouvernance désastreuse de l’Europe post-guerre froide, ce sont les personnes qui ont créé la crise qui restent aux commandes. Même admettre leur échec, et celui de la vision du monde qui y a conduit, c’est accélérer leur remplacement. Donc, pour l’instant, les mêmes vieux rituels sont exécutés, les mêmes mantras sont chantés pour éviter le désastre. Pourtant, leur patron a tourné le dos, et leurs publics les haïssent de plus en plus : les dirigeants de l’Europe sont des Ceaușescu sur le balcon, agitant nerveusement la main à la foule.
Il est donc impossible de prendre au sérieux des députés travaillistes comme Paulette Hamilton, jusqu’à présent mieux connue pour avoir envisagé un soulèvement armé des Noirs contre l’État britannique, appelant à la conscription de la « jeunesse désengagée » de la Grande-Bretagne pour défendre les frontières de l’Ukraine. Comme la démocratie de masse du XXe siècle, la capacité d’un pays à mener une guerre totale par la mobilisation de masse est le produit d’une société qui a passé des décennies, voire des siècles, à aplanir les différences internes et à construire un sentiment d’identité commune. Comme Hamilton, les voix qui essaient maintenant d’éveiller un esprit martial parmi les jeunes sont précisément celles qui ont érodé cette même identité commune : quelque chose qu’ils ont réalisé en une seule génération. Leurs exhortations frénétiques prouvent maintenant qu’ils ne comprennent même pas le nouveau pays fracturé qu’ils ont si efficacement créé. La même semaine où le gouvernement a tenté de raviver un patriotisme résiduel autour de l’Ukraine, Dominic Cummings et un professeur du King’s College London ont réfléchi à la probabilité d’un conflit civil sérieux en Grande-Bretagne dans la décennie à venir. On peut discuter des détails, mais le fait que la question puisse être soulevée de manière crédible met en lumière les dangereuses divisions internes empêchant la Grande-Bretagne de s’engager maintenant dans une guerre majeure — du moins avec une chance de succès.
Après tout, les principaux terrains de recrutement de l’armée, les villes post-industrielles du nord de l’Angleterre, étaient juste l’été dernier le foyer d’une révolte violente contre l’État britannique : il est douteux que les mêmes jeunes hommes se battent pour préserver le régime actuel. L’État, dans sa forme actuelle, ne commande pas la loyauté nécessaire pour persuader les jeunes hommes d’aller à la guerre. Il n’a pas non plus le pouvoir de les contraindre : toute tentative de ce type ressemblerait davantage à la crise de conscription irlandaise de 1918 qu’à la mobilisation de masse de 1939. Les tendances politiques et diplomatiques de haut en bas qui poussent la Grande-Bretagne à s’impliquer davantage en Ukraine sont désormais en dangereux désaccord avec le désenchantement croissant de bas en haut vis-à-vis du système actuel de Westminster. La dysfonction interne de la Grande-Bretagne non seulement érode la volonté du pays de se battre ; c’est aussi une vulnérabilité interne facile à exploiter pour la Russie, pour plier Westminster à sa volonté — ou en effet, pour le nouveau régime révisionniste de Washington de faire de même. En somme, il est difficile d’imaginer la Grande-Bretagne entrer dans un conflit pour lequel elle est entièrement non préparée, dirigée par un gouvernement qui est largement méprisé, et en sortir avec son système politique peu aimé encore intact.
Comme pour la politique intérieure de la Grande-Bretagne, les dirigeants du pays ont évité des réformes stratégiques essentielles lorsqu’elles étaient des processus désagréables mais contrôlables. Maintenant, intensifiés et exacerbés, les deux ont échappé au contrôle de Westminster, risquant un désastre ingérable. Parce que son patron américain a perdu tout intérêt, l’Ukraine a perdu la guerre, transformant un effondrement lent et laborieux en une paix soudaine et difficile. Le commentaire de Westminster, brut de choc et de véritable incrédulité, est le produit d’une classe politique qui a jusqu’à présent profité d’une réalité parallèle de sa propre construction, où la détermination occidentale était ferme et où la Russie était toujours à quelques mois de l’effondrement. Toute suggestion, même de la part des généraux les plus hauts placés d’Amérique, de négocier la paix alors que l’Ukraine commandait une brève position de force a été rejetée comme du défaitisme — ou pire, du poutinisme. À travers leur évasion de la réalité, les fervents partisans maximalistes de l’Ukraine possèdent désormais les dures conditions de cessez-le-feu du pays. Il y a une leçon ici, s’ils sont prêts à l’apprendre. Si tout ce bruit et cette fureur aboutissent enfin à ce que l’Europe puisse se défendre et défendre les intérêts de son peuple, en s’engageant avec le monde difficile de la réalité, alors tout cela aura été pour le bien. Nos dirigeants peuvent soit accepter que le monde dans lequel ils vivent a disparu, aussi rapidement et irrévocablement qu’un rêve réconfortant, et contrôler leur descente dans le nouvel ordre. Ou ils peuvent continuer leur rêverie, risquant ainsi un effondrement soudain et total.








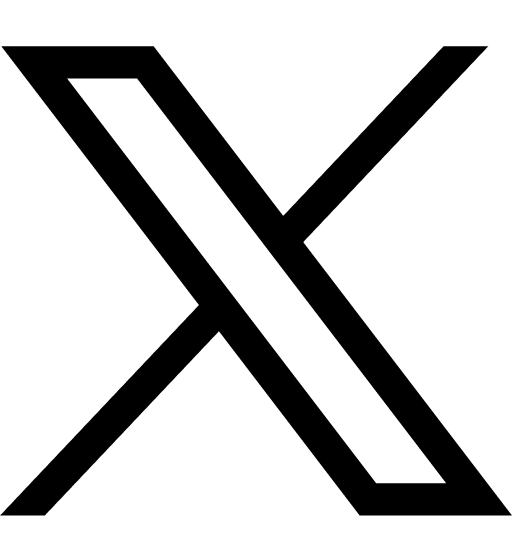
Join the discussion
Join like minded readers that support our journalism by becoming a paid subscriber
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe