Vue en contre-plongée d'une caravane de chameaux, silhouettée contre le soleil, sur la Route de la Soie dans la dépression de Tarafan, province du Xinjiang, Chine, avril 1980. (Photo de Tom Nebbia/Corbis via Getty Images)
Attendez-vous à des effusions de sang. Les premiers coups de feu ont été tirés entre l’Inde et la Chine dans le bizarre Historikerstreit de l’Asie. Ses instigateurs, curieusement, sont deux historiens britanniques — Peter Frankopan et William Dalrymple — qui, paradoxalement, partagent des positions largement convergentes. Mais cela importe peu. L’histoire, semble-t-il, est désormais trop cruciale pour être laissée aux seuls historiens.
Les nationalistes, pour qui l’histoire est avant tout un instrument de justification idéologique, se sont emparés de leurs arguments. Ainsi, un débat initialement ésotérique sur les économies anciennes a pris une tournure géopolitique contemporaine. Résultat : une dichotomie simpliste s’est imposée, où Frankopan est perçu comme pro-Chine et Dalrymple comme pro-Inde.
Mais, pour être honnête, ils appartiennent à la même équipe. L’impulsion sous-jacente à leurs ouvrages respectifs, The Silk Roads et The Golden Road — tous deux consacrés au commerce mondial — est de vaincre un ancien ennemi, gravement affaibli mais loin d’être éradiqué : l’eurocentrisme. D’où l’accent mis sur la diffusion culturelle, souvent perçue dans l’imaginaire collectif comme un ensemble de legs occidentaux adressés à un Orient obscurci. En réalité, leur objectif est de démontrer que ces échanges se faisaient en grande partie, bien que non exclusivement, dans la direction inverse.
Il existe certes des divergences de perspective dans leurs récits — Frankopan étant byzantiniste, Dalrymple indianiste. Mais leur ambition historiographique globale est identique, nourrie probablement par des parcours intellectuels similaires. Né d’un père dalmate et d’une mère suédoise, Frankopan a été influencé par les cours de Jonathan Shepard, spécialiste de Byzance à Cambridge. Son premier ouvrage, un récit de The First Crusade, privilégiait les sources grecques plutôt que latines, renversant ainsi les perspectives habituelles. Dalrymple, issu d’une famille aristocratique des Highlands, a également étudié à Cambridge avant de devenir écrivain voyageur, explorant les mêmes territoires sud-asiatiques que certains de ses ancêtres. Pour ces deux hommes, leurs trajectoires biographiques ont clairement constitué des antidotes puissants à toute forme d’insularité. Avec de tels parcours, il n’est guère surprenant qu’ils aient évité le piège du petit chauvinisme britannique.
Cette habitude d’esprit était alignée avec une sensibilité historique. Nés en 1965 et 1971 respectivement, Dalrymple et Frankopan appartiennent à la même génération, devenant écrivains à une époque où le public britannique dévorait avec plaisir des tomes de 1 000 pages sur, disons, les révolutions française et russe. C’était une période où les récits volumineux se vendaient comme des livres de cuisine pour friteuses à air, une époque propice à l’histoire accessible au grand public. Heureusement, c’était aussi une époque relativement innocente de contrats précaires et de postmodernisme prétentieux ; des considérations pécuniaires et les dictats stylistiques de l’académie auraient empêché beaucoup de gravir les sommets de l’intellectualisme public à une époque ultérieure. Dalrymple a pris la défense de l’histoire populaire avec une série de quatre ouvrages sur le Raj — une variation plus sombre de la trilogie de Jan Morris — avant de se tourner à nouveau vers l’antiquité indienne. Frankopan, quant à lui, a évolué dans les deux directions, embrassant la longue durée dans ses récits de la Route de la soie et du changement climatique.
Présenté comme une « nouvelle histoire du monde », rien de moins, The Silk Roads offrait une vision hautement idiosyncratique de l’histoire mondiale, nous donnant le point de vue des Stans, pour ainsi dire. Halford Mackinder a qualifié la région de « cœur » du monde, dont le contrôle est le sine qua non de l’hégémonie mondiale — un argument provocateur lorsqu’il a été formulé en 1904, bien que désormais considéré comme une sagesse commune dans les cercles de think-tank. L’ampleur de Frankopan — englobant les Achéménides et les Abbassides, louant les Perses et les Mongols, dépeints ici non pas comme des crétins barbares mais comme des porteurs d’une civilisation sophistiquée — avait sans doute une touche de whiggisme, confirmant l’observation ironique de Herbert Butterfield selon laquelle la compression historique tend souvent vers l’optimisme. On peut comprendre pourquoi les mandarins de Pékin en sont tombés amoureux. Le commerce est en tête d’affiche dans ces pages. La guerre et les préjugés — entre Arabes et Juifs, Chrétiens et Musulmans — reculent souvent de la vue. C’était le genre d’histoire réconfortante que les architectes d’une nouvelle Route de la soie pouvaient soutenir.
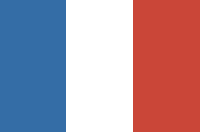
 Édition Principale
Édition Principale US
US





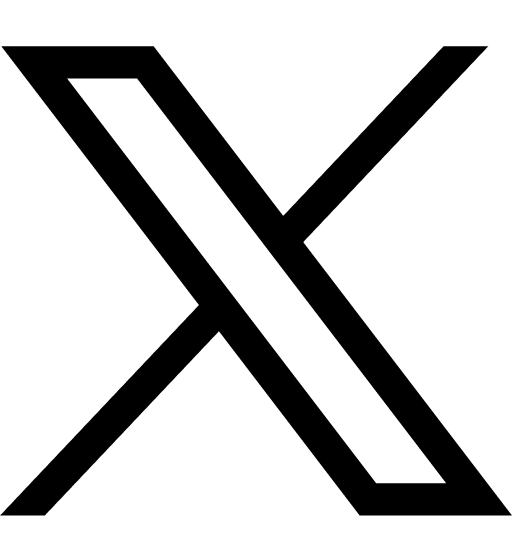
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe