Bois norvégien /
Pour les Japonophiles d’âge moyen, le récent boom du Japon parmi les jeunes peut parfois sembler épuisant. La pop japonaise, rapide et implacable, ressemble à quelque chose concocté par des bambins en pleine hyperglycémie. Pendant ce temps, la popularité des mangas et des animes en Occident semble reposer sur leur combinaison de combats, de gore et de quêtes interminables. Mais pour ceux d’entre nous qui ont découvert la culture japonaise durant les années 90 et le début des années 2000, tout tournait autour des films, de la nourriture, des cartouches Nintendo volumineuses — et de Haruki Murakami, dont le dernier roman, La Ville et ses murs incertains, sort cette semaine.
Être un fan du Japon respectueux de soi dans les années 90 signifiait tourner le dos aux sombres souvenirs de nos grands-parents sur la Seconde Guerre mondiale tout en rejetant comme des balivernes d’office du tourisme l’image clichée du Japon comme un endroit où la haute technologie rencontre des valeurs et une esthétique traditionnelles. Pour vraiment « comprendre » le Japon, nous étions tous sincèrement convaincus que cela nécessitait des efforts. Beaucoup d’entre nous se tournaient, pour des éclairages, vers des romanciers japonais en traduction. Dans les décennies passées, Yasunari Kawabata était une option populaire. Mais l’écrivain lauréat du prix Nobel appartenait à l’ancien Japon : son œuvre classique de 1948, Le Pays de neige, était un hymne à un pays qui était déjà en train de disparaître quand il était jeune homme. Au lieu de cela, nous nous tournions vers Murakami comme notre clé littéraire pour la psyché japonaise.
Il y avait une grande ironie là-dedans. Lorsque Murakami est devenu un grand nom au Japon, grâce au succès fulgurant de Norwegian Wood en 1987, les critiques étaient rapides à souligner à quel point il était peu japonais. Né en 1949, pendant l’occupation alliée du Japon après-guerre, Murakami lisait des romans européens et américains en anglais au lycée, étudiait le théâtre à l’université et tenait un bar de jazz avec sa femme à Tokyo avant de se consacrer à plein temps à l’écriture. Il avait peu de temps pour la littérature japonaise, après avoir entendu ses parents — tous deux enseignants — en parler à n’en plus finir pendant son enfance.
Réaliser que tout cela l’avait laissé incapable d’écrire de la fiction dans sa langue maternelle, Murakami composa ses premières lignes en anglais puis les traduisit en japonais. Son vocabulaire anglais relativement modeste l’obligeait à écrire en phrases courtes et simples. Un style est né, avec lequel des millions de lecteurs à travers le monde finiraient par devenir intimement familiers.
Pour les légions de jeunes fans de Murakami, Norwegian Wood semblait résolument contemporain et cosmopolite. Il raconte l’histoire d’un homme dans la trentaine, Toru Watanabe, qui entend une interprétation de « Norwegian Wood » des Beatles et est transporté dans sa jeunesse des années 60 : une époque exaltante de manifestations étudiantes et d’amitiés intenses et tragiques. La langueur et le désir qui imprègnent le roman, alors qu’un groupe de jeunes essaie de donner un sens à leur vie au milieu des bouleversements politiques et de la déception, ont résonné non seulement avec les lecteurs au Japon mais aussi à Taïwan et en Corée du Sud : ils avaient vécu des expériences similaires durant les mouvements démocratiques de leurs pays dans les années 80.
Les détracteurs japonais de Murakami, en particulier ceux attachés au genre de la « littérature pure » haut de gamme du pays, ont rejeté son œuvre comme « inodore » et dépourvue de tout sens du lieu. Avec son intérêt pour la bière, le café et le jazz, et l’absence relative de points de référence japonais dans son œuvre, Murakami semblait être, comme Theresa May aurait pu le dire, un citoyen de nulle part. Pour Kenzaburō Ōe, lauréat du prestigieux prix Akutagawa du Japon en 1958 et du deuxième prix Nobel de littérature du pays en 1994, le problème était en partie générationnel. Ōe a désigné à la fois Murakami et Banana Yoshimoto comme de jeunes auteurs qui, contrairement à leurs prédécesseurs littéraires qui écrivaient sur les tragédies de la guerre, vendaient des centaines de milliers de livres en flattant une jeunesse désabusée, « contente d’exister au sein d’une sous-culture d’adolescents tardifs ou post-adolescents ».
Des opinions comme celles-ci ont probablement empêché Murakami de remporter le prix Akutagawa et d’être accepté dans l’establishment littéraire japonais. Il semble avoir ressenti le rejet de manière aiguë, choisissant de quitter le Japon au milieu des années 80 lorsque la combinaison d’une hostilité critique et d’une célébrité populaire croissante est devenue trop lourde. Il s’est d’abord installé en Europe puis aux États-Unis. Pendant ce temps, sa renommée s’est répandue du Japon et de l’Asie de l’Est vers l’Occident, alors que les lecteurs de Norwegian Wood et de son A Wild Sheep Chase magique réaliste s’enthousiasmaient de leur rencontre avec un Japon cool et rebelle. C’était un contraste frappant avec le stéréotype parmi les Occidentaux à l’époque sur le conformisme japonais.
Mais peut-être plus important que la rébellion de Murakami était son universalisme. Il a un talent pour dépeindre les relations humaines comme incertaines et à moitié formées, forgées et maintenues ensemble par des silences et de l’étonnement autant que par de véritables rencontres d’esprits. On ne lit pas Murakami pour la qualité de ses dialogues, mais, en lisant Norwegian Wood, on a le sentiment de comprendre un peu mieux à la fois le Japon et soi-même dans le processus.
Quelques années plus tard, ceux qui avaient accusé Murakami de céder à la fantaisie, tandis que des romanciers comme Ōe s’attaquaient au passé guerrier du Japon, reçurent une sorte de réponse. Son The Wind-Up Bird Chronicle de 1995 traversait des scènes inspirées par la mythologie et l’histoire japonaises : des maisons abandonnées, de vieux puits et le transcendant s’immisçant dans la vie humaine au milieu de la boue et du bruit des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.
C’était la première fois que Murakami assumait le genre de responsabilité sociale qui était attendue d’un romancier japonais. Écrivant The Wind-Up Bird Chronicle depuis chez lui aux États-Unis, il attribuait son retour vers son pays d’origine à l’opportunité qu’il avait d’y voir de loin. Kenzaburō Ōe approuvait pleinement, siégeant au comité qui a décerné à Murakami le Prix littéraire Yomiuri en 1995.
C’est ce sens de la responsabilité qui a ramené Murakami au Japon cette même année, après deux désastres survenus à quelques semaines d’intervalle. En janvier, un tremblement de terre a tué plus de 6 000 personnes. Puis, deux mois plus tard, la secte apocalyptique Aum Shinrikyō a libéré du gaz sarin dans le métro de Tokyo. Bien que beaucoup moins mortel que le tremblement de terre, l’attaque a eu un impact troublant sur le Japon — les membres de la secte se sont révélés être des jeunes gens ordinaires et intelligents qui étaient devenus profondément désillusionnés par la vie au Japon. En interviewant les victimes des attaques, Murakami a réfléchi à ce que cela signifiait pour le Japon dans Underground (1997). C’est peut-être son meilleur ouvrage de non-fiction à ce jour et fait partie de ce qu’il a décrit comme son tournant des années 90, passant du « détachement » à l’« engagement » en tant que romancier. Il a commencé à s’intéresser à la manière dont les systèmes sociaux et politiques piègent les gens, comparant ces systèmes dans un discours de 2009 à de hauts murs contre lesquels les gens se jettent comme des œufs.
En tant que jeune écrivain, Murakami n’a jamais imaginé qu’il deviendrait si célèbre en Occident, que les librairies organiseraient des ouvertures à minuit pour célébrer la sortie de ses livres. Une grande partie du mérite en revient à ses traducteurs anglais, dont Alfred Birnbaum et Jay Rubin. Les publics européens ont suivi le mouvement, via des traductions souvent réalisées à partir de l’anglais plutôt que des versions japonaises originales des œuvres de Murakami. Ses livres ont maintenant été traduits en plus de 50 langues. Les fans inconditionnels de Murakami — les « Harukists », comme on les appelle — seront ravis de découvrir qu’à Taïwan, il existe même un centre de recherche dédié à l’étude de son œuvre.
À la fin des années 90 et au début des années 2000, Murakami a continué à produire des romans acclamés par la critique. Bien que chacun de ces livres ait été attendu avec impatience, les commentateurs ont commencé à noter une tendance chez Murakami à revenir à des thèmes favoris — inspirant un dessinateur de New York Times à créer Haruki Murakami Bingo, avec des entrées incluant des chats, la cuisine et des fétiches d’oreilles.
Moins susceptible de trouver une place dans Murakami Bingo est le « personnage féminin étoffé ». Même les fans de l’œuvre de Murakami ont noté que les femmes dans ses romans sont souvent solitaires, brisées ou d’une certaine manière mystérieuses aux yeux des protagonistes masculins. Elles sont là, semble-t-il, principalement pour servir les hommes : clarifiant quelque chose pour eux ou fonctionnant comme des « médiums… présages du monde à venir », comme l’a lui-même formulé Murakami.
Il est sûr de dire que le nouveau livre de Murakami, The City and Its Uncertain Walls, ne fait guère pour répondre à ces critiques. Nous sommes une fois de plus dans la tête d’un narrateur masculin doucement troublé, légèrement nostalgique, qui découvre que les frontières entre son monde et un autre peuvent être diaphanes. Au Japon, où Murakami reste une grande figure — bien qu’il ne soit jamais accepté dans l’establishment littéraire du pays — le livre a reçu des critiques mitigées et parfois légèrement confuses. Mais la magie de Murakami reste intacte. Me replonger dans son rythme onirique ressemble à un retour dans un bain chaud. Les vieilles images et émotions reviennent, certaines d’entre elles étant maintenant accentuées, ayant suffisamment d’années au compteur pour partager l’étonnement de Murakami face au passage du temps.
Heureusement, pour ceux d’entre nous qui se retrouvent à utiliser des phrases vieillottes comme « dans les années 90 », Murakami suggère que « la vérité ne se trouve pas dans une immobilité fixe mais dans un changement et un mouvement incessants ». Cela me semble être un encouragement à ne pas rester trop longtemps dans le mode nostalgique signature de Murakami et plutôt à embrasser ce qui nous entoure maintenant — à l’exception possible du J-Pop. Une nouvelle consolation, donc, d’un vieux maître.








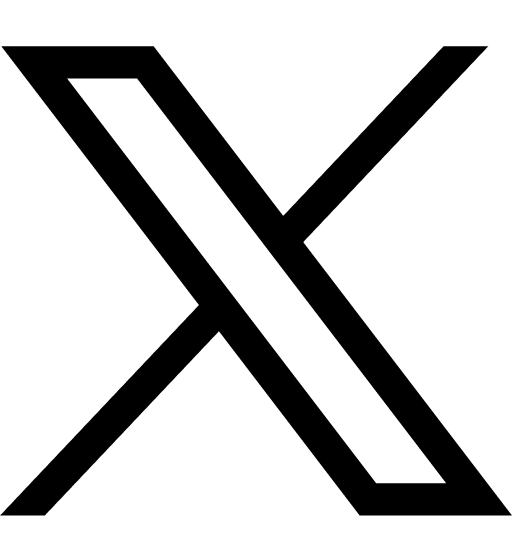
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe