IMMOKALEE, FL - 9 SEPTEMBRE : Un travailleur agricole est assis le long d'une rue dans la communauté rurale agricole d'Immokalee le 9 septembre 2018 à Immokalee, en Floride. La communauté d'Immokalee, qui est principalement composée de travailleurs agricoles saisonniers, a été gravement touchée par l'ouragan Irma qui a causé de graves inondations dans la région. Près d'un an plus tard, de nombreux résidents n'ont toujours pas complètement récupéré de la tempête. Les maisons mobiles représentent environ un quart du logement à Immokalee et beaucoup ont été détruites lors de la tempête de catégorie 3 qui a causé d'importants dégâts dans tout l'État. (Photo par Spencer Platt/Getty Images)
Un simple coup d’œil aux gros titres souligne ce que la plupart des travailleurs de moins de 40 ans pressentent. Une inégalité de richesse insondable, des salaires stagnants ou à peine en amélioration, une espérance de vie en baisse et une énorme pénurie de logements renversent les gains durement acquis du 20ème siècle. Et il n’y a eu qu’un progrès hésitant vers la réforme dans la plupart des pays occidentaux. Les propositions ambitieuses des progressistes ont été sapées par leur incapacité à abandonner le dogme de la politique identitaire et à construire une grande tente. À droite, en revanche, les mesures visant à soutenir les subventions familiales et la politique industrielle — des questions autrefois prioritaires pour la gauche d’après-guerre — ont été tièdes.
Aggravant cette impasse, des débats sur le type de réforme nécessaire : si des investissements comme la réindustrialisation ou des programmes de bien-être sont les plus urgents ; si un État actif peut résoudre la crise du développement ; et si une taxe mondiale sur la richesse est préférable à des expériences protectionnistes de « déglobalisation ». La Bidenomics semble avoir eu peu d’effet d’entraînement à travers l’Occident, tandis que Kamala Harris et Donald Trump ne font que des promesses vagues sur la croissance économique.
Nos défis sont, cependant, seulement la dernière itération d’un problème ancien. Comme le souligne le nouveau livre de David Lay Williams, The Greatest of All Plagues, les coûts sociaux, politiques et économiques d’une inégalité béante ont préoccupé une gamme éclectique de philosophes au fil des millénaires — de Platon à Marx en passant par Jésus, Hobbes, Rousseau, Adam Smith et J.S. Mill. S’accordant largement à dire qu’il s’agit à la fois d’un problème matériel et spirituel, les penseurs de Williams nous confrontent à des arguments puissants contre l’inégalité : elle dégrade la civilisation car elle récompense la cupidité au détriment de la communauté, détruisant finalement toute base pour la coopération sociale et le respect de l’État de droit. Pourtant, pour presque tous ces philosophes, le maintien de la vertu civique et du bien public doit être central à tout projet qui pourrait réduire fondamentalement l’inégalité. Cela les distingue de nombreux progressistes modernes, dont la préoccupation pour les identités de groupe et les injustices historiques empêche finalement une vision cohérente de ce qui pourrait inverser les effets néfastes de l’inégalité. Si les réformateurs d’aujourd’hui veulent vraiment mobiliser le public, ils doivent identifier, comme l’ont fait ces philosophes, ce qu’il y a dans la société qu’ils visent à conserver.
La peur de la désunion qui débouche sur des conflits civils violents est un thème fréquent tout au long du livre. Lorsque les citoyens ne considèrent plus la loi comme juste et impartiale, avertissent ces philosophes, le factionnalisme augmente. Résumant Hobbes, qui n’est pas exactement connu pour vanter les avantages holistiques du bien-être civique, Williams écrit que « un commonwealth tolérant la faim inutile flirte avec sa propre disparition ». Les effets délétères de la cupidité, ou pleonexia, s’étendent cependant au-delà de l’effondrement de l’ordre et de la loi. Rousseau observe que cela détruit la compassion, laissant les démunis encore plus impuissants et haïs. Comme il écrit à propos de l’homme pauvre : « toute assistance gratuite lui échappe lorsqu’il en a besoin, précisément parce qu’il manque des moyens de la payer. » Les pauvres, à leur tour, succombent à la même vision avare de ceux qui règnent injustement.
Voici l’un des aperçus les plus importants du livre de Williams : la résignation généralisée à ces conditions parmi les classes ouvrières épuise finalement le désir humain de liberté. Certains lecteurs peuvent pointer vers la philanthropie moderne pour suggérer que la cupidité omniprésente n’est pas une force inexorable qui détruit la vertu parmi l’élite. Pourtant, selon Rousseau et Mill, la violence spirituelle de l’inégalité extrême n’est pas atténuée par une poussée de bonnes actions. Au contraire, Rousseau écrit que les pauvres perdent leur liberté lorsqu’ils deviennent dépendants des riches. De même, Mill souligne que la pauvreté engendre la dépendance, obstruant les talents qui propulsent le développement humain. C’est une situation qui ne peut être facilement remédiée par des mesures compensatoires.
Les tentatives d’adoucir l’inégalité par la philanthropie doivent donc être examinées : élèvent-elles le bien-être général tout en permettant à l’individu de tracer son propre chemin, ou placent-elles ceux qui désespèrent de travail et de pain à la merci totale des élites ? Du point de vue de Mill, il y avait des bénéfices mentaux et moraux de l’accomplissement individuel. Par conséquent, s’il était immensément sceptique à l’égard de la charité privée, considérant l’économie victorienne comme fondée sur « la conquête et la violence », il est douteux qu’il aurait soutenu le socialisme d’État du type expérimenté en Europe de l’Est.
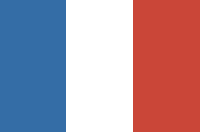
 Édition Principale
Édition Principale US
US





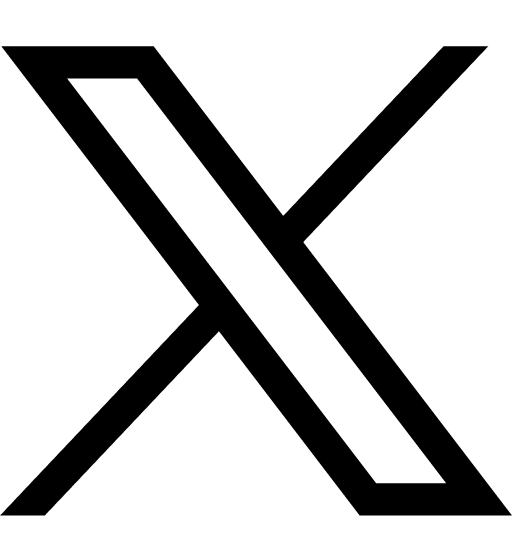
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe