Riot police gather in Rotherham (Christopher Furlong/Getty Images)
Alors que le système judiciaire britannique continue d’incarcérer des guerriers du clavier trop zélés liés aux émeutes, et que les ‘guerriers’ de la liberté d’expression répondent par des grommellements dystopiques sur un État policier orwellien, nous nous trouvons dans une situation étrange. Mettez de côté la gesticulation bien répétée concernant les doubles standards, la duplicité et le contexte — et sous la luminosité de l’écran noir se cache un point d’accord conceptuel partagé. À travers le spectre politique, dans certaines circonstances, il est désormais accepté que la parole peut effectivement être violente.
Mais ce développement doit-il être accueilli ?
Retournons dans les années 60, un moment trop romantisé de ferveur révolutionnaire où certains intellectuels avaient même acquis un attrait de rock star (du moins dans les cafés français). Il y avait alors une attaque ouverte contre le langage et sa connexion à notre compréhension du monde. Mené par de grands penseurs tels que Michel Foucault et Jacques Derrida, ce qui était considéré comme le marqueur important de toute civilisation partagée — la langue qui nous distingue des animaux plus barbares, comme le suggérait Aristote — n’était plus pris pour acquis. Les phrases que les gens utilisaient n’étaient pas simplement apprises, mais le résultat d’une bataille historique tumultueuse qui normaliserait souvent des systèmes d’oppression, de soumission et des formes cachées de violence. En bref, ce qui était et ce qui n’était pas dit pouvait être réduit à un seul mot : pouvoir.
Alors que la politisation du langage a continué à un rythme soutenu, aborder son pouvoir inhérent est devenu une préoccupation dominante pour toutes sortes de commentateurs sociaux. En bref, si la légitimité d’une revendication concerne vraiment le pouvoir d’imposer des vérités vérifiables, tout ce qui passe pour véridique est finalement une question de perspective. Il n’est pas surprenant que la phrase souvent citée « le terroriste d’un homme est le combattant de la liberté d’un autre » soit devenue une partie intégrante du discours politique standard.
Cependant, le problème avec la perspective est que deux personnes ne vivent jamais le même événement de manière identique. De plus, même au sein des cercles ‘postmodernistes’, il y avait un certain avertissement contre une glissade dans un abîme purement subjectif où la véracité du langage risquait de perdre tout sens. Cela était particulièrement vrai lorsqu’il s’agissait du mot le plus émotif de tous : violence. Hannah Arendt, par exemple, s’efforçait de soutenir que les mots devaient signifier des choses très spécifiques ; donc quand nous parlions de violence, nous voulions vraiment dire violence physique et le déni même de l’humanité d’une personne. De même, Frantz Fanon soutenait que parler de violence signifie parler d’une sorte ‘d’intention’.
Cependant, l’intention n’est pas moins chargée. Comme les experts en terrorisme l’ont compris depuis un certain temps, la motivation est très difficile à prouver. Si une personne possède des manuels de formation pour al-Qaïda et suffisamment de peroxyde pour faire exploser un centre commercial, mais ne fait que communiquer sa haine pour l’Occident, les accusations d’intention peuvent s’appuyer sur des lois de probabilité, comme cela a été le cas. Mais de tels cas sont rares. Ainsi, comme le montre l’élargissement du filet de sécurité pendant la guerre contre le terrorisme, une fois que le langage devient sécurisé et que les actes répréhensibles sont liés à des revendications d’extrémisme marquées par une intention, le chalutier tend à s’étendre et à attraper ceux dont les mots pourraient facilement être interprétés comme simplement mal réfléchis.
Souscrire à la sécurisation du langage tend à créer des corrélations soignées, qui tracent une ligne claire entre ce qui est dit et ce qui sera mis en œuvre. Mais pour que l’intention fonctionne, si quelqu’un dit qu’il veut brûler la maison, il faut supposer qu’il a effectivement l’intention à un moment de sa vie de faire brûler cette maison. La fantaisie devient ainsi la preuve préventive d’une réalité qui ne devrait pas être laissée au hasard. Concernant le récent cas de Julie Sweeney, son appel à faire exploser une mosquée révélait sans aucun doute son caractère plutôt peu recommandable, ce qui justifierait sans aucun doute une peine d’emprisonnement en vertu de la législation existante. Pourtant, la question de savoir si nous devrions l’appeler une potentielle tueuse de masse est plus ouverte au débat.
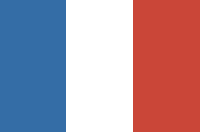
 Édition Principale
Édition Principale US
US





Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe