Musée Albertina, Vienne, Autriche
Même si vous n’avez pas lu le chef-d’œuvre moderniste inachevé de Robert Musil, L’homme sans qualités, vous conviendrez probablement qu’il a un excellent titre. Si vous l’avez lu, je suis sûr que vous êtes d’accord, car le roman revient de manière obsessionnelle sur le thème de la façon dont son personnage principal, Ulrich, n’arrive pas tout à fait à se ressaisir, ou, plus fondamentalement, à rassembler sa personnalité. Mais j’ai trouvé un encore meilleur titre. Je pense que Musil aurait dû intituler son roman L’homme sans philosophie.
Je reconnais, en proposant cette amélioration, qu’au cours du roman, Ulrich défend explicitement une philosophie de vie ; de plus, il crée même son propre nom pour cette philosophie, « l’essayisme ». L’essayisme est un mode de vie dont l’expression caractéristique est une série de réflexions novatrices et perspicaces, « explorant une chose sous de nombreux angles sans l’englober ». L’essayiste mène une vie d’observations réfléchies. Ulrich vit cette vie, tout comme Musil, qui est beaucoup plus intéressé à remplir son roman d’observations réfléchies qu’à utiliser les artifices habituels de l’intrigue ou du développement des personnages. Ulrich se rebelle contre le fait d’être « une personne définie dans un monde défini », et utilise plutôt la capacité sans fond de son esprit à réévaluer pour imiter l’infinie variabilité « d’une goutte d’eau à l’intérieur d’un nuage ». Ulrich décrit sa relation aux idées : « elles me provoquaient toujours à les renverser et à en mettre d’autres à leur place. »
Pour Ulrich, comme pour Musil, « il n’y avait qu’une seule question qui valait la peine d’être réfléchie, la question du bon moyen de vivre. » N’est-ce pas, par essence même, un projet philosophique ? Oui. Mais il y a de bonnes raisons, néanmoins, d’insister sur le fait qu’Ulrich est un homme sans philosophie, à savoir le fait que Musil et Ulrich l’affirment, encore et encore. Ulrich reconnaît que dans sa situation, « il n’aurait pu se tourner que vers la philosophie », mais le problème était que la philosophie « ne l’attirait pas ». Encore et encore : « il n’était pas philosophe. » Il avait une « vision quelque peu ironique de la philosophie », car, des décennies avant l’ouverture du roman, il avait déjà perdu l’espoir de trouver réellement le bon moyen de vivre : « nos pensées ne peuvent pas être attendues pour rester au garde-à-vous indéfiniment, pas plus que des soldats en parade en été ; si elles restent trop longtemps, elles tomberont simplement dans les pommes. » Le résultat est qu’« il était toujours provoqué à réfléchir sur ce qu’il observait, et pourtant en même temps, il était accablé par une certaine timidité à penser trop fort. »
Pensée profonde a du sens si vous voulez des réponses ; cela a moins de sens si la plus grande récompense que vous anticipez de vos efforts intellectuels est la surprise. La différence entre une vie philosophique et une vie essayistique est que la première vise la connaissance, tandis que la seconde vise la nouveauté. La réponse positive caractéristique à un essai est : « Je n’y avais jamais pensé de cette façon auparavant » ; l’ennemi principal de l’essayiste est l’ennui. Ulrich « faisait toujours quelque chose d’autre que ce qui l’intéressait » pour garantir son imprévisibilité, même pour lui-même. L’essayiste est une créature réactive, toujours consciente de la manière standard de voir les choses, et toujours à l’affût du chemin le plus facile vers un point de vue alternatif.
Dans le récit de Musil, la vie d’un essayiste est une vie torturée, car c’est la vie dont la philosophie est non seulement absente, mais, plus spécifiquement, manquante. Lorsque vous regardez Ulrich, tout ce que vous voyez, au début, est un intellectuel lisse qui sourit à ses propres réflexions astucieuses ; mais finalement, vous discernerez qu’à côté de cet homme joyeux et sûr de lui marche, comme l’appelle Musil, « un second Ulrich ». Le second Ulrich, « le moins visible des deux », est « à la recherche d’une formule magique, d’une prise possible à saisir, de l’esprit réel de l’esprit, du morceau manquant », mais il est frappé de mutisme, incapable de trouver des mots pour s’exprimer. Musil dit que cet homme « avait les poings serrés de douleur et de rage ». Ulrich le philosophe est piégé à l’intérieur d’Ulrich l’essayiste.
Musil lui-même a refusé un poste académique en philosophie, au grand désespoir de sa famille, en faveur de l’écriture d’un livre d’observations réfléchies. Le livre, et le personnage d’Ulrich, nous montrent ce que c’est que d’être un penseur sans quête : perpétuellement inactif malgré toute son activité intellectuelle incessante et agitée.
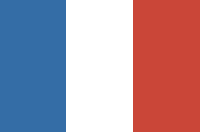
 Édition Principale
Édition Principale US
US





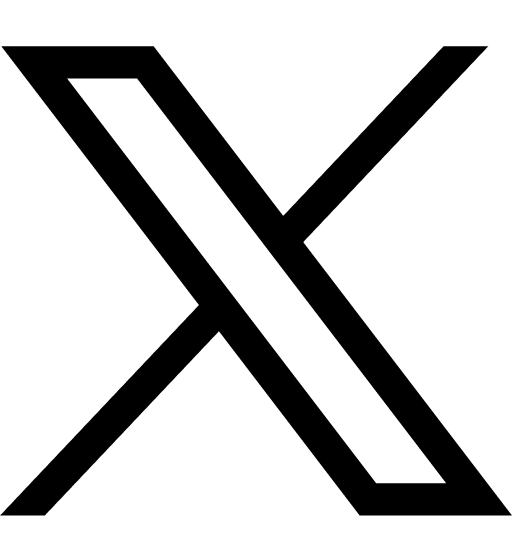
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe