La Colombie est enlisée par l'inertie politique
Je dois ma main droite fonctionnelle à l’acuité commerciale de Pablo Escobar.
Cette affirmation pourrait, indirectement, presque être vraie. Il y a sept ans, lors d’une baignade dans une piscine en pleine jungle, dans la province de Guaviare en Colombie, j’ai glissé et arrêté ma chute avec des doigts tendus qui ont heurté des rochers saillants. Le résultat fut une luxation au look étrange. Mon guide nous a conduits jusqu’à la ville la plus proche, où nous avons trouvé, un dimanche soir tranquille, un hôpital local moderne et bien équipé. Son personnel bienveillant a réalisé une radiographie de ma main pour écarter toute fracture. Un médecin de garde a habilement réaligné les doigts mal placés, les a bandés et m’a prescrit des analgésiques de forte puissance. Tout cela était impressionnant, pour une région reculée, peu visitée par les touristes, composée de paysages sublimes qui s’étendent de la savane ouverte des Llanos, au nord, à la profonde forêt tropicale de l’Amazonas.
Les Colombiens, et les amis de ce pays magnifiquement beau, vont déjà lever les yeux au ciel à la mention d’un baron de la drogue mort depuis longtemps. Mais pas encore… Deux décennies de diplomatie publique habile ont, avec un succès bien mérité, tenté d’effacer et de remplacer les clichés liés à la drogue qui ont terni l’image mondiale de la Colombie. Restez avec moi : Escobar, finalement abattu dans sa ville natale de Medellín en 1993, joue un rôle dans cette histoire et dans le paysage historique qui a permis à lui et à ses rivaux narco-moguls de prospérer. Cette histoire ne parle pas de cocaïne, mais de terre : sa distribution grossièrement inégale, la faim de ceux qui cherchent simplement à vivre et à élever une famille, et le désordre endémique qui découle de bien plus d’un siècle d’espoirs frustrés.
Ce coin de jungle reculée offrait des commodités plusieurs échelons au-dessus de ce que sa localisation et son histoire récente – au cœur d’un conflit civil à quatre fronts – m’auraient fait attendre. Pendant le boom de la cocaïne des années 1970 et 1980, Escobar et son cartel ont non seulement investi les dollars qu’il avait gagnés dans des œuvres philanthropiques qui servaient ses propres intérêts, notamment à Medellín. Les profits presque incalculables de la culture de la coca pour les cartels ont attiré des campesinos sans terre, dépossédés ou sous-loués de toute la Colombie vers des zones rurales isolées et difficiles à contrôler. Là, une petite parcelle défrichée dans la forêt, plantée avec le buisson doré, pouvait offrir un revenu raisonnable.
Ils comprenaient le Guaviare et le Caquetá voisin, dont les jungles abritaient le complexe de transformation notoire d’Escobar, Tranquílandia. La richesse provenant de la feuille verte, qui devenait poudre blanche dans les laboratoires cachés d’Escobar, s’est répandue et a envahi des provinces longtemps négligées. Cela a enrichi des villes comme celle où j’ai trouvé un traitement, les rendant plus prospères et mieux desservies que jamais auparavant. Une soupe alphabétique de forces guérillères maraudeuses a également alimenté les cartels avec de la coca : FARC, ELN, AUN. Dans le Guaviare lui-même, des filiales des FARC géraient le réseau d’approvisionnement en coca (et ne se sont toujours pas entièrement démobilisées). Avec l’armée colombienne, elles ont tourmenté les villageois près des larges rivières bordées d’arbres et le long des sentiers forestiers envahis par la vigne. Alors que les fonds de développement social soutenus par les États-Unis complétaient la riposte militaire contre les insurgés et le trafic de drogue, ces coins reculés sont devenus des lignes de front.
Les feuilles de figuier idéologiques des gangs de gauche ou de droite masquaient à peine les ressorts principaux d’une narco-économie rampante. Derrière les trafiquants prétendument politiques et les criminels « honnêtes » se trouvait, et se trouve toujours, la quête d’un moyen de vivre à partir de la terre abondante mais injustement répartie de la nation. La lente sortie de la Colombie de la lutte civile financée par la drogue, qui a coûté environ 250 000 vies au cours du dernier demi-siècle, a signifié un difficile bilan avec le commerce de la coca. Dans des endroits comme le Guaviare, ce commerce offrait de la terre et de l’espoir. L’éradication, poussée par le « Plan Colombie » de l’ère Bush, a totalement échoué. La tolérance contrôlée poursuivie par le gouvernement du président Gustavo Petro dans le cadre de son effort pour le Paz Total (« paix totale ») réussira-t-elle ? Les réformes agraires, en particulier pour les peuples autochtones du Guaviare et d’autres zones similaires, constituent un pilier clé de la plateforme de Petro. Bien que les cartels puissent disparaître (remplacés par leurs homologues mexicains encore plus sadiques), la culture de la cocaïne en Colombie continue de prospérer. Elle a atteint en 2023 253 000 hectares, soit deux tiers du total mondial, selon l’Agence des Nations Unies contre la drogue (UNODC).
Une modeste parcelle de buisson peut assurer l’avenir d’une famille. Et, comme le note l’écrivain-explorateur Wade Davis dans son excellent livre sur le fleuve Magdalena (la voie navigable qui traverse l’œuvre et la vie de Gabriel García Márquez) : « La terre est à la racine de tous les conflits en Colombie. » Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 10 % des propriétaires terriens du pays possèdent 82 % de ses terres productives ; les recherches d’Oxfam estiment que 67 % des terres cultivables sont concentrées dans seulement 0,4 % des propriétés. Cela fait de la terre colombienne la plus inégalement répartie du continent — peut-être du monde.
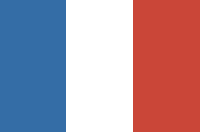
 Édition Principale
Édition Principale US
US





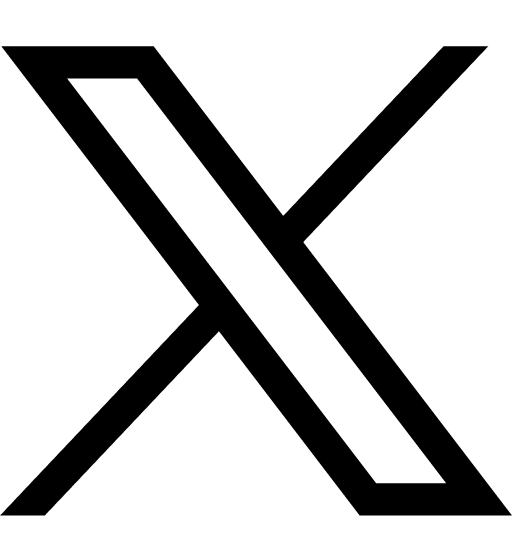
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe