Des militants d'extrême droite font le salut fasciste lors d'un rassemblement marquant le 90e anniversaire de la « marche sur Rome » le 28 octobre 2012 à Predappio. Le rassemblement a été organisé à Predappio, où le dictateur fasciste italien Benito Mussolini est né et est enterré, pour commémorer le 90e anniversaire de la « Marche sur Rome », le début de sa dictature. PHOTO AFP / TIZIANA FABI (Le crédit photo doit être attribué à TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)
De nombreux pays observent un moment de silence début novembre pour honorer leurs morts de guerre, mais ici en Italie, les rituels de commémoration sont très différents. Rien ne semble figé. Il n’y a pas un événement ou une occasion unique, seulement des dates, des cérémonies et des récits concurrents. L’année dernière, à Parme, la ville où je vis, le conseil municipal a même retiré une plaque dédiée aux morts de la Seconde Guerre mondiale — parce qu’ils étaient du « mauvais » côté. Bien que le 4 novembre soit connu comme le « Jour de l’Unité Nationale », cela ne semble jamais tout à fait correspondre. C’est comme si les Italiens n’arrivaient toujours pas à décider de quoi se souvenir ou comment le faire.
D’une certaine manière, le pays commémore comme aucun autre. Depuis que j’ai déménagé à Parme en 1999, j’ai été frappé par le nombre de plaques, dans les rues, sur les ponts, dans les parcs et les églises, rappelant des événements et des occasions marquants. C’est comme s’il y avait une leçon d’histoire à chaque coin de rue. En montant l’une des tours de Bologne, on aperçoit des panneaux tous les quelques mètres marquant les noms des bâtisseurs qui sont tombés. « Mémoire, mémoire incessante », comme l’a écrit un jour Giuseppe Ungaretti, le poète du XXe siècle.
Beaucoup de ces commémorations sont locales et profondément ressenties, mais au niveau national, il semble manquer une connexion émotionnelle. Le monument le plus sacré du pays, le gigantesque « Autel de la Patrie » à Rome, est aussi le bâtiment le plus ridiculisé d’Italie. Avec ses niveaux crémeux et ses marches imposantes, il est surnommé « le gâteau de mariage » ou « la machine à écrire ».
Cela reflète le refus plus large du pays d’adopter un récit historique commun. « Chaque fois que l’attention publique se tourne vers le passé », a écrit un jour le politicien et historien Pietro Scoppola, « des polémiques surgissent qui mènent presque au désir de dissoudre la conscience de l’identité nationale ». Ces polémiques sont évidentes dans les nombreux ouvrages sur les commémorations discordantes en Italie, de Italy’s Divided Memory de John Foot à La Memoria Divisa de Giovanni Contini.
Une grande partie de cette confusion trouve son origine dans la Première Guerre mondiale et ses conséquences immédiates. En Grande-Bretagne, la boue et les tranchées, les coquelicots et la poésie sont gravés dans notre conscience collective. Mais en Italie, un débat intense a eu lieu sur la question de l’entrée en guerre (décision finalement prise en 1915). Par la suite, une lutte souvent sanglante s’est engagée pour donner un sens à tous ces sacrifices. Pendant le « Biennio Rosso » — deux années de forte polarisation politique où les grévistes et les travailleurs ont été brutalement réprimés, souvent par des groupes proto-fascistes — une véritable « guerre des mémoriaux » a éclaté.
De nombreux conseils anarchistes et socialistes érigèrent des plaques et des monuments blâmant les profiteurs de guerre et les va-t-en-guerre pour les 650 000 morts italiens. Le conseil municipal d’Albano Vercellese, entre Milan et Turin, éleva un monument qui déclarait sans détour : « Aux morts qui ont, sans méfiance, donné leur jeunesse à la cause du capitalisme. » Tout au long de 1919 et 1920, les fascistes commencèrent à détruire, tirer ou retirer des monuments jugés trop antimilitaristes, forçant ainsi de nombreuses plaques à être placées sous protection armée. Lorsque Aldo Milano, un footballeur fasciste, tenta de retirer cette commémoration anticapitaliste à Albano Vercellese, il fut abattu.
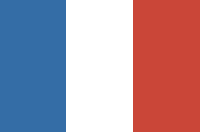
 Édition Principale
Édition Principale US
US





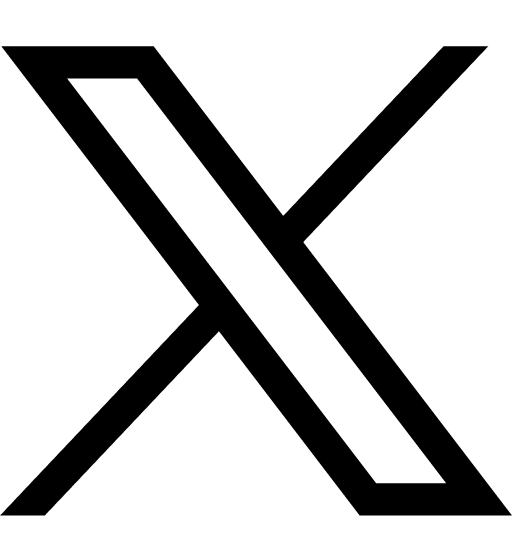
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe