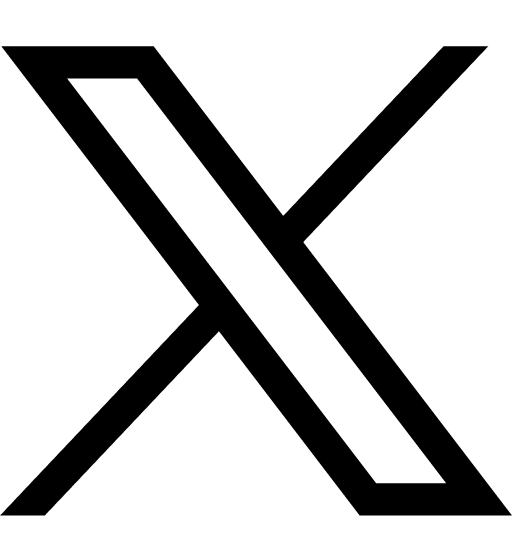Mark Rylance
Il n’est pas rare que la queue remue le chien. À travers l’histoire, les puissances en place ont souvent été jugées inadaptées à leur fonction. D’où la nécessité de centres de pouvoir alternatifs : les assistants politiques. Les rois, souvent lourds et capricieux, ont historiquement délégué l’intelligence et la vision à leurs ministres méritocratiques ou vizirs éclairés. Aujourd’hui, cette tâche revient aux quangocrates et aux conseillers, chargés de compenser les failles intellectuelles d’une classe politique photogénique et obsédée par sa propre image.
Mais en pratique, la division du travail entre décideurs politiques et exécuteurs, architectes et vendeurs, n’est jamais aussi simple. Loin d’être des technocrates humbles et pragmatiques, les véritables forces derrière le trône sont souvent des croyants fervents, des idéologues obsédés par des causes radicales. C’est là le paradoxe de l’assistant politique : marginal par sa position, il nourrit un désir de domination souvent plus intense que celui des dirigeants qu’il conseille. Cette qualité séduit les leaders en quête d’une vision ou d’un levier puissant. Donald Trump, par exemple, a sûrement vu en Steve Bannon un personnage assez démesuré pour accomplir l’impossible, comme « assécher le marais » de Washington. Mais cet excès de zèle peut se retourner contre eux. Sans freins efficaces à leur autorité, ils accumulent ennemis et erreurs. L’assistant zélé finit souvent victime de ses propres excès, et sa chute est aussi brutale que son ascension.
Prenons l’archétype de l’assistant politique : Thomas Cromwell. Son histoire offre un modèle intemporel pour la tragédie de l’homme de l’ombre devenu ivre de pouvoir. Cinq siècles après sa mort, la fascination pour son parcours reste vive. Hilary Mantel, récemment disparue, a exploré sa trajectoire dans sa trilogie Wolf Hall, récompensée par deux Booker Prizes. Son œuvre a été magnifiquement adaptée par la BBC, et la série revient aujourd’hui avec une suite, Wolf Hall: The Mirror and the Light. À travers ses manoirs Tudor austères et ses dialogues ciselés, cette nouvelle adaptation ravive l’intérêt pour Cromwell. Grâce à la performance poignante et subtile de Mark Rylance, Cromwell, longtemps dépeint comme un tyran insatiable, a vu son image réhabilitée. Loin du mégalomane intemperant, il est désormais présenté comme un héros ambigu, tragique et captivant de l’Histoire.
Aux yeux des sensibilités contemporaines, Thomas Cromwell incarne l’idéal méritocratique. Il est l’exemple d’un parvenu intrépide, un homme de « basse extraction », selon ses propres mots, qui a gravi les échelons grâce à son seul talent. Ce récit de Cendrillon politique a captivé les esprits les plus brillants. L’historien allemand Geoffrey Elton, dans une vision du milieu du XXᵉ siècle aujourd’hui dépassée mais révolutionnaire en son temps, voyait en Cromwell l’architecte de la « Révolution Tudor dans le gouvernement », celui qui aurait arraché l’Angleterre à son passé médiéval pour poser les bases d’un État moderne. Cromwell lui-même a entretenu cette légende : sur le célèbre portrait d’Holbein, il apparaît comme un mandarin austère, plume et papiers à la main, incarnant la bureaucratie émergente.
Cependant, la réalité est bien différente. Comme le souligne Diarmaid MacCulloch, son biographe pragmatique, Cromwell n’était pas un réformateur visionnaire, mais un habile politicien médiéval. Il était un « fixateur » avant tout, avide de pouvoir et maître du jeu de cour. Il n’y avait rien de moderne dans sa manière d’accumuler des charges, de contrôler l’agenda royal et de remplir les rangs avec des loyalistes. Paradoxalement, la rationalisation du Conseil privé, souvent attribuée à Cromwell comme une avancée vers un cabinet moderne, a en réalité freiné son ascension. Il prospérait dans l’instabilité et les intrigues de la cour, un monde où les périls et les opportunités allaient de pair. Les assistants politiques contemporains, de figures comme Alastair Campbell à Dominic Cummings, sont en quelque sorte les héritiers de Cromwell. Ils incarnent cette même audace maverick, ce même goût pour le pouvoir brut et les manœuvres sans filet. Mais aucun d’eux n’égale la férocité de l’original.
Ses héritiers modernes, bien sûr, ne sont pas tout à fait à la hauteur de l’OG. Cromwell pouvait être assez peu sentimental dans sa gestion des adversaires. Par exemple, pour avoir prophétisé contre la mésalliance royale avec Anne Boleyn, la religieuse catholique Elizabeth Barton a été pendue et décapitée, devenant, selon MacCulloch, «la seule femme de l’histoire anglaise à avoir sa tête tranchée placée parmi celles empalées sur le pont de Londres». Puis il y avait le feu et la fureur exercés sur le Pèlerinage de la Grâce, le soulèvement populaire des conservateurs protestant contre le changement social.
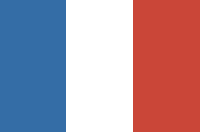
 Édition Principale
Édition Principale US
US