(The Big Lebowski)
Oblomov, j’imagine, ressemble à l’homme figé tel une pierre de The Yellow Scale de František Kupka. C’est une peinture frappante, un tourbillon de jaunes, avec Kupka — car c’est un autoportrait — vous regardant avec défiance, vautré dans une chaise en osier, une cigarette à une main et l’index de l’autre enfoncé dans un livre couleur citron, comme s’il disait : « Oui, je suis paresseux. Et alors ? »
C’est l’ambiance que dégage Ilya Ilyich Oblomov, le héros du deuxième roman d’Ivan Goncharov, publié en 1859. Il incarne ce type idéal russe du milieu du XIXe siècle — assez courant chez Turgenev et Pouchkine — que nous ferions bien d’imiter : l’homme ‘superflu’. Il est un ‘fainéant incorrigible et insouciant’, observe son ami Penkin, mais c’est un euphémisme.
Oblomov est paralysé par l’indolence. Son exploit, dans les 50 premières pages, est de négocier un déménagement de son lit à sa chaise. Il n’est pas handicapé, explique Goncharov : « Être allongé n’était pas pour Oblomov une nécessité, comme c’est le cas pour un malade ; ou une question de hasard, comme c’est le cas pour un homme fatigué ; ou un plaisir, comme c’est le cas pour un paresseux : c’était sa condition normale. » Oblomov passe une grande partie du roman dans une position allongée quasi-permanente, arborant ‘une expression de quiétude sereine, des pensées se promenant librement sur tout son visage’. Sa présence n’ajoute rien à la société, mais elle ne lui retire rien non plus.
Oblomov, nous apprenons, était autrefois un employé de bureau avant de décider que travailler ne valait pas la peine. « Selon lui, la vie se divisait en deux moitiés : l’une consistait en travail et ennui — ces mots étaient synonymes pour lui — et l’autre en repos et jouissance tranquille. » En conséquence, il décida de se consacrer à une vie de léthargie littéraire. Il pouvait se le permettre. Avec 350 serfs à son nom, il dispose d’un modeste revenu de rentier qui le libère des indignités du travail. Ses surveillants le trompent, mais il ne se donne pas la peine de se rendre dans la lointaine Oblomovka, ‘aux frontières de l’Asie’. Il ne peut pas non plus se donner la peine de rester au courant des actualités. Les journaux du matin l’ennuient. De même que la haute société. Il ne supporte pas les intellos pompeux du salon des Mussinsky, où ils discutent de Léonard de Vinci et de l’École vénitienne : « Pédants. Que c’est ennuyeux ! »
Oblomov a toujours été un peu philistin. À l’école, « il était tout à fait satisfait de ce qui était écrit dans son cahier et ne montrait aucune curiosité ennuyeuse quand il ne comprenait pas tout ce qu’il entendait. » Ainsi, en atteignant l’âge adulte, Oblomov se retira de la société, passant ses journées comme le Dude dans The Big Lebowski, ce fainéant invétéré, bien que dans le cas du Russe, son uniforme choisi soit une ample robe de chambre orientale plutôt qu’un peignoir, et il ne réside pas seul dans son appartement de célibataire mais a un grognon valet Gogolien à ses côtés. Tous deux se chamaillent comme un couple marié. Oblomov réprimande Zakhar pour son appétit : « Es-tu une vache pour avoir tant brouté de verdure ? » Le serviteur, à son tour, lui reproche sa prodigalité en verres : pourquoi le maître ne peut-il pas boire directement à la carafe ?
Le contrepoint à Oblomov est son camarade d’école allemande austère et travailleur, Andrey Stolz, adepte de l’éthique protestante du travail. Stolz déplore la paresse d’Oblomov : « Que fais-tu ? Tu te roules en boule et tu t’étires comme de la pâte. » Une grande partie du livre est consacrée aux efforts de Stolz pour faire d’un Russe paresseux un Allemand ennuyeux et consciencieux. Inutile de dire que Stolz échoue à améliorer Oblomov. Au début, cependant, il réussit à faire rencontrer à notre héros paresseux Olga, et pendant un moment, Oblomov devient un fêtard, passant d’une soirée à l’autre. Mais cela ne dure pas. Sa paresse revient, alors qu’il prend conscience que ‘l’intimité avec une femme implique beaucoup de problèmes’, d’autant plus avec ces ‘jeunes filles pâles et mélancoliques’ à l’entretien exigeant, celles qui vous font endurer des ‘jours tourmentés et des nuits iniques’.
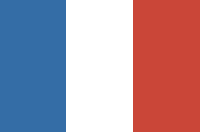
 Édition Principale
Édition Principale US
US





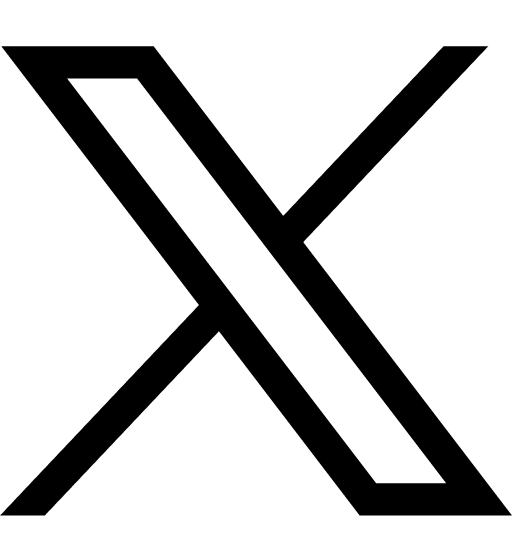
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe