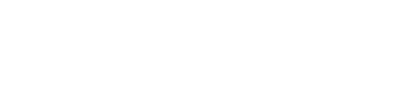“Quand j’écris, je ne suis plus une petite fille polie.” Credit: Lionel Bonaventure/AFP/ Getty

Depuis que je suis enfant, j’ai peur d’eux. J’avais cinq ans et ils avaient le visage des ayatollahs iraniens. J’avais quinze ans et ils sévissaient dans l’Algérie voisine. Je me souviens, à la télévision, de leurs visages mangés par des barbes touffues, de leurs joues creusées par la fatigue d’une vie dans le maquis, de leurs regards de déments. A l’époque de la guerre civile algérienne, une partie de ma famille s’est réfugiée au Maroc où je vivais. Ils sont partis, laissant tout derrière eux, leur travail, leurs amis, leurs rêves. Ils nous racontaient les faux barrages, les égorgements, les menaces. J’avais quinze ans et je tremblais de peur.
Ces fanatiques sont les ogres des nuits de mon enfance, la menace qui n’a cessé de grossir, qui est devenue de plus en plus proche, de plus en plus visible. Dans les années 1990, dans les facultés marocaines, les islamistes prenaient le pouvoir. La bataille idéologique était en passe d’être perdue. On s’habituait, aux informations, au mot désormais familier d’attentat. A Paris, à Louxor, à Alger. Dans ma famille, on ne les sous-estimait pas. On savait que les plus illuminés d’entre eux étaient prêt à tout pour défendre leur vision du monde. Mes parents m’enjoignaient à la prudence moi qui ne savais pas fermer ma bouche et qui jouais à l’adolescente rebelle. On ne m’invitait pas à défendre mes positions, à les défier. Au contraire, on me disait qu’il fallait les craindre et donc courber l’échine, raser les murs, se taire. Qu’est ce qu’on répond à des parents qui vous aiment et qui vous mettent en garde: «ne prends pas de risque, ne les provoque pas, protège toi de leur violence.»
J’avais quinze ans, je vivais à Rabat et j’ai appris à me taire et à accepter. On accepte de se cacher pour manger pendant le ramadan et d’avoir peur que quelqu’un sente l’odeur de la nourriture sur vous. On accepte de ranger dans des sacs opaques les bouteilles de vin consommées et de rouler quelques kilomètres pour les jeter à la poubelle. On accepte d’écouter en silence le discours rageur d’une professeur de religion qui prétend que les chrétiens et les juifs n’iront jamais au Paradis et on pleure, au dedans de soi, pour tous les gens qu’on aime et qui ne sont pas musulmans et qui sont bannis du Paradis. On accepte de se faire insulter par un douanier à Casablanca parce qu’on a dans notre valise, en pleine vacances de fin d’année, ce qu’il a identifié comme des cadeaux de noël. On accepte de se faire traiter de traînée et de mécréante sur la plage où on a joué enfant parce que notre corps, à présent, est une offense à Dieu.
On accepte et on vit à la fois dans la peur et dans la honte. La honte de notre lâcheté, de nos renoncements dont ils se sont repus et qui les fait grandir. La honte de ne pas mieux défendre l’Islam de mon grand père qui est au Paradis avec sa femme chrétienne. «Mille petits dégoûts de soi dont le total ne fait pas un remord mais une gêne obscure.» Voilà ce qu’on ressent. On se sent laid et petit. Pour se rassurer on se dit que c’est nous qui avons raison, qu’on sait où se situent les frontières du Bien et du Mal, de la Raison et de la barbarie et peu importe si on n’ose pas les défendre à voix haute. Il faut sauver notre peau. Notre peau de perdant, de veule, de mou mais notre peau quand même.
Il y a un seul moment où je n’ai pas peur. Un seul moment où je me sens courageuse; Il suffit que je ferme la porte de mon bureau, que j’ouvre mon ordinateur, il suffit que je me mette à écrire et la peur disparaît. C’est pour cela que je suis devenue écrivain. Pour purger mes cauchemars, pour calmer mes frayeurs. Quand j’écris, je me sens capable de tout. Je ne suis plus une petite fille polie, une femme vertueuse. Je ne cherche ni à plaire ni à séduire. Je n’ai pas peur de provoquer la colère ou le scandale. La fiction est pour moi le territoire de l’absolue liberté, celui où l’on peut dire l’ambigu, le flou, l’incertain, où l’on peut se contredire et exprimer ses mauvaises pensées.
Demain, à ma table de travail, est ce que je me sentirai aussi libre qu’avant ? Demain, en montant sur scène pour une conférence, est ce que je penserai à Salman et est-ce que je craindrai d’être attaquée moi aussi ? Aujourd’hui, beaucoup d’écrivains musulmans ont peur et s’auto-censurent. Je ne les juge pas ; je les comprends et moi aussi, je pense à ma famille et à mes enfants. Mais la peur et la honte doivent changer de camp. Nous devons parler plus forts, nous devons être plus convaincants, nous devons être les voix des Lumières, les voix de la liberté et de la dignité. C’est la seule façon d’être des écrivains: étouffer la peur dès qu’elle apparaît, croire à l’intelligence des lecteurs, être insolent et irrévérencieux. Ecrire, écrire, écrire. Ne pas nous soumettre, ne pas nous agenouiller.