Les spectacles britanniques de convivialité publique signalent généralement qu’un épisode de psychose collective est imminent. Pensez à la mort de Diana, ou au culte de Captain Tom. Mais rien ne nous a préparés à Paddington Bear, le jouet en peluche qui est devenu d’une manière ou d’une autre un canal pour l’anxiété de l’État concernant la « gentillesse et l’intégration » face à une migration de masse sans précédent, à l’échec de l’État et à l’effondrement des anciens organes de culture et de médias pour faire face à la Grande-Bretagne contemporaine.
Il y a une décennie, l’élévation d’un jouet en peluche au rang d’icône soutenue par l’État aurait pu sembler un peu déplacée. Mais la Grande-Bretagne de 2025 est un endroit étrange. « Un bon début de semaine », a s’exclamé la BBC cette semaine alors que l’ambassadeur japonais du Royaume-Uni souriait nerveusement à côté de l’ours. L’été dernier, alors que la police peinait à contenir une foule hurlante devant un hôtel pour demandeurs d’asile, l’ours est apparu sur les réseaux sociaux pour prêter main-forte : « Peut-être est-il temps d’être un peu plus gentil. »
Lorsque deux ingénieurs de la RAF ivres ont renversé une statue de Paddington dans la ville de Newbury dans le Berkshire plus tôt ce mois-ci, qui sait quelles pulsions réprimées ont été libérées. Le magistrat qui a prononcé la peine semblait certainement suspicieux hier : « Il représente la gentillesse, la tolérance et promeut l’intégration et l’acceptation dans notre société […] vos actions étaient l’antithèse de tout ce que représente Paddington. » Des témoins horrifiés se sont alignés pour témoigner ; un Nuremberg de Newbury pour cette atroce britannique. Les parties restantes, a déclaré Trish du conseil, devaient être recouvertes d’un sac poubelle car « les enfants trouveraient cela troublant de voir la statue complètement détruite. »
Le genre est désormais bien usé : Paddington Bear est mièvre, insupportable et infantile. Mais il est aussi curieusement sinistre, faisant partie d’une force réactionnaire plus large d’un establishment vaniteux et cynique essayant de trouver ses repères dans le bouleversement en cours de la Grande-Bretagne du XXIe siècle. L’essai canonique sur le sujet est J’Accuse’s « The Posh Turn », qui documente la consolidation — et la légitimation — de l’ordre post-1997, soutenue par un pillage du patrimoine britannique, de la nostalgie et des traits d’esprit de Stephen Fry.
Le « Britishness » dans le sens authentiquement spontané ne semble plus vraiment exister dans le domaine public. Le foot et le fish and chips, la famille royale, les chiens dans les pubs : ce sont toutes des offres anémiques pour un projet désespéré de construction nationale de Starmer. Tout souvenir collectif ou icône passée est désormais imposé au public par un comité complaisant et secret qui a en réalité peur des gens ordinaires. Observez Mike Tapp, le John Bull de Keir Starmer, qui tire nerveusement les opinions de ses abonnés sur les réseaux sociaux avec ses sondages formulés de manière discordante. « Quelle est votre activité britannique préférée pour un dimanche ? » a-t-il demandé ce mois-ci. Les options étaient : « rôti », « promenade », « football/rugby » et « toutes ».
Comparez cela à une autre force tribale qui a balayé les réseaux sociaux britanniques : la création populaire du « Yookay » pour décrire la Grande-Bretagne multiculturelle, criarde, vulgaire et de plus en plus dysfonctionnelle qui a émergé ce siècle. À certains égards, c’est une esthétique — une humeur avec laquelle on ne peut vraiment lutter qu’en se promenant dans des rues et des villes enflées par la décadence et l’immigration de masse, et guidé par une sphère entièrement distincte de réseaux sociaux et de sous-cultures. C’est un monde presque étranger au nexus officiel de Paddington des « valeurs britanniques » au sein des médias, du sport et maintenant de l’État.
Mais c’est aussi le triomphe d’une avant-garde apparemment réactionnaire qui définit — en l’absence de toute culture de l’information sérieuse — les termes de la satire et du commentaire, ainsi que la compréhension de la Nouvelle-Bretagne. C’est une nation qui existe au-delà des documentaires ennuyeux de BBC 2, des drames Netflix qui se transforment en coup de communication, et du verbiage pieux des magistrats et des politiciens.
De vastes pans des figures publiques britanniques ne s’intéressent plus vraiment au pays dans lequel elles vivent. Par exemple, le récent Sunday Times « Meilleurs endroits où vivre » a mis en avant un véritable exode des classes supérieures et moyennes vers les campagnes, une arcadie rétrograde de terrasses géorgiennes, de bottes boueuses et de fleurs de campagne (oui, la statue intacte est apparue dans le reportage sur Newbury).
Dans un tournant à la Cummings, le discours sur le « réajustement » de l’État britannique, la réforme du blob et l’entrée de l’État dans le XXIe siècle a même atteint les députés de l’arrière-ban du Parti travailliste. Mais le prochain défi semble bien plus difficile : une refonte des mœurs, des goûts et des manières britanniques modernes, un réveil de son caprice et de son oubli vers une nation nouvelle et inévitable.





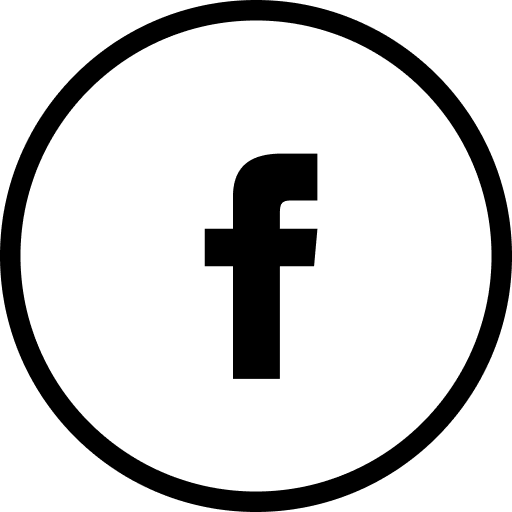
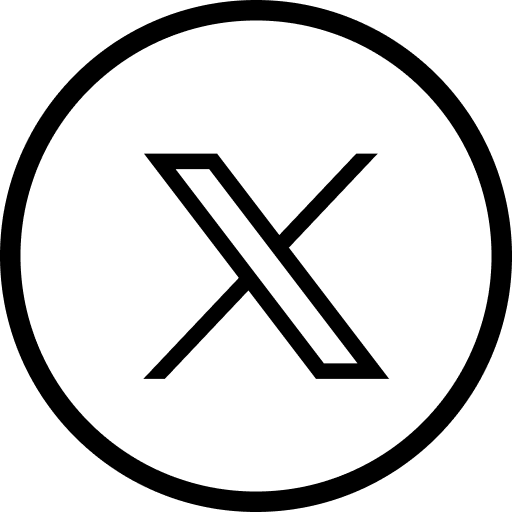
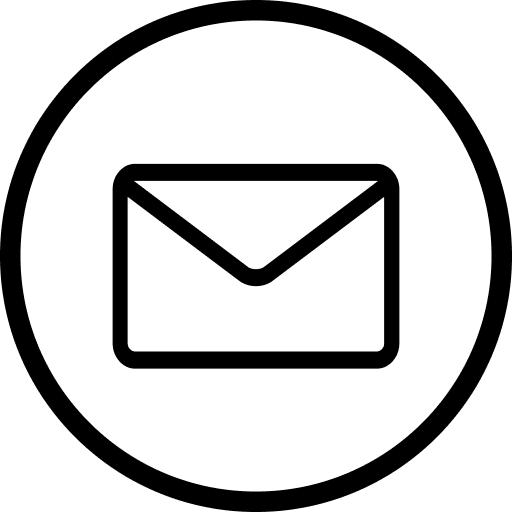

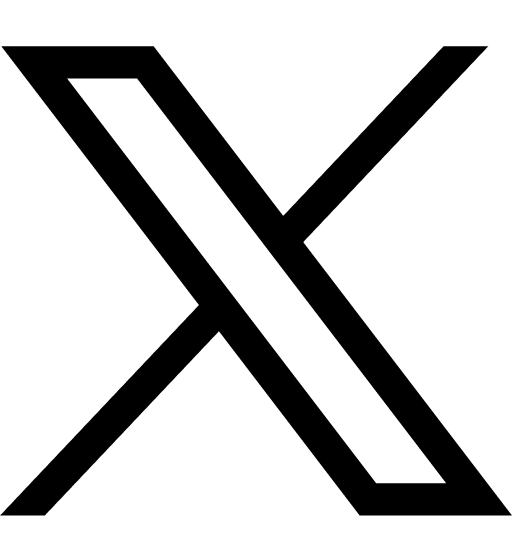
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe