Dans une récente vidéo virale, l’influenceur Ashton Hall (bien qu’il ne soit pas encore un nom connu, il compte presque trois millions d’abonnés sur YouTube) a documenté sa « routine matinale » de cinq heures et demie. Elle commence à ce que nous pouvons seulement imaginer comme étant l’heure de début inspirée par Andrew Huberman à 3h52 du matin. Ce qui suit est un montage hyper-curé de rituels de soins personnels et de pseudo-productivité : des squats avant l’aube dans sa cuisine, des bains méditatifs, et — pour une raison quelconque — frotter une banane sur son visage. La plupart des scènes mettent en avant une bouteille d’eau de Saratoga Springs. C’est comme si Hall avait lu — non, regardé — la routine matinale dans American Psycho et s’était demandé : « Comment puis-je rendre cela plus évident ? »
À un certain niveau, la vidéo de Hall souligne une qualité agaçante des médias sociaux. Aujourd’hui, tout est publicité au sens le plus littéral. Vos opinions tranchées et vos clips de 30 secondes seront inévitablement ponctués par des annonces pour des leggings Halara, des cookies Crumbl, Chili’s, et maintenant de l’eau de Saratoga Springs. La vidéo a été à juste titre moquée, de la même manière que nous pourrions nous moquer d’un spot publicitaire gênant. Chacun a proposé sa propre version, de la version asiatique à la version rappeur SoundCloud. Pourtant, sous la moquerie se cache un changement culturel, qui s’est accumulé pendant des décennies et qui semble maintenant au-delà de la parodie. La masculinité contemporaine est emballée, commercialisée et vendue aux hommes à travers un prisme esthétisé autrefois principalement réservé aux femmes.
Dans The Beauty Myth, l’auteure américaine Naomi Wolf a averti que les normes de beauté inaccessibles piègent les femmes dans des cycles d’anxiété et de consumérisme, une critique si familière qu’elle semble maintenant presque une vérité universelle. Nous vivons dans un monde où la consommation imprègne chaque facette de l’identité. Ces mêmes pressions, autrefois reconnues principalement comme visant les femmes, façonnent également la masculinité. Des comportements auparavant rejetés comme « métrosexuels », un terme popularisé dans les années 90 pour désigner les hommes investis dans le toilettage et l’apparence, ou même étiquetés « gays », sont devenus courants, promus par algorithmes et pleinement normalisés. Derrière presque chaque « tendance santé » contemporaine, de l’haltérophilie et du mewing à l’optimisation de la tumescence nocturne à la manière de Bryan Johnson, se cache la promesse que la perfection — et maintenant, même l’immortalité — est disponible à l’achat.
Susan Bordo, dans son ouvrage influent The Male Body, a chroniqué l’évolution de la masculinité, passant d’une invisibilité culturelle, avec des hommes traditionnellement considérés comme des observateurs plutôt que comme des objets d’observation, à des objets de scrutin esthétique hautement visibles. Bordo a noté un changement décisif dans les médias à la fin du 20e siècle, commençant par des publicités provocantes telles que les panneaux publicitaires emblématiques de Calvin Klein, qui furent les premières publicités grand public à objectiver le corps masculin de manière ouverte et sexuellement chargée. Ces publicités n’invitaient pas seulement à l’admiration mais normalisaient les corps masculins comme des objets de désir en dehors d’un contexte explicitement homosexuel. Hollywood a rapidement suivi la publicité, mettant en avant des corps masculins idéalisés, musclés et prêts pour la caméra, solidifiant ainsi une nouvelle norme pour la masculinité.
Tout comme les femmes ont longtemps été ciblées par des normes de beauté irréalistes, les hommes sont désormais également bombardés d’idéaux qui provoquent de la dysmorphie corporelle, y compris des taux accrus de chirurgie esthétique. Un nombre croissant de jeunes hommes rapportent des angoisses longtemps familières aux femmes, la dissatisfaction avec leur apparence étant la principale. Il ne s’agit pas de vanité, comme certains pourraient le prétendre. Au contraire, tout dans nos vies est un produit à être marchandisé.
L’absurdité de la « routine matinale » de Hall, bien qu’elle soit facilement moquée, révèle néanmoins une promesse, surtout pour les personnes qui ne peuvent pas voir à travers sa mascarade. Et, franchement, c’est la plupart des jeunes hommes. La « matinée » d’Ashton Hall suggère qu’à travers une consommation disciplinée, les hommes peuvent optimiser l’ensemble de leur vie. Bien sûr, cette promesse est creuse. La marchandisation de l’identité piège finalement les gens dans un cycle sans fin de dissatisfaction.
Les « rituels de soins personnels » apparemment inoffensifs, bien que extrêmement loufoques, de Hall sont des symptômes d’un malaise culturel plus large. Et personne n’a mieux décrit ce malaise que Bret Easton Ellis dans American Psycho : « Il y a une idée d’un Patrick Bateman, une sorte d’abstraction, mais il n’y a pas de vrai moi, seulement une entité, quelque chose d’illusoire. Et bien que je puisse cacher mon regard froid et que vous puissiez me serrer la main et sentir la chair saisir la vôtre et peut-être même que vous puissiez sentir que nos modes de vie sont probablement comparables, je ne suis tout simplement pas là. »





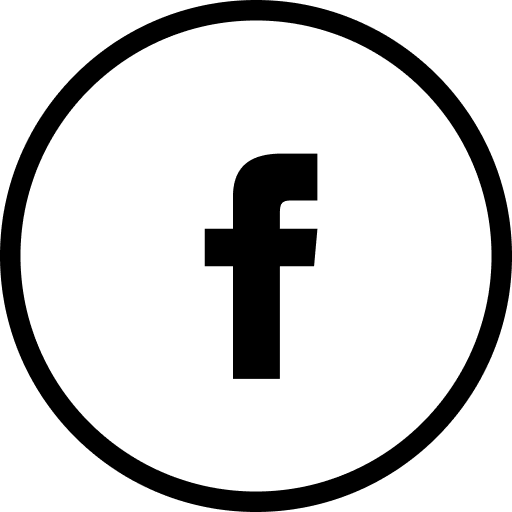
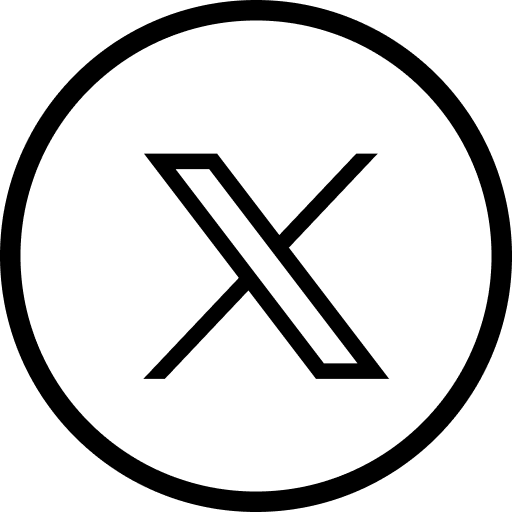
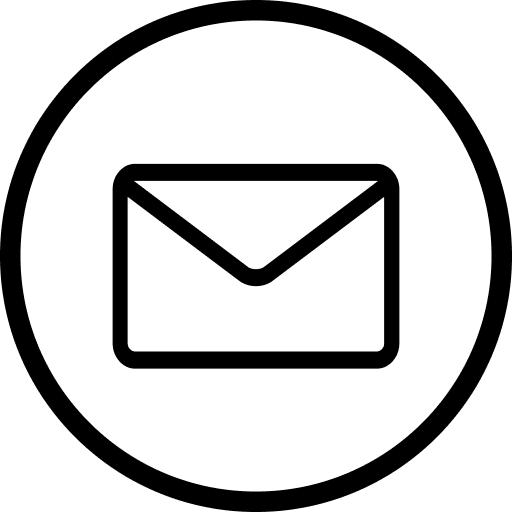

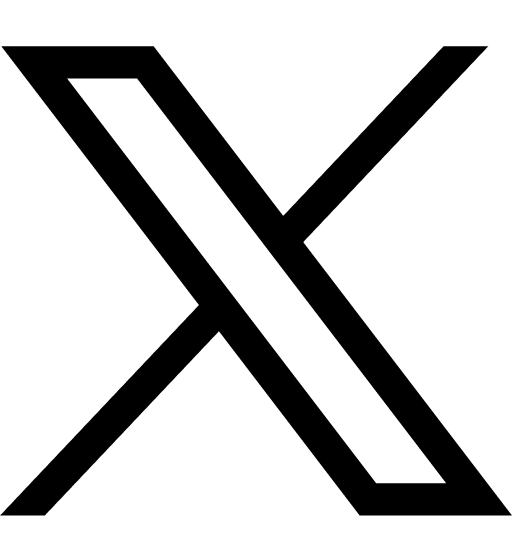
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe