Pamela Anderson, son pire couple à l'écran, et Tommy Lee (Photo par S. Granitz/WireImage)
Pamela Anderson ne vit pas dans le même monde que vous. Dans votre monde, le nom « Pamela Anderson » (ou juste « Pamela », ou même « Pammy ») évoque probablement Playboy, Baywatch, des implants mammaires évidents, de mauvais maris, une vidéo intime. Le sexe américain banal, criard et commercialisé est ce pour quoi Anderson a été connue depuis la fin des années quatre-vingt. Elle est aussi désirable qu’une grosse voiture ou une bière froide. Un modèle de plaisir basique.
Mais le monde personnel d’Anderson n’est ni vulgaire ni évident. C’est un endroit flou, féerique, où une petite fille canadienne de province pourrait être découverte sur grand écran lors d’un match de baseball et propulsée instantanément vers la célébrité et la fortune, malgré le fait qu’elle n’ait jamais pensé à elle-même comme à une beauté. Le genre de sa vie intérieure est la romance. « Je pense à ma vie non pas en années, mais par rapport à qui j’aimais à ce moment-là », écrit-elle dans son autobiographie de 2023 (appelée, de manière romantique, Love, Pamela).
« Je l’appelle ‘vision douce’ comme la façon dont je regarde la caméra — regardant ‘à travers’ — même au-delà — jamais un regard direct vers l’objectif mais un flou adouci. » Pas bas, mais beau. Pur. Plein d’espoir, même si cet espoir est plus une fonction de la volonté qu’une réponse rationnelle à l’expérience. Ses intérêts sont résolument sains : droits des animaux, véganisme (elle a publié un livre de cuisine végane en 2024). L’Anderson que nous pensons connaître, et l’Anderson qu’elle sait être, sont des personnes très différentes.
Il y a une version de ce décalage dans sa carrière d’actrice. Ou « actrice », si vous voulez être peu aimable, et beaucoup de gens l’ont été. Personne ne l’a prise au sérieux, à part elle-même. Dans son premier film, Snapdragon de 1993, elle joue « une concubine qui a un jumeau secret ». Elle s’est préparée en étudiant la méthode Stanislavski.
Elle a été nominée pour trois Golden Raspberries pour son rôle principal dans l’adaptation de bande dessinée de 1996 Barb Wire : elle a remporté le prix de la « pire nouvelle venue », mais ce qui était probablement plus humiliant, c’était d’être présélectionnée pour le prix du « pire couple à l’écran », le couple en question étant ses « améliorations impressionnantes ». C’était les années quatre-vingt-dix, donc personne n’a pensé à appeler cela « honte corporelle » et en 1999, elle a fait retirer les implants.
Maintenant, cependant, Anderson a enfin réalisé un film que les gens s’accordent à dire est bon. Plus que cela, ils s’accordent à dire qu’elle y est bonne. The Last Showgirl est réalisé par Gia Coppola, petite-fille de Francis Ford et nièce de Sophia. C’est l’histoire de Shelly, la « dernière showgirl » du titre, interprétée par Anderson : une performeuse vétéran de 57 ans dans une revue scintillante de Las Vegas appelée Le Razzle Dazzle, qui est forcée de confronter son propre vieillissement et sa vulnérabilité lorsque le spectacle ferme.
Shelly croit que Le Razzle Dazzle appartient à la tradition historique de la ligne de chœur. Le monde le voit très différemment : pour la fille adulte et éloignée de Shelly, c’est juste une performance nue embarrassante. Et lorsque Le Razzle Dazzle ferme pour être remplacé par un « cirque sexuel » (car le monde voit le spectacle de Shelly, non pas comme de l’art, mais comme un vieux morceau de titillation), et que Shelly est forcée d’auditionner pour d’autres revues, elle doit entendre ce que les gens pensent vraiment d’elle.
Un directeur impassible mais pas exactement cruel, joué par Jason Schwartzman (un autre Coppola), lui explique : elle n’est pas une bonne danseuse, et même si elle aurait pu l’être un jour, il est trop tard pour elle maintenant d’acquérir les compétences techniques. Elle a été mise en avant parce qu’elle était jeune et belle, et maintenant elle ne l’est plus. Dans un autre film, cela pourrait être le moment où notre héroïne réalise une routine incroyable et triomphe des attentes âgistes et sexistes. Mais The Last Showgirl n’est pas ce genre de film, et Shelly quitte la scène, défiant mais néanmoins rejetée.
C’est une scène triste et brutale, rendue plus triste et plus brutale par les parallèles évidents avec Anderson elle-même — des parallèles que l’actrice tire délibérément. Elle a changé l’âge de Shelly dans le script pour correspondre au sien, donc quand elle crie « J’ai 57 ans et je suis toujours belle ! » au personnage de Schwartzman, les mots appartiennent également à la showgirl fanée et à l’ancienne pin-up qui l’interprète. Et comme la douce, rêveuse et imparfaite Shelly, Anderson appartient à une culture sexuelle qui est essentiellement un vestige.
Les Playboy qui ont rendu Anderson célèbre sont autant des pièces de musée maintenant que les coiffes ornées de bijoux et de plumes de Shelly — repoussées par le « cirque sexuel » de la pornographie en ligne et d’OnlyFans. Quant à Baywatch, qui a besoin de regarder de belles femmes courir en maillots de bain rouges prétendant être des sauveteuses quand on peut voir des femmes nues se faire faire des choses indicibles à la demande ?
Comme Shelly, Anderson considère les institutions de divertissement sexuel qui l’ont façonnée comme essentiellement bénignes : elle se souvient de la vie au Playboy Mansion comme « un chaos beau et sensuel », Hugh Hefner lui-même comme « l’incarnation de la chevalerie, un véritable gentleman — élégant, passionné, si charmant, et pourtant avec ce petit rire d’enfant ». Les souvenirs varient à ce sujet : Crystal Hefner, une playmate des années 2000 et la troisième et dernière épouse de Hefner, se souvient du manoir comme fuyant et envahi par des moisissures noires, Hefner lui-même comme contrôlant et sordide dans son propre livre révélateur, Only Say Good Things.
Cette vision idéalisée n’est pas due au fait qu’Anderson ait eu une vie fondamentalement bénigne : elle a été abusée sexuellement par une baby-sitter lorsqu’elle était enfant, et son propre père était violent et tyrannique, noyant une portée de chatons pour punir la jeune Pamela pour désobéissance. Même le gentleman Hef l’a escroquée : Playboy a gagné des millions en réexploité son image via des calendriers et des vidéos, dont aucune ne lui a jamais été partagée.
Et, bien sûr, il y a eu l’immense humiliation publique de la sex tape, réalisée en privé avec son alors mari Tommy Lee Jones, volée de chez elle et publiée sans son consentement. Les avocats agissant pour la société qui a commercialement publié la bande ont soutenu qu’Anderson avait renoncé à son droit à la vie privée parce qu’elle était apparue nue dans Playboy ; Anderson n’a ni cherché ni reçu d’argent pour cela.
Avec tout ce contexte, une Anderson plus impitoyable aurait facilement pu se réinventer avec un récit de survivante pour convenir aux goûts post-MeToo, tout comme Crystal Hefner l’a fait. (Ce qui ne veut pas dire que Crystal Hefner est peu fiable en soi, seulement qu’elle a fait sa rebranding avec un timing impitoyable.) Mais l’impitoyabilité n’est pas un trait d’Anderson, et beaucoup des décisions qu’elle a prises en tant qu’adulte ne l’adaptent pas bien au rôle de victime.
Prenons la sex tape. En tant que victime de pornographie de vengeance, Anderson est évidemment sympathique — et pourtant ses propres choix romantiques ne suggèrent pas beaucoup de solidarité avec d’autres femmes qui ont souffert comme elle. Son troisième mari (et en fait le quatrième, car elle l’a épousé deux fois) était Rick Salomon, le joueur de poker professionnel et semi-professionnel qui a distribué une bande de lui-même ayant des relations sexuelles avec Paris Hilton, contre les propres souhaits de Hilton.
Ensuite, il y a la question de l’agression sexuelle. Encore une fois, Anderson pourrait tirer parti de la compassion ici, et elle le mérite. Mais lorsque Julian Assange de Wikileaks était retranché dans l’ambassade équatorienne pour éviter des allégations de viol en Suède — allégations décrites comme « crédibles et fiables » par le procureur suédois — c’est à Assange, et non à sa prétendue victime, qu’Anderson a apporté son soutien. Elle est devenue une visiteuse régulière de l’ambassade ; elle qualifie leur amitié d’« énergisante, sexy et drôle ». Assange maintient son innocence et l’enquête a été abandonnée en 2019.
Anderson est une « mauvaise victime », si une victime est censée être idéologiquement cohérente et pure. Mais la vérité est que je l’aime davantage pour ces choix, aussi inexplicables que je les trouve ; peut-être que je l’aime davantage parce que je les trouve inexplicables. Ils semblent, si rien d’autre, sincères. Pourtant, la même question pèse sur Anderson tout comme elle pèse sur Shelly dans The Last Showgirl : jusqu’où peut-on être naïf ?
Comme le personnage qu’elle joue, Anderson s’est lancée sans relâche dans des situations qui, à bien des égards, répètent l’exploitation et la blessure qu’elle a déjà subies. La scène d’audition est exquisément douloureuse car, bien que le récit exige que nous soutenions Shelly, le réalisateur a inévitablement raison. L’art de Shelly est, au mieux, limité. Son attrait sexuel était son atout, et maintenant cela est presque épuisé. Et tout cela est vrai pour Anderson aussi, ce qui accentue encore plus la tristesse.
Ce qui fait de Shelly un grand rôle pour Anderson, c’est que, enfin, c’est un rôle qui capture la tension impossible entre la façon dont le monde la voit et la façon dont elle voit le monde. Lorsqu’un personnage romantique est plongé dans un médium pornographique, le résultat de ce décalage est la tragédie, et à la fois Shelly et Anderson ont une teinte de tragédie en elles. Ce sont des femmes qui ont été utilisées et jetées, mais qui insistent encore héroïquement sur la beauté des choses.
Excepté, pour Anderson, il y a un second acte. Elle n’est pas sans pension et sans le sou comme Shelly. Elle peut renaître en tant qu’actrice qui joue une femme un peu comme elle. Elle peut même se permettre de tourner le dos à certains des travaux de féminité qui étaient sa profession : au cours des dernières années, Anderson a renoncé à porter du maquillage et à avoir des retouches, même pour des apparitions sur le tapis rouge. L’effet est étonnamment puissant, à la fois pour révéler l’artificialité de la beauté régulière, et (cette partie est quelque peu une démonstration) pour révéler à quel point elle est jolie sans artifice.
À 57 ans, Anderson peut recevoir le respect qui lui a été refusé lorsqu’elle était jeune, magnifique et méprisée. Les vraies Shellys — la classe ouvrière de l’industrie du divertissement pour adultes — sont plus jetables, et leur avenir est plus sombre. Peut-être y a-t-il quelque chose à dire sur le fait de s’accrocher à une foi en le glamour malgré tout cela.








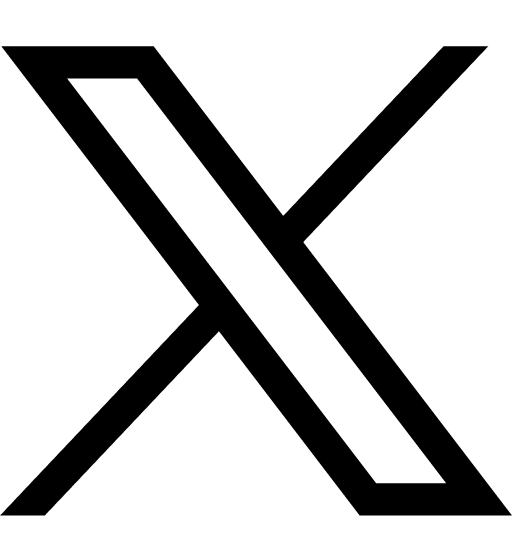
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe