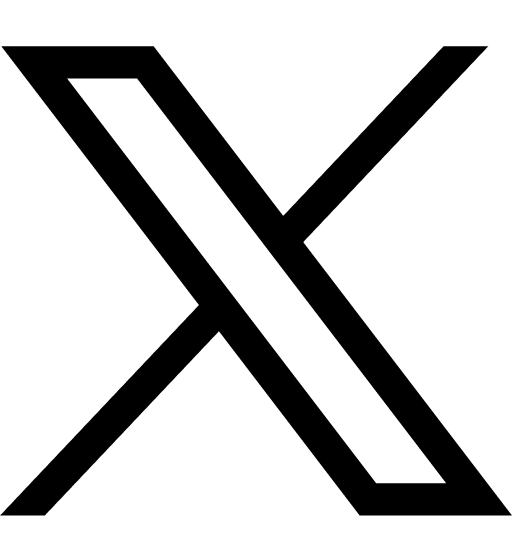« Sur les questions de la pornographie et de la prostitution, elle est une génie. » Colin McPherson/Corbis/Getty Images
Si j’étais Andrea Dworkin, je serais contente d’être morte. Lorsque l’écrivaine féministe radicale a succombé à une maladie cardiaque à l’âge de 58 ans, cela semblait tragiquement jeune — mais au moins, elle a évité le spectacle indigne des féministes de la quatrième vague de 2025 qui grimacent devant un corpus d’œuvres avec lequel elles sont tout simplement trop lâches pour s’engager.
Dans un bon coup pour les éditeurs, Dworkin est de nouveau à la mode. Trois de ses meilleurs livres — Woman Hating, Pornography, et Right-Wing Women — sont réédités aujourd’hui en tant que Penguin Modern Classics, lui offrant une plaque d’or dans le panthéon des écrivains féministes essentiels. L’histoire de la vie de Dworkin est presque aussi étrange et frappante que son écriture : une lesbienne juive se décrivant elle-même du New Jersey qui a fini par épouser deux hommes, elle a fait ses armes au Bennington College ultra-libéral où elle a fait la une des journaux nationaux avec son témoignage d’un examen interne invasif par la police suite à une manifestation. Elle a déménagé aux Pays-Bas, où elle a rencontré et épousé un activiste anarchiste qui l’a battue et brûlée avec des cigarettes ; une période de pauvreté après l’effondrement de leur relation l’a forcée à vendre du sexe. Elle est retournée en Amérique, s’est fait un nom en tant qu’écrivaine féministe dans le mouvement anti-pornographie et anti-prostitution et a épousé l’activiste gay John Stoltenberg, avec qui elle est restée jusqu’à sa mort.
En la revisitant, Penguin fait preuve de sagacité : Dworkin connaît un moment de gloire parmi les jeunes femmes fatiguées de la fin de la féminité des années 2020, à moitié engagée, commerciale et lâche. Les jeunes féministes qui ont réalisé qu’il n’est en fait pas émancipateur de vendre des photos de leur derrière ont pris Dworkin avec enthousiasme et soulagement. Sur X, un tweet viral a récemment répondu à un post d’un modèle pornographique posant en tant que Jeanne d’Arc, disant « Je connais une écrivaine qui a peut-être eu une ou deux choses pertinentes à dire » sur la sexualisation non ironique d’un adolescent célibataire et androgyne. Une photo en noir et blanc de notre sainte patronne anti-pornographie est devenue un mème de réponse courant à des absurdités hypersexualisées sur ce site. Elle est devenue si prolifique qu’il existe maintenant même une variation de projecteur Batman.
Cependant, l’approche radicale de Dworkin sur les sujets de la pornographie et de la prostitution est encore un peu épicée pour certains, comme je l’ai découvert récemment en écoutant un podcast dans lequel Dworkin était louée pour son « courage » — mais réprimandée pour sa position apparemment incidente anti-« travail du sexe ». L’animatrice a pris soin de nous faire savoir que le travail du sexe est un travail et que les femmes devraient avoir la liberté de vendre leur chair, présumément parce qu’elle avait passé environ deux minutes à considérer les implications d’une telle déclaration, a décidé que cela ne valait pas le risque d’être annulée et n’a pas réalisé, ou ne s’en souciait pas, que cette lâcheté la mettait en opposition absolue à tout ce que Dworkin a jamais dit ou écrit.
Dworkin, après tout, n’est pas une « féministe amusante » ; la principale chose que la plupart des gens savent d’elle, c’est qu’elle était détestée par de nombreux, nombreux hommes de son vivant. Dworkin savait ce que chaque écrivain qui remet en question le droit inviolable des hommes d’acheter les corps des femmes ou de se masturber sur des images d’elles sait : que le premier épithète à être lancé dans leur direction est, ironiquement, « pute ». Même en recevant des abus, souvent d’une nature violemment sexuelle, tant de la part du lobby pornographique (Hustler et Playboy, parmi d’autres revues pornographiques, la ridiculisaient et l’harcelaient continuellement) que de ses lecteurs furieux et excités, Dworkin ne se laissait pas perturber. « Quand une femme exprime une opinion — sur quoi que ce soit — et que la réponse consiste à saper les perceptions ou à remettre en question sa sexualité… la réponse peut être identifiée sans analyse supplémentaire comme implicitement antiféministe et haineuse envers les femmes », dit-elle, et elle a raison. Elle a gagné l’argument.
Mais alors, les femmes articulées, cultivées et sérieuses gagneront toujours l’argument contre celles motivées uniquement par une défense jalouse de leurs propres érections, pour qui le plus grand crime du féminisme est d’attirer l’attention sur les vraies vies des femmes de leur fantasme masturbatoire. Ces vies sont une hideuse incommodité, un tue-l’amour. Comme le témoigne une femme interviewée par Dworkin, qui connaissait les conséquences physiques d’avoir un partenaire obsédé par la pornographie, « la pornographie n’est pas un fantasme. C’était ma vie, la réalité. »
Alors, comme maintenant, il n’était pas toujours facile de distinguer les alliés masculins des opportunistes cyniques. Dworkin savait que les hommes soi-disant progressistes qui la méprisaient, parmi lesquels Norman Mailer et Hugh Hefner, ne se battraient pour les femmes que lorsqu’il s’agissait de leur droit à se dégrader. Les héritiers des « garçons fleurs » de la Révolution sexuelle — qui étaient tous pour que les femmes s’engagent dans l’amour libre dans les années soixante mais se faisaient rares dès que le féminisme commençait à « enlever le coup facile » — sont aujourd’hui ceux qui refusent de s’engager dans les lignes de bataille du genre, de l’image corporelle ou de l’écart salarial. Qu’ils plaident le droit éthique d’étrangler les femmes sans demander, ou défendent la liberté d’expression d’une femme seulement lorsqu’elle s’exprime en étant nue, ils n’apparaissent que lorsque le débat devient sexy, et donc leurs opinions peuvent, je pense, être écartées en toute sécurité.
Il est dommage que les détracteurs malades de la pornographie de Dworkin, qui n’ont jamais pris la peine de la lire de toute façon, aient fini par dominer de manière injuste les évaluations de sa vie. Dworkin mérite d’être considérée selon ses propres termes, de front, comme ce qu’elle appelle une « femme sérieuse ». Son écriture, promet-elle, « prend le pouvoir, le sadisme et la déshumanisation au sérieux » — sur ce point, elle tient ses promesses. Après tout, elle a gagné sa place aux côtés de ses contemporaines Germaine Greer, Gloria Steinem et Shulamith Firestone non pas en étant haïe mais en étant lue. Alors lisons-la.
Le génie de Dworkin réside dans sa capacité à repérer l’hypocrisie des hommes de gauche, et la sagacité des femmes de droite à les mépriser. Elle comprend la « cécité sélective » de la gauche en matière d’excitation : « Le profit n’est pas maléfique ou cruel lorsque le travailleur aliéné est un morceau de viande féminin… la gauche ne peut pas avoir ses putains et sa politique aussi. » Elle reconnaît, sans la bêtise politiquement polarisée que nous voyons aujourd’hui, la sagacité des femmes de droite — bien qu’elle ne fasse pas partie de leur nombre — en sachant que « la droite leur offre le meilleur accord : la plus haute valeur reproductive ; la meilleure protection contre l’agression sexuelle… la protection la plus fiable contre les violences ; le plus de respect ». Ce réalisme, cette empathie pratique, est complètement étrangère au discours féministe libéral actuel, qui voit toute lueur de conservatisme comme irrationnelle et maléfique. Pour cela, elle doit être accueillie à nouveau.
Dworkin est bien connue pour prendre littéralement et sérieusement le sens de la pornographie — qu’elle fait de toutes les femmes porneia, la plus basse classe de prostituées dans la Grèce antique, et que « nous sommes les femmes qui en font partie ». Elle comprend que « les garçons parient sur notre conformité, notre ignorance, notre peur » ; ici, elle prophétise les kinksters sur les applications de rencontre qui veulent blesser leurs partenaires « libérés ». Tous ces coups sont portés avec une clarté dévastatrice.
Sur la prostitution, elle est tout aussi inflexible : « Le modèle existe pour séduire de fausses révolutionnaires sexuelles féminines, des filles libérées crédule, et pour servir les hommes qui les apprécient, » elle s’acharne. La réalité du bordel, quelque chose pour quoi nous sommes maintenant méprisés pour l’avoir reconnu, est que les prostituées « absorbent, endurent ou deviennent indifférentes à une énorme quantité d’agression masculine, d’hostilité et de mépris ». Dworkin nous montre que les questions des « expressions de volonté », la défense des femmes naïves et des hommes joyeux, sont inutiles — la société crée les conditions oppressives dans lesquelles une femme se sent contrainte de vendre son consentement, ce qui signifie que sa volonté n’est jamais vraiment libre ; elle ne joue alors que pour son camp lorsqu’elle prend une décision qui titille les hommes. Les progressistes qui ignorent les réalités de la prostitution sont, nous dit-on avec un mépris punk franc, « profondément immoraux ». « La liberté sexuelle, c’est quand les femmes font les choses que les hommes trouvent sexy, » écrit Dworkin, annonçant l’ère d’OnlyFans.
Sur l’amour libre, elle est tout aussi méprisante : « Son but — il s’est avéré — était de libérer les hommes pour utiliser les femmes sans contraintes bourgeoises, et en cela, il a réussi ; la liberté pour les femmes existait dans le fait d’être baisées plus souvent par plus d’hommes. » Dworkin parle ici des années soixante — elle décrit les femmes se tordant avec des camarades aux cheveux longs à Woodstock et Altamont, se faisant dire qu’elles devaient abandonner leur « répression sexuelle » lorsqu’elles devenaient « fatiguées » ou « en colère », puis, quelques années plus tard, traînant pieds nus dans des communes avec les enfants résultants et sans soutien. Quelle différence avec cet état de choses par rapport à la culture de rencontres casualisée dans laquelle nous vivons aujourd’hui, d’où les femmes émergent en se sentant utilisées, blessées et manquant de respect (si moins souvent enceintes) ? Je regrette profondément de ne pas avoir rencontré Right-Wing Women à l’adolescence. Pour toutes mes futures filles, ce sera une lecture obligatoire.
Avant tout, Dworkin est un antidote aux féminismes libéraux de classe moyenne, faux et intéressés, du genre proposé par Florence Given, pour qui la praxis signifie vendre des coques de téléphone sur lesquelles il est écrit « largue-le ». Pourquoi ? Parce que « le féminisme n’est pas un style de vie ou une attitude ou un sentiment de vague sympathie envers les femmes ou une affirmation de modernité ». Il s’agit d’être impopulaire, vocal, prudent et cohérent, et d’ignorer les absurdités à la mode et distrayantes. Steinem a dit de Dworkin qu’elle avait une qualité de « destin de l’Ancien Testament » en elle, et qu’elle était souvent « mal comprise ». Sa voix résonne avec l’étrangeté prophétique et la franchise implacable d’un tel dieu ; maintenant que nous sommes habitués aux féministes pop politiquement correctes du mode kumbaya, du Nouveau Testament, cela peut sembler déstabilisant.
Dworkin n’est pas parfaite. Parfois, elle écrit des absurdités totales. Ses transgressions les plus offensantes se trouvent à la fin de Woman Hating, où elle glisse quelques passages courts mais émétiques sur l’inceste, la bestialité et la pédophilie. Sa vision d’une société post-patriarcale est celle qui efface les autres dynamiques de pouvoir du monde pour que, dans un état utopique d’« androgynie », tout soit permis. Voici le contexte bizarre de cette déclaration odieuse : « Inutile de dire que, dans une communauté androgynique, les relations humaines et celles avec d’autres animaux deviendraient plus explicitement érotiques, et que cet érotisme ne dégénérerait pas en abus. » Jamais l’expression « inutile de dire » n’a été aussi cyniquement utilisée. Le tabou autour de l’inceste est « une forme particulière de répression » ; les enfants « sont aussi des êtres érotiques », soutient-elle, avec un petit parfum de Peter Tatchell. Il est difficile de déchiffrer précisément ce qu’elle veut dire ici — après tout, c’est une écrivaine qui a dit de la femme californienne qui a tiré sur l’agresseur de son fils en cour : « J’aimais cette femme… Je n’ai aucun problème avec le fait de tuer des pédophiles. » Le bénéfice du doute suggère qu’elle a terminé sa vie (c’était cinq ans avant sa mort) avec ce dernier point de vue.
Ce sont des moments où le contexte de Dworkin dans le monde loufoque du féminisme radical des années 70 la défait complètement ; parfois, elle frôle l’illisible. Elle est à certains moments juvénile, écrivant un passage étendu sur la nature patriarcale des lettres majuscules : « Mon éditeur, dans sa sagesse d’entreprise, a rempli les pages de déchets : ponctuation standard. » Elle est positivement névrosée à propos de l’acte toujours oppressif de « baiser » hétérosexuel, et sa solution, pour cet état d’« androgynie », a peu de sens pratique compte tenu du problème ennuyeux de la réalité physique. Et dans son premier livre, elle prend littéralement la théorie freudienne du rêve psychanalytique qui ne peut raisonnablement être comprise que comme métaphorique, et finit par suggérer que « les hommes ont des peurs de castration profondément enracinées qui s’expriment comme une horreur de l’utérus ». Ce littéralisme est, il va sans dire, rebutant. Heureusement, cela s’atténue dans ses travaux ultérieurs.
Ce ne sont, je le soupçonne, pas des passages que Penguin utilisera dans leur marketing pour cette édition des Classiques Modernes. Ils nous avertissent de ne pas traiter les gens comme des prophètes — tout comme Greer, le corpus de Dworkin est un corps de brillance générale marqué par des instances de transgression bizarre, probablement le résultat d’être coincée trop longtemps dans des mondes théoriques antagonistes. Lorsque Greer a utilisé une chronique dans le magazine Suck comme excuse pour le viol, le présentant comme un acte radical marxiste de vol d’actifs, elle a nui à son œuvre plus large. Quelques années plus tard, elle a rétracté son point de vue. Dworkin ne l’a jamais fait.
La nouvelle féministe old-school de Penguin s’est parfois trompée — un fait qui risque de perturber les initiés de cette collection. Mais sur les questions de la pornographie et de la prostitution, elle est une génie : ses mots sautent de la page en 2025 et exigent que nous attendions plus. Sur ces pôles jumeaux de misogynie de plus en plus pertinents, Andrea Dworkin, cette femme imparfaite, abhorrée et impitoyable, hurle à travers les décennies pour nous sortir de notre torpeur ; vous seriez un fou de ne pas écouter.