BRADDOCK, PENNSYLVANIE - 20 MARS : Une statue de Joe Magarac, un légendaire ouvrier de l'acier des années 1940, devant l'usine U.S. Steel Edgar Thompson, le 20 mars 2024 à Braddock, Pennsylvanie. Nippon Steel a déclaré qu'il déplacerait son siège social américain de Houston à Pittsburgh, où se trouve U.S. Steel (X.N), si leur accord d'acquisition se concrétise. (Photo par Jeff Swensen/Getty Images)
L’austérité est rarement populaire pendant la saison électorale, et cette campagne a déjà présenté une variété de propositions qui mettent à l’épreuve le budget. Donald Trump a appelé à exonérer les pourboires de l’imposition, ce que Kamala Harris a ensuite soutenu. J.D. Vance a suggéré d’augmenter le crédit d’impôt pour enfants à 5 000 $ ; Harris a ensuite porté son offre à 6 000 $. L’actuelle vice-présidente a également proposé une aide de 25 000 $ pour l’acompte des primo-accédants, tandis que Trump a promis de rendre les prestations de la sécurité sociale et les heures supplémentaires exonérées d’impôt. La liste continuera probablement de s’allonger.
Cependant, malgré ces promesses, les Américains sont probablement en route pour une période d’austérité de consommation, peu importe qui gagnera l’élection. La seule question est de savoir quelle forme prendra cette austérité.
En termes quelque peu simplifiés, le choix politique fondamental se situe entre l’austérité conventionnelle ou « néolibérale », l’austérité progressiste-environnementale, et ce qui pourrait être appelé « réindustrialisation de rattrapage » — un changement de politique en faveur de l’investissement plutôt que de la consommation pour reconstruire la base industrielle des États-Unis et renforcer la sécurité et les perspectives économiques à long terme de l’Amérique, en particulier vis-à-vis de la Chine. À mon avis, la troisième option est à la fois nécessaire et la plus souhaitable, mais les trois présentent leurs propres difficultés et complications. Le fait que tous ces choix impliquent un certain niveau d’austérité contribue sans doute à l’amertume croissante de la politique américaine.
Commençons par considérer l’austérité néolibérale. Les préoccupations budgétaires conventionnelles ont refait surface avec les pics d’inflation des dernières années et les taux d’intérêt toujours proches de leurs niveaux les plus élevés depuis 2008. Par le passé, des déficits significativement supérieurs à 3 % du PIB n’étaient observés que lors de grandes récessions économiques ou en temps de guerre. En 2023, cependant, les États-Unis ont enregistré un déficit d’environ 6 % avec un taux de chômage relativement bas d’environ 4 %. Bien que la paranoïa concernant la dette nationale américaine se soit toujours révélée infondée à l’ère moderne, les limites de la trajectoire actuelle deviennent de plus en plus visibles, alors que les paiements d’intérêts représentent des pourcentages de plus en plus importants des dépenses gouvernementales.
La question pour les faucons du déficit — aujourd’hui et dans le passé — est de savoir s’ils sont en fait principalement préoccupés par la réduction du déficit. En Amérique, cette posture est souvent, sinon typiquement, malhonnête — un couvert rhétorique pour un projet idéologique de réduction de l’État plutôt que d’équilibrer de manière responsable les revenus et les dépenses. Ainsi, les faucons du déficit les plus stridents sont presque invariablement les plus désireux de réduire les impôts. Ou, peut-être plus précisément, les coupes d’impôts les plus agressives se déguisent souvent en faucons du déficit mais ont peu d’intérêt réel pour une politique fiscale responsable.
Aujourd’hui, avec des taux d’imposition fédéraux à des niveaux bas, tout programme sérieux de réduction du déficit devrait envisager des augmentations d’impôts. Les taux eux-mêmes ne sont peut-être même pas la question clé : imposer les bénéfices des entreprises dans le pays où ils sont réalisés, ou fermer diverses échappatoires fiscales personnelles, pourrait avoir un impact plus important à ce stade. Mais ces éléments sont largement exclus de l’agenda du « déficit », en particulier parmi les républicains, qui continuent de s’adonner à des fantasmes selon lesquels les réductions d’impôts « s’autofinanceront », malgré l’échec manifeste des réductions d’impôts de Bush et Trump à générer une croissance significative.
Au lieu de cela, l’accent conservateur reste entièrement mis sur la réduction des dépenses. Le problème ici est que, dans le domaine de la plausibilité politique, il n’y a pas tant de choses à couper. Selon les chiffres les plus récents du Bureau du budget du Congrès, « les dépenses obligatoires » (principalement Medicare, Medicaid et la sécurité sociale) représentaient 3,8 trillions de dollars du budget fédéral de 6,1 trillions de dollars pour 2023. Les dépenses de défense ont ajouté 800 milliards de dollars supplémentaires, constituant presque la moitié des « dépenses discrétionnaires ». Les coûts d’intérêts étaient de 700 milliards de dollars supplémentaires, contribuant à un déficit total de 1,7 trillion de dollars. En fin de compte, même si les 900 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires non liées à la défense étaient miraculeusement supprimés — en éliminant le transport, l’éducation, les prestations pour les anciens combattants, le système judiciaire et la recherche scientifique — cela ne réduirait le déficit que d’environ la moitié. Une réduction significative du déficit doit donc impliquer des coupes dans les domaines les plus sensibles sur le plan politique : la défense et les droits sociaux.
Étant donné l’émergence de la Chine en tant que concurrent de pair — et un concurrent bénéficiant d’un avantage considérable en matière de base industrielle — une réduction des dépenses de défense semble être hors de question. Au contraire, le républicain de premier plan au sein du Comité des services armés du Sénat, Roger Wicker, a proposé d’augmenter les dépenses de défense à 5 % du PIB, contre le niveau actuel de 3 %. Les raisons sont claires : la Chine a construit 21 sous-marins l’année dernière, tandis que les États-Unis ont eu des difficultés à en construire un ; il faudra jusqu’à sept ans pour reconstituer certains stocks de munitions utilisés en Ukraine, et les analystes estiment que les États-Unis seraient à court de certaines armes critiques dans une semaine lors de tout conflit actif concernant Taïwan. Une des raisons pour lesquelles la marine américaine n’a pas pu mieux protéger les voies maritimes du Moyen-Orient contre les récentes attaques des Houthis est une inquiétude que l’utilisation accrue de certaines munitions là-bas compromettrait la préparation pour d’autres conflits potentiels.
Jeter simplement plus d’argent au Pentagone et aux entrepreneurs de défense en place ne résoudra pas ces problèmes : des réformes d’approvisionnement sérieuses et des mesures de politique industrielle plus larges sont nécessaires. Et pourtant, il ne fait guère de doute que la situation sécuritaire de l’Amérique est plus périlleuse qu’elle ne l’a été depuis des générations. Les engagements idéologiques hérités compliquent encore ces questions. Les “faucons du déficit” les plus agressifs — comme Nikki Haley au sein du Parti républicain ou divers démocrates centristes — tendent également à être les plus fervents partisans des interventions en Ukraine et ailleurs pour défendre un “ordre international libéral dirigé par les États-Unis”. Bien que Haley et d’autres préfèrent généralement imaginer que la politique étrangère et la politique économique sont des domaines distincts, leurs engagements interventionnistes excluent néanmoins toute réduction significative des dépenses de défense.
Il reste la sécurité sociale et Medicare. Réduire la sécurité sociale est si politiquement toxique que Trump s’est complètement distancé des propositions de George W. Bush et Paul Ryan, qui étaient autrefois des marques de fabrique de la politique économique conservatrice. La direction républicaine au Congrès a également refusé de soutenir des réductions des droits lors des dernières élections de mi-mandat. Même si des réductions de la sécurité sociale étaient politiquement viables, il n’y a eu que peu d’efforts sérieux pour réfléchir aux effets.
Des réductions significatives signifieraient que les travailleurs devraient différer leur propre consommation, soit pour épargner davantage pour leur propre retraite, soit pour maintenir leurs parents âgés hors de la pauvreté, créant un frein à la croissance et compliquant les efforts de réduction du déficit. Bien que la sécurité sociale soit structurée comme une assurance sociale plutôt que comme une aide sociale, les formules de prestations sont quelque peu redistributives, donc des réductions majeures entraîneraient probablement un transfert supplémentaire de richesse des personnes à faible revenu, ayant une forte propension à dépenser, vers des épargnants aisés, ayant une propension à dépenser plus faible.
Dans le passé, les partisans de la « privatisation » de la sécurité sociale soutenaient parfois que permettre aux individus de gérer leurs propres économies de retraite permettrait d’obtenir des rendements plus élevés et de stimuler la croissance. Mais le programme de sécurité sociale fonctionne moins comme un fonds de capital géré professionnellement, comme les fonds de pension publics courants dans de nombreux autres pays ou dans certains États américains, et plus comme un stimulus à la consommation financé par la dette. Par conséquent, éliminer la sécurité sociale n’est pas simplement une question de distribution d’un pool d’actifs vers des comptes individuels. De plus, si l’objectif était simplement de maximiser les rendements, les « fonds de confiance » de la sécurité sociale pourraient être autorisés à effectuer des investissements publics et privés au-delà des titres du Trésor américain. Mais la même idéologie de petit gouvernement qui appelle à réduire la sécurité sociale résiste également à donner au gouvernement l’autorité de faire de tels investissements, ce qui pourrait déformer les « signaux du marché ». Déléguer toute responsabilité aux individus, en revanche, amplifierait l’impact de la volatilité du marché pour chaque ménage et nécessiterait probablement d’augmenter encore les économies. En même temps, le gouvernement serait probablement toujours appelé à secourir les retraités — qu’ils aient économisé prudemment ou non — lors de grands krachs boursiers.
Une approche plus pratique pourrait viser à maximiser la valeur dérivée du programme existant plutôt qu’à le réduire. Le sénateur Vance a été vivement critiqué pour avoir dit qu’il fallait faire davantage pour inciter les grands-parents à aider avec la garde d’enfants. Pourtant, il existe un certain nombre de propositions sérieuses pour utiliser la sécurité sociale afin d’inciter à la garde d’enfants ou de mieux soutenir le partage des ressources au sein des familles élargies.
Le deuxième domaine majeur perpétuellement sur la sellette est la santé. Cela semblerait être un terrain plus fertile : les États-Unis dépensent 17 à 18 % du PIB en soins de santé, de loin le plus au monde, pour obtenir des résultats de santé publique globalement médiocres. Les dépenses pour les programmes de santé représentent environ un quart du budget fédéral. Assurément, le système pourrait être plus efficace ?
Le problème, une fois de plus, est que les motivations idéologiques sont en désaccord avec des solutions pratiques. Ceux qui sont les plus désireux de réduire les dépenses de santé ont tendance à être ceux qui sont les plus attachés à l’idéologie « fondamentaliste du marché », qui tend à ignorer la possibilité qu’une intervention accrue de l’État pourrait être nécessaire pour contrôler les coûts. Mais la marchandisation, dans la pratique, a généralement échoué à contrôler les coûts et, en théorie, il y a peu de raisons de s’attendre à ce qu’elle le fasse. Comme l’a démontré l’économiste Kenneth Arrow en 1963, les dynamiques normales du marché ne s’appliquent pas aux aspects critiques des soins de santé. Les dynamiques concurrentielles et de prix ordinaires sont souvent absentes, et le secteur est caractérisé par de profondes asymétries d’information et des effets de réseau.
L’ironie est que même des étapes pratiques et incrémentales pour réduire les coûts des soins de santé, telles que la négociation des prix par le gouvernement avec les entreprises pharmaceutiques ou les monopoles hospitaliers, ou une meilleure régulation des intermédiaires parasitaires tels que les « gestionnaires de prestations pharmaceutiques » (PBMs), sont généralement résistées par les mêmes personnes qui prétendent être les plus préoccupées par la maîtrise des dépenses. En conséquence, la « marchandisation » dans le contexte américain a simplement signifié un refus d’employer l’État pour contrôler les coûts, contribuant à un cycle d’expansion des subventions.
En résumé, les préoccupations des faucons du déficit sont suffisamment réelles en ce qui concerne les soins de santé, la sécurité sociale et la défense, mais la politique autour de ces préoccupations reste insincère et inefficace.
Un schéma similaire prévaut dans l’environnementalisme progressiste, un autre domaine dans lequel des préoccupations légitimes ont été mises au service d’une politique contre-productive. Aux États-Unis, contrairement à l’Europe, la véritable austérité de « dé-croissance » est devenue si discréditée que la plupart des politiciens s’en sont éloignés, bien que l’impulsion existe encore parmi de nombreuses ONG et activistes. Pourtant, même si les progressistes américains, pour la plupart, ne cherchent pas à fermer l’agriculture moderne, à décourager la natalité ou à revenir à la lessive à la main pour stopper le changement climatique, ils sont désireux de restreindre les choix des consommateurs et de détourner des ressources publiques pour promouvoir les énergies renouvelables et les véhicules électriques. La loi sur la réduction de l’inflation, qui comprend la plupart des subventions liées au climat adoptées sous l’administration Biden, devrait coûter entre 800 milliards et 1,2 trillion de dollars sur 10 ans. Le coût réel est inconnu, car certains des crédits d’impôt de la IRA sont illimités et théoriquement sans plafond — mais la « transition énergétique » est certainement coûteuse.
La nécessité de tels efforts coûteux de réduction des émissions de carbone est souvent présentée comme étant au-delà de la politique ordinaire — seuls des négationnistes de la science pathologiquement cupides s’opposeraient à prendre des mesures pour éviter une urgence climatique mondiale ! Pourtant, bien que les préoccupations environnementales semblent universelles, le mouvement environnemental reste profondément partisan. Il est impossible d’ignorer le fait que les activistes climatiques exigent souvent des sacrifices de la part des gens ordinaires tout en ignorant les comportements des donateurs ultra-riches et en affichant des biais sectoriels clairs. Le fermier, le mineur de charbon, l’exurbain, etc., sont tous appelés à faire des ajustements difficiles pour atteindre divers objectifs d’émissions arbitraires. Mais les milliardaires qui se déplacent entre plusieurs propriétés en jets privés ne sont jamais censés changer leur mode de vie pour sauver la planète, sauf peut-être pour faire des dons au complexe des ONG climatiques. Les champs éoliens et solaires sont supposément essentiels — mais pas à la vue de Nantucket. Les entreprises de combustibles fossiles sont diabolisées, mais les géants de la technologie dont les fermes de serveurs consomment de plus en plus d’énergie sont largement exemptés de telles critiques, tant qu’ils émettent les bons discours sur l’ESG. De même, le mouvement environnemental a lutté pour imposer de plus en plus de charges réglementaires sur la fabrication et l’industrie lourde, tout en fermant les yeux sur la délocalisation de la pollution vers la Chine et ailleurs.
En fait, l’histoire du mouvement environnemental américain et de ses alliances politiques est plutôt sordide. Dans ses débuts, l’environnementalisme était associé au contrôle de la population et même à l’eugénisme. Après s’être rebrandé en tant que mouvement de contrôle des émissions dans la seconde moitié du 20ème siècle, les groupes environnementaux se sont d’abord associés aux charbon et aux dérégulateurs des services publics contre l’énergie nucléaire. Ensuite, ils ont accepté de l’argent du gaz naturel et d’Enron pour des campagnes contre le charbon. Ces dernières années ont vu un retournement contre tous les combustibles fossiles, bien que le nucléaire ait de nouveau été réadmis à contrecœur dans la poussée de décarbonisation. Ironiquement, les opposants les plus significatifs à la construction de nouvelles énergies renouvelables sont souvent des groupes environnementaux historiques, qui ont contribué à établir un régime juridique dans lequel il est relativement facile pour des tiers de contester toute nouvelle installation énergétique pour des raisons environnementales. C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup plus de champs solaires ont été construits dans des États républicains comme le Texas par rapport à des États ultra-progressistes comme la Californie.
Au-delà de toute cette préoccupation morale, le mouvement vert est fondamentalement juste un autre groupe d’intérêt poursuivant un agenda relativement étroit et partisan. Il est, et a toujours été, principalement composé d’individus aisés et de la classe professionnelle dans des secteurs d’entreprise « légers en actifs », ainsi que de joueurs énergétiques opportunistes. À bien des égards, c’est la coalition néolibérale ultime : une orientation mondiale, post-politique, supervisée par des technocrates opérant à travers des organisations transnationales non démocratiques et des marchés financiers.
Il est certain que le fait que le mouvement environnemental soit un lobby intéressé ne signifie pas nécessairement que ses revendications fondamentales sont fausses, même si certains activistes ont eu recours à l’alarmisme et à l’exagération par le passé. En effet, l’absence d’une politique environnementale efficace impose déjà sa propre forme d’austérité, comme le montrent la hausse des prix des assurances habitation à travers les États-Unis, à laquelle le changement climatique est presque certainement un contributeur. Pourtant, avoir raison sur certaines choses ne fait pas du mouvement environnemental un lobby moins influent.
Étrangement, le mouvement vert aurait probablement plus de succès aux États-Unis s’il acceptait simplement son caractère de lobby corporatif. Certes, un mouvement qui se concentrerait moins sur la préoccupation morale et le financement des ONG n’aurait probablement pas commis l’erreur de tenter de poursuivre la décarbonisation tout en diabolisant l’énergie nucléaire pendant des décennies. Il pourrait également être plus pratique en encourageant la transition vers l’énergie propre et les véhicules électriques.
La poussée actuelle vers les véhicules électriques, basée sur une combinaison de subventions fiscales et de mandats au niveau des États, est déjà en panne. La croissance des ventes a ralenti de manière spectaculaire, et les entreprises automobiles ont mis de côté leurs projets de nouveaux modèles. Une approche plus sérieuse reconnaîtrait que les États-Unis — contrairement, disons, à la Norvège — sont un grand pays avec un réseau ferroviaire faible ; les gens conduisent régulièrement sur de longues distances ; et le ravitaillement rapide des véhicules à combustion reste un avantage significatif. En même temps, les États-Unis — contrairement, disons, à la Chine — ont peu de capacité à imposer des changements de haut en bas dans les préférences des consommateurs et la construction d’infrastructures. Deux ans après que le Congrès a alloué des milliards pour des stations de recharge, aucune n’a été construite. Un agenda plus pratique aurait mis l’accent sur des véhicules tels que les hybrides rechargeables, qui pourraient avoir un impact majeur sur les émissions et inciteraient le secteur privé à ajouter davantage de stations de recharge, tout en séduisant les consommateurs qui désirent de la flexibilité. Une telle réflexion, cependant, nécessiterait que le mouvement vert abandonne la prétention de pureté morale et accepte les compromis et l’équilibre coalitionnel de tout lobby industriel.
Le résultat le plus probable est la continuation du statu quo, dans lequel des ONG largement financées persistent dans leurs tentatives de pousser une politique mal conçue sur une population réticente. Alors que l’austérité néolibérale est essentiellement un mouvement idéologique essayant de s’approprier la rhétorique de l’intérêt économique, l’environnementalisme progressiste est un lobby basé sur des classes et des secteurs cherchant à se brander comme une cause morale-idéologique. Les deux resteront inefficaces tant qu’ils continueront à travailler sous ces illusions d’auto-illusion.
La troisième option est, faute d’un meilleur nom, la reindustrialisation de rattrapage. Comme avec l’« austérité » environnementale, cela n’implique pas d’austérité budgétaire conventionnelle — cela peut en fait nécessiter plus de dépenses publiques — mais cela implique un changement d’orientation loin de la maximisation de la consommation et vers l’augmentation de l’investissement dans la capacité productive. Des mesures commerciales telles que des tarifs augmentent intentionnellement les prix, du moins à court terme, tandis que le financement des politiques industrielles peut se faire au détriment d’autres priorités budgétaires.
Le besoin d’un programme de politique industrielle sérieux est devenu plus pressant pour diverses raisons. La première est la sécurité nationale. Comme discuté ci-dessus, la base industrielle de défense de l’Amérique a considérablement érodé. En revanche, l’avantage manufacturier de la Chine est écrasant, ce qui a créé des dépendances de chaîne d’approvisionnement dans un certain nombre de domaines commerciaux critiques également. Abandonner des secteurs à des concurrents étrangers implique souvent de perdre plus que de la « fabrication de biens » ; cela signifie également perdre la maîtrise technologique et les compétences de la main-d’œuvre. Les États-Unis n’ont pas besoin de chercher à dominer chaque secteur manufacturier, mais il sera impossible de réparer la base industrielle de défense sans améliorer la base industrielle plus large.
De plus, il devient lentement évident pour les politiciens américains qu’il est impossible d’éviter d’avoir une politique industrielle ; la seule question est de savoir s’il faut poursuivre la sienne ou accepter l’imposition de celle des autres. La Chine, en particulier, en subventionnant massivement l’investissement en capital et les industries d’exportation, a désavantagé et découragé l’investissement dans les secteurs manufacturiers et intensifs en capital aux États-Unis. Et en refusant d’intervenir, les États-Unis ont simplement permis à Pékin de choisir des gagnants et des perdants.
De plus, le fait est que, même sans une politique industrielle consciente, le gouvernement américain a dû subventionner des champions nationaux en déclin tels que Boeing au cours des dernières décennies. Ce qui a manqué, c’est un plan sérieux pour maximiser l’efficacité de ces investissements, en grande partie parce que le consensus néolibéral post-Guerre froide a exclu toute considération ouverte de la politique industrielle.
Selon cette théorie économique conventionnelle, la politique industrielle sera toujours inefficace, destructrice de valeur et un frein à la croissance car elle interfère avec l’allocation de capital guidée par le marché. Si les acteurs du secteur privé nécessitent un soutien ou une incitation gouvernementale pour réaliser un investissement, la théorie soutient alors qu’il doit s’agir d’un mauvais investissement, même s’il est nécessaire pour des raisons non économiques telles que la défense. Ces modèles supposent, cependant, une forme de rationalité économique dans laquelle les entreprises opèrent pour maximiser les profits. En réalité, les entreprises opèrent pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Les deux peuvent parfois se chevaucher, mais ils ne sont pas identiques. En conséquence, les entreprises maintiennent souvent des taux de rendement bien supérieurs à leur coût du capital, et poursuivent des stratégies d’ingénierie financière au lieu d’investissements. Ce comportement peut être irrationnel dans le sens de renoncer à des profits, mais il est souvent éminemment rationnel dans le sens de maximiser l’évaluation des capitaux propres. Le résultat net, d’un point de vue national, est un sous-investissement chronique, en particulier dans les secteurs intensifs en capital où les politiques industrielles étrangères font baisser les rendements. C’est une des raisons pour lesquelles la relation entre les rendements financiers et les percées de productivité a toujours été plus ténue que ne le prédisent les modèles standards, et pourquoi la politique industrielle peut stimuler le développement économique en délogeant le rentier financier.
La promotion de l’investissement gouvernemental, par conséquent, n’est pas nécessairement destructrice de valeur. Elle peut en fait permettre des investissements dont les rendements, bien que inférieurs aux taux de rendement du secteur privé, restent positifs. Ces investissements, à leur tour, peuvent former la base de nouvelles entreprises, technologies et industries, comme le montrent les nombreux exemples historiques de politiques industrielles réussies, des automobiles coréennes aux semi-conducteurs taïwanais en passant par le début de la Silicon Valley.
Dans cette perspective, une politique industrielle réussie est peut-être mieux considérée non seulement comme une austérité pour les consommateurs mais plutôt comme une « gratification différée », ou un investissement dans l’avenir. Notamment, le gouvernement chinois a activement réprimé la consommation intérieure au profit de l’investissement industriel au cours des dernières décennies, et pourtant, contrairement à l’orthodoxie économique occidentale, a présidé à une montée miraculeuse des niveaux de vie, en plus de son pouvoir géo-économique croissant.
Cela ne veut pas dire, cependant, que le chemin à suivre pour les États-Unis sera facile. Au contraire, la politique industrielle américaine fait face à un certain nombre d’obstacles et de complications. Tout d’abord, les agences gouvernementales américaines ont relativement peu d’expertise dans la conception et l’exécution de stratégies industrielles, certainement par rapport à leurs homologues asiatiques. Le gouvernement américain lui-même est mal structuré à cette fin, avec une capacité institutionnelle limitée pour intégrer la politique étrangère et la politique économique.
Deuxièmement, les partisans de la politique industrielle américaine ont souvent des objectifs divergents en tête. Certains se concentrent sur la base industrielle de défense, d’autres sur la « transition énergétique », d’autres sur la « création d’emplois ». Dans un diagramme de Venn, ces cercles se croiseraient, mais ils ne sont pas identiques. De telles ambitions diffuses peuvent entraver à la fois le passage et la mise en œuvre d’une stratégie industrielle réussie, comme l’ont montré les critiques précédentes de la politique industrielle « bagel tout ».
Troisièmement, les plus grands acteurs corporatifs et financiers aux États-Unis sont au mieux ambivalents à propos de la stratégie industrielle. Ils dépendent profondément de la Chine et sont également les principaux bénéficiaires du modèle de « l’économie fissurée » dans lequel les revenus de la propriété intellectuelle sont séparés de l’investissement en capital et du travail. De plus, des politiques comme la loi Chips ont été adoptées en grande partie grâce au soutien des lobbies de l’industrie en place, bien que la conception des politiques ait souffert de diverses manières en conséquence. Reste à voir si les États-Unis peuvent poursuivre une politique industrielle dans des domaines critiques qui, contrairement aux semi-conducteurs, n’ont pas de puissants lobbies en place.
Enfin, et peut-être le plus important, un ingrédient essentiel présent dans les histoires de succès de la politique industrielle canonique de l’Asie de l’Est est absent aux États-Unis. En effet, les « Tigres asiatiques » ont chacun utilisé les marchés d’exportation mondiaux, en particulier le marché américain, comme un contrôle de la concurrence : les entreprises qui augmentaient leur part d’exportation recevaient plus de soutien en matière de politique industrielle ; celles qui ne le faisaient pas étaient coupées. Sans le contrôle du marché d’exportation, il y a une tentation accrue de subventionner des « zombies », plutôt que d’orienter les investissements de la politique industrielle vers l’amélioration de la productivité et de la compétitivité. La stratégie industrielle américaine, par conséquent, pourrait devoir accorder une plus grande importance à la stimulation de la concurrence domestique. Une autre option consiste à utiliser les marchés publics et les investissements pour créer des concours basés sur des jalons. Dans l’Opération Warp Speed, par exemple, le gouvernement a offert des contrats uniquement aux développeurs de vaccins qui atteignaient certains seuils, comme Moderna et Pfizer. Malheureusement, de tels modèles de contrat restent plus l’exception que la règle dans la politique américaine.
Trente ans après la fin de la guerre froide, il est clair que les États-Unis ont gaspillé leur moment unipolaire, non seulement par des interventions de politique étrangère quixotiques mais aussi par une politique économique imprudente. Illusoires par des théories abstraites et idéalistes, les dirigeants américains ont délocalisé la base industrielle du pays vers ce qui est maintenant son plus grand rival, afin de soutenir une consommation financée par la dette et des bulles d’actifs financiers. Le résultat est une nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, de lourdes dettes publiques et privées, et une économie dominée par des monopoles logiciels qui ont peu amélioré la productivité. Dans les prochaines décennies, l’Amérique devra consacrer plus de ressources à la résolution de ces problèmes. Si elle échoue à le faire, une austérité encore plus drastique lui sera finalement imposée, alors qu’un empire déjà tendu s’effondre complètement.








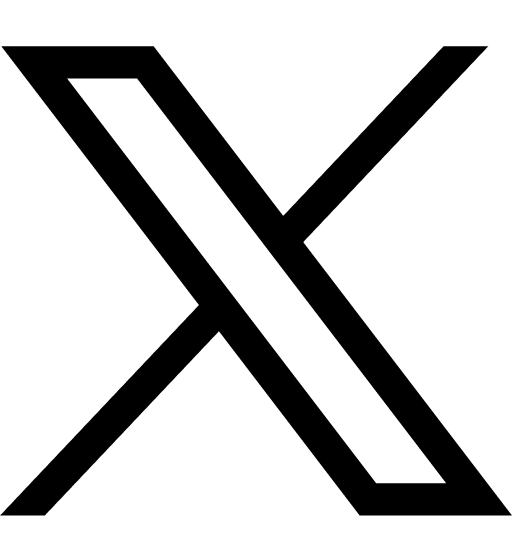
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe