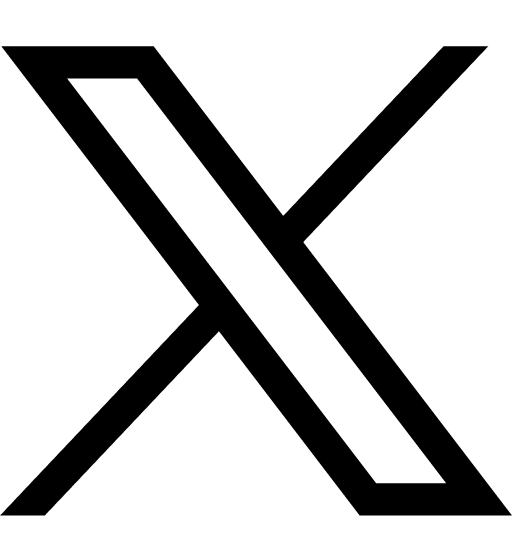Si la scène des fêtes sexuelles d’Oxford, inutilement infâme (pensez au Piers Gav, ou aux tâtonnements alimentés par la kétamine dans le salon de quelqu’un à Cowley), est quelque chose à quoi se fier, c’est un miracle que quiconque prenne la culture kink au sérieux. Mes sources m’assurent qu’un séjour de 10 minutes dans une tente pleine d’étudiants en sueur, se débattant pour obtenir une érection, apercevant à contrecœur son ancien chef de classe poussant des gémissements tièdes attaché à un gigantesque crucifix, vous apprend qu’il n’y a littéralement rien d’attrayant dans de tels endroits. Car il y a quelque chose de profondément ringard, de profondément mis en scène dans le kink — dans les arrière-salles d’Ann Summers et les menottes en fourrure cachées dans la table de chevet d’un comptable. Le mot « fétiche » vient du latin facticius, signifiant « artificiel », et ce n’est pas un hasard. Cette objection esthétique est peu susceptible d’être apaisée par des arguments élevés sur le sexe : votre droit à être fessé par quelqu’un déguisé en loup de dessin animé devrait, je l’espère, être égalé par le mien de ne pas avoir à en entendre parler.
Pour les femmes, ce problème est aiguisé par les doubles pressions de la violence sexuelle et de la pornographie. La semaine dernière, le centre de crise sexuelle d’Édimbourg, Beira’s Place, a rapporté que de plus en plus de jeunes femmes cherchaient un accompagnement après avoir été étranglées pendant les rapports sexuels. The Times a répondu avec un témoignage déchirant de la mère d’Emily Drouet, une étudiante de première année à l’Université d’Aberdeen qui s’est suicidée en 2016 après avoir été abusée physiquement et mentalement par son ex. Au tribunal, cet ex, connu comme le « mâle alpha » sur le campus, a admis l’avoir saisie par le cou. Ailleurs dans l’histoire, une travailleuse du sexe perd connaissance après avoir été étranglée par un client de confiance, qui viole ensuite son corps inconscient. « Elle pensait qu’elle avait le contrôle », dit un travailleur de crise sexuelle. Combien d’entre nous ont dit la même chose ?
Les femmes ne sont désormais que rarement honteuses de leur désir sexuel ; au contraire, elles sont honteuses de ne pas avoir d’appétit pour des actes qui, il n’y a pas si longtemps, étaient tout à fait considérés comme dégradants ou dégoûtants, ou les deux. Alors que le sexe est « libéralisé », les scénarios que nous évoquons pendant l’intimité deviennent de plus en plus patriarcaux. Il semblerait que les féministes pro-sexe deviennent, sur cette question, des compagnons étranges des pornographes et des super-stimuli toujours croissants qu’ils concoctent. Ces féministes nous ont également appris, parmi d’autres fausses vérités nuisibles telles que « vous pouvez acheter le consentement d’une femme, et elle sera heureuse de vous le vendre comme la femme d’affaires libérée qu’elle est ! », qu’il est parfaitement normal pour les hommes de désirer infliger des dommages physiques aux femmes avec qui ils dorment. Cela devrait rester, comme ce n’était pas si longtemps, extrêmement controversé. Après tout, si le féminisme concerne le choix, alors nous devons être absolument sûrs que le choix d’être brutalement étranglée par un petit ami est un choix que nous faisons par désir véritable, et non par pression ambiante et honte d’être qualifiée de frigide.
Qu’est-ce qui est si émancipateur dans le fait d’être étranglée ? Et pourquoi est-ce que les actes les plus radicaux et libérateurs du répertoire sexuel moderne sont ceux qui répètent les vérités les plus oppressives et asservissantes sur le fait d’être une jeune femme dans une ville moderne — que l’un des hommes quelques pas derrière vous la nuit pourrait vouloir vous étrangler, vous rabaisser ? Il se pourrait que nos partenaires masculins ne remarquent tout simplement pas les innombrables histoires d’actualité qui sous-tendent ces peurs : plus récemment, le procès de la travailleuse du NHS de 37 ans, Natalie Shotter, qui a été violée à mort sur un banc de parc. Après avoir vu de telles histoires, l’instinct d’une femme lorsqu’elle sent une main se glisser sur son cou et se resserrer de nulle part pourrait raisonnablement être de la repousser avec rage. Si le féminisme ne peut pas empêcher les femmes d’être contraintes de faire des choses qui les dégoûtent, les blessent et les effraient, à quoi bon ?
Autrefois, le sexe lui-même était transgressif — à tel point qu’Anne Boleyn a réussi à changer la religion nationale en le retenant. Maintenant, nous sommes dans une course aux armements de l’extrême sexualité, propulsée par Internet et une culture de rencontres de plus en plus décontractée. La plupart des jeunes femmes avec qui je parle disent avoir été étranglées sans permission. Beaucoup d’entre elles s’exclament : « mais ça ne me dérange pas, bien sûr ! » avec un regard coquet. Puis, après un questionnement plus approfondi, elles commencent à se demander si elles aiment vraiment ça — ou si elles se contentent de faire semblant. C’est une réalisation inconfortable.
Ici, la philosophe belge Luce Irigaray a quelque chose à dire. Dans un écho plus convaincant de la théorie de John Berger selon laquelle “les hommes regardent les femmes. Les femmes se regardent être regardées”, Irigaray écrit que les femmes tirent un “plaisir vicariant” à plaire aux hommes — bien qu’indifférentes, voire repoussées, elles-mêmes. Le sexe est une “prostitution masochiste de son corps à un désir qui n’est pas le sien… elle ne sait pas, ou ne sait plus, ce qu’elle veut”. Lorsque Irigaray écrivait dans les années quatre-vingt, la culture kink moderne était encore contenue — elle est née dans les bars en cuir gay des années cinquante, se frayant un chemin dans des magazines de premier plan tels que Bizarre et dans le grand public via The Rocky Horror Picture Show avant de devenir une partie routinière, voire pro forma, de la pornographie sur Internet. Aujourd’hui, la vision autrefois radicale d’Irigaray semble désespérément conventionnelle et difficile à contester. Des femmes jeunes et inexpérimentées, amenées à se sentir prudes ou illibérales pour ne pas vouloir se sentir effrayées ou en danger pendant le sexe, passent par des actes de plus en plus extrêmes ; la validation qu’elles reçoivent, à part celles — je soupçonne, une minorité — qui apprécient vraiment le “jeu de souffle”, est le “plaisir vicariant” qu’Irigaray avait envisagé.
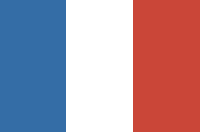
 Édition Principale
Édition Principale US
US