HAY ON WYE, ROYAUME-UNI - 28 MAI : Sally Rooney, romancière, au Festival de Hay le 28 mai 2017 à Hay on Wye, Royaume-Uni. (Photo par David Levenson/Getty Images)
‘Allongée nue, le menton dans la main, lisant de la poésie.’ Mon Dieu, c’est parti. Je sens mes poils se hérisser alors que je suis projetée dans une arène où c’est moi contre un autre lecteur imaginaire, que je n’ai pas besoin de décrire, qui aime ce genre de choses. Les spectateurs — des hommes, des écrivains masculins, tous ces poètes nobles morts que nous avons endurés à l’université — nous regardent dans un combat à mort sur ce que signifie être une écrivaine, une lectrice. Je me retrouve à essayer de prouver à ces foules d’hommes imaginaires que je ne suis pas comme mon adversaire, je suis meilleure, plus sérieuse, moins gênante. C’est l’expérience schizophrénique d’être une jeune femme lisant Sally Rooney.
Nous sommes toutes féministes jusqu’à ce que nous lisions un livre d’une autre féministe, et là nous devenons des collégiennes méchantes, piétinant les cous des autres. Il ne m’échappe pas que c’est un article écrit par une femme sur un livre d’une femme dont le lectorat est notoirement féminin. Avec ce fait vient un nœud de pressions, une norme plus élevée et plus froide à laquelle Rooney est soumise : peut-elle écrire du point de vue des hommes ? Peut-elle capturer leurs sentiments sur le sexe ? Écrit-elle uniquement sur le sexe ? Est-ce vraiment un soap opera ?
Les rares fois où j’ai levé les yeux au ciel dans l’expérience longue et généralement agréable de lire le nouveau roman de Rooney, Intermezzo, ont été dans les moments d’apparente prétention. Il y a un personnage brièvement mentionné qui ‘éternue toujours dans un mouchoir et parle de Karl Marx’. Un péché mineur. Mais le moment qui m’a vraiment propulsée dans l’orbite a été lorsque nous avons rencontré notre Madone, notre lectrice de poésie nue, notre personnage incarnant le sérieux académique féminin, Sylvia, et elle est décrite comme une ‘femme élancée au sommet de la pièce parlant des formes de prose du XVIIIe siècle’. Résistant à ridiculiser cette phrase — et je me sens sainte de le faire — je veux plutôt demander pourquoi je la trouve si offensante. Et je pense que c’est parce que je suppose, à tort, que Rooney est incapable de s’écrire hors des romans. Je suppose que, comme les autres diplômées frêles de Trinity dans le monde littéraire de Rooney, c’est un modèle d’elle-même, ou de moi-même, ou que cela a quelque chose à voir avec nous en tant que lectrices.
C’est une suspicion que Rooney a confrontée, comme dans une récente interview avec The Guardian. Mais cette image, celle de Sylvia au ‘sommet de la pièce’, d’être mince, d’être intelligente, a été dommageable pour la carrière précoce de Rooney car elle cristallise la féminité inconfortable, l’intensité langoureuse, de ses fans. Je me souviens encore d’un tweet parodique d’il y a quatre ans qui a suivi Rooney depuis : ‘Minablement, j’ai tristement et chaudement oublié de manger pendant 7 jours et je ne m’en suis rendu compte que lorsque je suis tombée devant Trinity College et que tout le monde s’inquiétait pour moi. Puis un homme horrible m’a donné quelque chose à manger et nous avons eu des relations sexuelles. C’était bon, et mauvais.’ Cette tweeteuse n’est pas comme les autres filles, vous comprenez ; elle a triomphalement déterminé que le roman que ces autres filles moins perspicaces aiment est, en fait, peu plus qu’une fanfiction de lingettes humides – le type de contrarianisme le plus détestable et superficiel. Mais est-ce pour cela que je suis si rapide à la critiquer ?
En d’autres termes, je me retrouve à me moquer au centre d’un labyrinthe construit de ma propre conscience de soi, de mes propres snobismes et de mes sentiments de devoir prouver ma valeur. Cela suggère une possibilité inconfortable : que Rooney n’est en fait pas, comme je l’ai entendu de mes pairs tant de fois, une mauvaise écrivaine — je pense vraiment qu’elle est plutôt bonne — mais que la toxicité du discours autour d’elle signifie que certains d’entre nous deviennent mauvais lecteurs. Nous tombons plus facilement dans les pièges que Rooney a tendus pour nous, en particulier, dans Intermezzo, en nous donnant deux objets d’amour — l’étudiante superficielle, modèle OnlyFans, Naomi et l’intellectuelle blessée et béatifique Sylvia — dont les pensées sont, de manière inhabituelle, dissimulées à notre regard. Au lieu de cela, elles sont vues, principalement, à travers le regard du brut Peter, qui est un avocat des droits de l’homme alcoolique et suicidaire impliqué avec elles deux. C’est une idée qui nous entraîne délibérément dans des arguments avec nous-mêmes sur la façon dont nous voulons être représentés, et nous piège dans un jeu d’auto-identification qui signifie que le monde critique plus large, celui qui embrasse le relativisme et les plaisirs textuels purs, nous échappera toujours.
Mais éviter l’affront sur la façon dont les jeunes femmes existent à l’intérieur et à l’extérieur de ce texte, comment elles parlent, s’expriment, sentent — est une tâche excruciante. À un moment donné, notre flambeur de la génération Z, Naomi, qui est toujours enveloppée de sensualité, ‘fragrance de parfum, de sueur et de cannabis’, dit de Peter : ‘Honnêtement, très codé dilf.’ Je jette un coup d’œil au paquet de paracétamol sur ma table de nuit. Ce ne serait pas suffisant. À la fin de cette même page, nous avons une série de références académiques impressionnantes, probablement pour nous empêcher de jeter le livre à travers la pièce. ‘Toussaint Louverture. Bolívar, Garibaldi.’ Cela résume parfaitement pourquoi Rooney est bonne, mais aussi un peu gênante — c’est cette combinaison d’agressivité contemporaine et d’érudition, l’archétype de l’étudiant anglais. Si je me sens mal à l’aise avec cela, c’est parce que j’en ai été un.
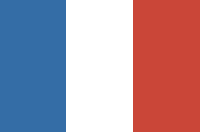
 Édition Principale
Édition Principale US
US





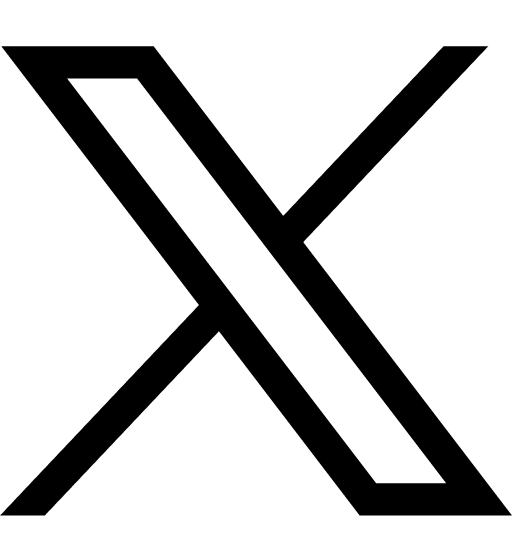
Participez à la discussion
Rejoignez des lecteurs partageant les mêmes idées qui soutiennent notre journalisme en devenant un abonné payant
To join the discussion in the comments, become a paid subscriber.
Join like minded readers that support our journalism, read unlimited articles and enjoy other subscriber-only benefits.
Subscribe